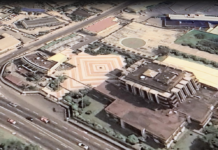Il y a un peu plus d’un an, l’insurrection populaire qui mettait fin aux 27 ans de règne de l’ex président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, faisait basculer le pays dans une ère nouvelle.
Malgré un révolte marquée par les violences en octobre 2014, le rapide retour au calme dans le pays, la remise du pouvoir exécutif par les militaires à un civil et le respect des délais pour la mise en place d’un gouvernement de transition ont érigé « le pays des hommes intègres » en modèle africain de transition démocratique. A l’époque, commentateurs politiques étrangers et organisations internationales espéraient voir « le cas burkinabè » faire école sur le continent, dissuadant à l’avenir d’autres chefs d’Etat de réformer la Constitution de leur pays pour se maintenir au pouvoir. Piqués d’euphorie, les citoyens burkinabè n’ont pas tardé à faire valoir leurs revendications les plus urgentes : créations d’emplois pour les jeunes, lutte contre la vie chère et l’impunité, accès à la santé pour tous…
Un an plus tard, à quelques jours des scrutins présidentiel et législatif du 29 novembre, les attentes sont loin d’être comblées. Et pour cause. Chahuté par une tentative de putsch ratée et perclue de zones d’ombres, miné par les vives tensions qui traversent encore l’échiquier politique, « le modèle burkinabè a du plomb dans l’aile » remarque un journaliste burkinabè. Mondafrique revient sur les évènements les plus forts qui ont jalonné la période de transition.
Loi d’exclusion
Deux points de controverse ont largement contribué à envenimer l’atmosphère politique du pays pendant un an.
Premièrement, l’adoption en avril 2015 d’un nouveau code électoral rendant inéligibles les responsables de l’ancien régime ayant soutenu le projet de réforme constitutionnelle devant permettre à Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Invalidée en juillet par la Cour de justice de la CEDEAO, cette mesure a crispé l’ensemble d’une classe politique placée pendant un quart de siècle sous l’influence de Blaise Compaoré et de son parti le CDP. La mise à l’écart de la compétition de plusieurs candidats de l’ancien parti présidentiel, dont l’influent ex ministre des affaires étrangères Djibril Bassolé, a donné le sentiment que les autorités de la transition favorisaient un camp contre l’autre et embrassaient une démarche d’exclusion dangereuse pour l’unité du pays.
De fait, la loi électorale a ouvert un boulevard vers le Palais de Kossyam au candidat du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP), Marc Roch Christian Kaboré, donné favori pour le scrutin présidentiel de dimanche prochain. D’ethnie Mossi (majoritaire dans le pays), contrairement à son principal adversaire Zéphirin Diabré, et soutenu par l’Elysée, cet ancien premier ministre de Blaise Compaoré aurait pu être mis en difficulté par Djibril Bassolé en cas de report de voix sur son adversaire au deuxième tour.
Ce n’est désormais plus possible. D’abord écarté du scrutin par le code électoral, l’ex ministre des affaires étrangères et grand maître de la Grande Loge maçonnique du Burkina a été mis en détention, accusé d’avoir soutenu, dans l’ombre, le putsch mené par le Régiment de sécurité présidentielle (RSP), l’ancienne garde prétorienne de Compaoré, en septembre 2015.
Le code électoral a par ailleurs contribué à alimenter l’animosité entre anciens barons du CDP. Parmi les principaux leaders politiques dont les deux figures de proue de la présidentielle à venir Roch Marc Christian Kaboré (MPP) et Zéphirin Diabré (UPC), tous ont en effet endossé de hautes fonctions politiques sous l’ancien régime avant d’entrer en dissidence contre l’ex président. « En excluant le CDP de la compétition électorale, les autorités de la transition ont soufflé sur le feu d’un antagonisme déjà très fort entre des personnalités qui sont toutes des produits du système Compaoré », analyse un diplomate français. Aujourd’hui ces tensions sont au plus haut, exacerbées par le gel des comptes de campagne infligé à plusieurs leaders d’opinion du CDP en région où le parti est fortement implanté.
Le RSP fait de la résistance
Deuxième pierre d’achoppement : les crises à répétition autour du Régiment de sécurité présidentielle (RSP). Ancienne garde rapprochée de Blaise Compaoré, ce puissant corps militaire d’élite composé d’environ 1300 hommes a donné à la transition ses plus violents soubresauts. En négociant, lors de la révolte d’octobre, la nomination comme premier ministre de la transition de l’un des leurs, Yacouba Isaac Zida, numéro deux de la garde présidentielle, les hommes du RSP pensaient préserver leurs privilèges et assurer la survie de leur unité symboliquement associée à l’ancien régime.
L’émancipation progressive du premier ministre de ses anciens « frères d’armes » et notamment du patron du RSP, le général Diendiéré, ancien bras droit de Compaoré, est venue contrecarrer ces plans. Exigeant dès février 2015 la dissolution du RSP avant de se rabattre sur une simple « réforme », Zida s’engage dans une guerre ouverte avec le régiment qui réclame, fin juin, sa démission. Après plusieurs démonstrations de force, le RSP lance finalement un putsch le 16 septembre au cours duquel le premier ministre Zida et le président de la transition Michel Kafando sont pris en otage pendant trois jours. L’échec du coup d’Etat désavouera le RSP dont le démantèlement définitif a été annoncé le 26 septembre. « D’autres sanctions pourraient venir après le rendu des conclusions de la commission d’enquête sur le putsch et de la commission judiciaire ouverte par la justice militaire » déclare une source proche de la présidence. Au risque de créer de nouvelles tensions si les sanctions se transformaient en chasse aux sorcières.
Aujourd’hui, de lourds soupçons continuent de peser sur l’implication du RSP dans plusieurs crimes économiques et de sang dont l’assassinat de Thomas Sankara en 1987 et celui du journaliste Norbert Zongo en 1998. De graves accusations qui font dire à de nombreux observateurs que le putsch était avant tout destiné à négocier l’impunité des membres du RSP.
Menacé de dissolution dès la mise en place de la transition, le coup d’Etat de septembre a finalement précipité sa chute.
« Putsch express » et « putsch puzzle »
Moqué comme le « putsch le plus bête du monde », le coup d’Etat de septembre dernier est sans doute l’événement le moins lisible de la transition. « Un vrai puzzle à reconstituer » relève un journaliste burkinabè.
En une semaine seulement, les militaires du RSP ont du capituler face aux répliques de l’armée régulière et la colère de la rue. L’apparition du général Diendiéré en tenue militaire à la télévision nationale annonçant sa prise de pouvoir dans un discours poussif a rappelé une imagerie digne des années 1970. Après s’être heurté à l’armée loyaliste, le général a finalement remis le pouvoir à la transition en présentant ses excuses. « De loin, on aurait dit une farce. Comment peut-on libérer des otages avant même d’avoir négocié quoi que ce soit ? » s’étonne une source sécuritaire.
Pourtant, aussi « bête » qu’il paraisse, le déroulement du putsch demeure troué de zones d’ombres masquant une réalité plus complexe. Selon plusieurs sources, l’étincelle menant au coup d’Etat serait venue d’officiers du camp de Naaba Koom, la base du RSP à Ouagadougou. « Quelques jours avant le putsch, plusieurs soldats exprimaient leurs mécontentements concernant notamment le versement de leurs soldes » affirme une source militaire. Le général Diendiéré n’aurait alors fait que prendre le train en route, contraint, en tant que chef de corps, d’endosser le rôle du leader. Une hypothèse qui expliquerait pourquoi il se serait plié si rapidement à toutes les conditions imposées par la médiation menée par le président sénégalais Macky Sall. Côté français, ce n’est qu’à partir du moment où Gilbert Diendiéré prend les commandes du putsch que le chef d’Etat major particulier de François Hollande, Benoît Puga, et les nombreux relais militaires du patron du RSP en France sont mis au courant de la situation.
Un élément concentre cependant toutes les interrogations. Pourquoi Gilbert Diendiéré s’est-il rendu en Côte d’Ivoire quelques jours seulement avant le coup d’Etat ? Y a-t-il croisé le président de l’Assemblée ivoirienne Guillaume Soro que beaucoup soupçonnent d’avoir tenté de déstabiliser la transition burkinabè en appuyant le putsch ? A-t-il rendu visite à Blaise Compaoré dans sa villa de la banlieue de Cocody et évoqué, avec lui, un projet de renversement de la transition ?
Dans la cacophonie d’après le putsch, les réponses se résument le plus souvent à une parole contre une autre. Beaucoup affirment que Blaise Compaoré, qui se trouvait au début des évènements au Maroc où il reçoit régulièrement des soins, n’était pas au courant. D’autres, prudents sur l’implication de l’ex chef d’Etat burkinabè, soulignent toutefois l’existence de collusions entre certains segments du RSP et des éléments du CDP.
Les frères ivoiriens
Soupçonnés d’avoir soutenu le putsch, voire participé à sa préparation, les alliés ivoiriens historiques de Blaise Compaoré et du RSP, le président de l’Assemblée Guillaume Soro et le chef d’Etat Alassane Ouattara, ont pour leur part joué un rôle très ambiguë encore loin d’être éclairci. Preuve s’il en fallait une, que les relations intriquées entre Ouagadougou et Abidjan restent inexorablement au coeur des sursauts politiques qui agitent le Burkina Faso.
Principal officier liaison entre Gilbert Diendiéré et les Forces nouvelles (FN) de Guillaume Soro lors de la rébellion soutenue par Ouagadougou dans le nord de la Côte d’Ivoire en 2002, Zida s’est attiré l’ire de son allié ivoirien une fois nommé premier ministre en menaçant de dissoudre le RSP. Depuis, les relations sont au plus mal entre les deux anciens « frères d’armes » devenus meilleurs ennemis. Un diplomate burkinabè affirme notamment avoir assisté à une conversation téléphonique entre les deux hommes au cours de laquelle le président de l’Assemblée nationale ivoirienne s’en prenait furieusement au premier ministre burkinabè qu’il accusait de trahir les siens. Un colère justifiée pour Guillaume Soro qui, après la chute de Blaise, ne pouvait plus compter que sur la fidélité du RSP pour conserver sa base arrière à Ouagadougou. Si pour l’heure rien ne prouve l’implication des autorités ivoiriennes dans le putsch, plusieurs sources sécuritaires affirment toutefois que la défaite de la transition burkinabè était « au moins vivement souhaitée » à Abidjan…
Ecoutes explosives
De courte durée, le coup d’Etat risque cependant d’engager le pays dans un cycle de représailles et de règlements de comptes néfastes pour la vie politique du pays sur le long terme. A fortiori s’il fait l’objet de récupérations. La polémique explosive sur les écoutes téléphoniques entre Guilaume Soro et l’ex ministre des affaires étrangères Djibril Bassolé diffusées sur internet en est l’un des premiers symptômes. rendu public le 12 novembre, cet enregistrement non authentifié qui fait entendre des voix présentées comme celles de Guillaume Soro et de Djibril Bassolé évoquant leur soutien au putsch a électrisé l’atmosphère politique à quelques semaines des élections.
Les avocats de Djibril Bassolé parlent d’un « acharnement » à l’égard de l’ex ministre des affaires étrangères qui, selon une source proche de son entourage, serait en train de mobiliser ses réseaux franc-maçons afin de préparer sa riposte. « L’histoire est loin d’être terminée » assure la même source qui craint des représailles. Dans l’entourage de Djibril Bassolé, certains n’hésitent pas à accuser directement les autorités de la transition d’avoir organisé la fuite de cet enregistrement afin d’éliminer toute possibilité pour l’ex ministre des affaires étrangères de se porter candidat aux élections.
Côté ivoirien les répercussions sur les luttes claniques pour le pouvoir sont tout aussi énormes. L’enregistrement fait en effet entendre la voix présentée comme celle de Guillaume Soro qui s’en prend vertement au ministre de l’Intérieur ivoirien Hamed Bakayoko, son principal concurrent dans la course à la présidence en 2020. Signe que la guerre de succession à Alassane Ouattara est bel et bien déclarée en Côte d’Ivoire.
C’est dans ce contexte houleux que près de 5,5 millions de burkinabé sont appelés à se rendre aux urnes dimanche 29 novembre. Donné grand favori de la présidentielle, le candidat Roch Marc Christian Kaboré aura, s’il est élu, la lourde tâche de satisfaire aux nombreuses attentes que les citoyens burkinabè ont mis sous cloche depuis un an ainsi qu’aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Or, les remous générés par la période de transition livrent au prochain président une classe politique rongée par des luttes intestines et de vives rancoeurs qui pourraient mettre en péril l’efficacité des mesures entreprises ainsi que l’unité du pays. Le maintien dans le temps d’une atmosphère apaisée dépend également de la nature des relations que le nouveau président entretiendra avec le voisin ivoirien. Attention… fragile*.
*Référence à l’éditorial publié par Rinaldo Depagne, analyste principal pour l’Afrique de l’Ouest à l’International Crisis Group, dans le magazine Jeune Afrique du 23 février 2014.