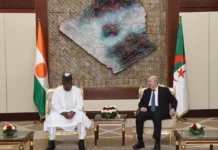Un an après l’attaque terroriste menée en 2015 par l’Etat islamique contre une plage près de Sousse, la Tunisie reste confrontée à une forte menace terroriste émanant à la fois du territoire national et de la Libye voisine. Le fait que le tueur de Nice, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, soit de nationalité tunisienne pourrait bien obliger les forces anti terroristes françaises à s’interroger, dans les prochains jours, sur la porosité des groupes djihadistes entre la France et la Tunisie. L’inquiétude, la voici: les autorités tunisiennes n’ont toujours pas mis en place une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme
La Tunisie, « tremplin » du terrorisme libyen
D’après les services américains, 6000 Tunisiens sont engagés dans les rangs de Daech en Irak, en Syrie et en Libye, susceptibles, un jour, de revenir chez eux. Près de 600 d’entre eux seraient déjà rentrés. Un défi sécuritaire jugé prioritaire mais que les responsables politiques et les forces de sécurité peinent à appréhender. Selon un rapport du think tank américain International Crisis Group (ICG) qui cite un ancien directeur général de la sureté nationale, les renseignements extérieurs ne fournissent pas suffisamment d’éléments à la justice pour prouver que ces personnes ont du sang sur les mains. « Ils sont donc seulement assignés à résidence et surveillés étroitement par la police » relève la même source.
D’autres, encore actifs au sein de l’Etat islamique, pourraient organiser des opérations violentes sur le territoire tunisien devenu un « tremplin » stratégique pour les groupes terroristes installés en Libye. Ces derniers souhaitant s’étendre vers l’Ouest, notamment l’Algérie, le reste du Maghreb, et la partie occidentale de l’Afrique. Ils pourraient bénéficier pour cela de relais sur le sol tunisien. Selon le rapport d’ICG, « plusieurs cellules dormantes, dont certaines sont en contact avec Al-Qaeda au Maghreb islamique (AQMI) et l’EI seraient disséminées sur le territoire, en milieu urbain et périurbain. En outre, près de 150 djihadistes armés de l’organisation Okba Ibn Nafa (proche d’Aqmi), très affaiblie par l’armée et la garde nationale et de Jounoud Al-Khilafa (proche de l’EI) évoluent encore dans les zones montagneuses et forestières proches de la frontière tuniso-algérienne. » Ce dernier groupe bénéficie par ailleurs de complicités locales parmi les franges déshéritées de la population dans un rayon d’une centaine de kilomètres en direction de Sidi Bouzid, berceau de la révolution tunisienne au centre du pays.
Affaiblies après la chute de Ben Ali, les forces de sécurité ont enregistré, ces derniers mois, des progrès significatifs soldés par de récentes réussites sur le terrain. C’est le cas à Ben Gardane où elles sont parvenues à contrer l’assaut lancé par une soixantaine de djihadistes contre une caserne militaire et un poste de la garde nationale. « Un point de rupture » selon Rafik Chelli, ancien secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la sûreté. Suite à cette opération, plusieurs terroristes arrêtés ont fourni des renseignements sur l’emplacement de caches d’armes, notamment des kalachnikovs et des grenades, au sud de la Tunisie.
Des capacités renforcées
Sur le terrain libyen, plusieurs sources sécuritaires évoquent par ailleurs l’effet positif de l’action des forces occidentales notamment américaines. « La frappe des Etats-Unis sur la vile de Sabrata à 70 kilomètres des frontières tunisiennes à coupé l’un des principaux relais servant à acheminer armes et combattants entre la Tunisie, la Libye et la Syrie » affirme un ancien ministre spécialisé dans les questions de sécurité. Les moyens mis à disposition des forces de sécurité (armée, police et garde nationale) ont par ailleurs été renforcés. En 2016, 20 % du budget de l’Etat est consacré à la sécurité soit deux fois plus qu’en 2011 au moment de la révolution. Certaines unités déployées sur le terrain ont bénéficié d’une formation spéciale aux méthodes d’antiterrorisme.
Des initiatives jugées nécessaires pour permettre au dispositif sécuritaire tunisien de faire face au renforcement des capacités stratégiques de Daech en Libye. Selon plusieurs sources sécuritaires, il s’agit également de combler le déficit créé lors des premiers mois de règne de la Troïka, la coalition gouvernementale menée par le parti islamiste Ennahda au pouvoir entre 2011 et 2014. « Au début du mandat, une partie de la sécurité de l’Etat a été décapitée notamment dans les services de renseignements et les unités opérationnelles » affirme un ancien ministre. Au même moment, de 2011 à fin 2012, Ennahda affiche une certaine tolérance vis-à-vis du mouvement Ansar Charia autour duquel tente de se structurer politiquement la mouvance salafo-djihadiste. Ce n’est qu’en 2013, après l’attaque de l’ambassade américaine de septembre 2012 et l’assassinat de deux militants de gauche qu’Ennahda opère un virage sécuritaire qui consomme définitivement son divorce avec Ansar Charia.
Failles stratégiques
Malgré une restructuration progressive, les forces de sécurité gardent encore aujourd’hui des séquelles de cette époque. Elles sont par ailleurs, depuis Ben Ali, en proie à un manque de mise à niveau sur les méthodes de lutte antiterroriste ainsi qu’à d’importants problèmes de coordination et de sous équipement. Selon un ancien général d’armée, « les membres des différentes hiérarchies des forces de sécurité ont des compétences très insuffisantes en matière de lutte antiterroriste. La plupart n’ont pas reçu de formation à l’école d’état major ou à l’école de guerre. De plus, les états-majors des forces de l’ordre et de l’armée ne manipulent ni les mêmes outils techniques ni les mêmes savoirs, ce qui freine considérablement la mise en place d’une stratégie commune. » A cette coordination déficiente s’ajoutent des difficultés de communication entre l’armée d’une part et la police et la garde nationale d’autre part. « Les informations circulent mal et génèrent des malentendus entre les services » pointe un diplomate.
Longue de près de 500 kilomètres, la frontière poreuse qui sépare la Libye de la Tunisie reste par ailleurs extrêmement difficile à contrôler malgré un système de surveillance électronique mis en place en coopération avec l’Allemagne et les Etats-Unis. Plusieurs sources sécuritaires déplorent le manque d’équipement spécialisé aux mains des unités mobilisées dans les zones frontalières tel que des hélicoptères capables d’effectuer des vols de nuit. Dans les cercles politiques, beaucoup pointent le soutien financier insuffisant apporté les pays occidentaux pourtant visés par le terrorisme.
Du côté des partenaires étrangers, on explique cette réticence à accroitre l’aide apportée à la Tunisie par l’absence d’une vision claire de la doctrine et des objectifs stratégiques de l’Etat. La publication et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme pourrait inciter les partenaires étrangers à augmenter le montant et la qualité de leur aide technique. La prise en compte des fondements socio-économiques du phénomène terroriste et l’inclusion d’un volet préventif permettrait par ailleurs d’éviter une approche fondée sur « le tout sécuritaire ».
La nostalgie Ben Ali
Autre frein à l’efficacité de la lutte contre le terrorisme : le brouillage des compétences entre le président de la République et le premier ministre. De fait, la Constitution ne fixe pas clairement les responsabilités respectives des deux têtes de l’exécutif dans le domaine sécuritaire. Or, comme le rappelle le rapport d’ICG, « sous le gouvernement dit de « technocrates » de Mehdi Jomaa (janvier 2014-février 2015) le partage des tâches sécuritaires entre les chefs de l’Etat et du gouvernement allait de soi. Les principales forces politiques s’étaient mises d’accord pour marginaliser le président de la République Moncef Marzouki. La cellule de crise présidée par Jomaa avait mis de côté le Conseil national de sécurité de la présidence de la République. »
L’arrivée au pouvoir de Béji Caïd Essebsi fin 2014 a radicalement changé la donne. Désireux de « présidentialiser » le régime, le nouveau chef de l’Etat nomme un premier ministre sans envergure qui lui laisse les coudées franches en matière de sécurité. Une manoeuvre qui s’avère jusqu’à présent largement infructueuse. Comme le rappelle ICG, « il (Béji Caïd Essebsi) n’a pu (…) être à la hauteur de ses ambitions en matière de coordination interministérielle sur le plan sécuritaire. » Présenté au départ comme un instrument d’accélération des décisions dans ce domaine, la prise en main du dossier sécuritaire par le chef de l’Etat a subi de plein fouet l’explosion du parti présidentiel Nidaa Tounes, qui, miné par des guerres intestines, a perdu la majorité à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Résultat, la gouvernance publique, y compris en matière de sécurité, manque profondément de cohérence.
A cet éclatement du pouvoir répondent aujourd’hui deux tentations. D’abord celle d’une hyper-présidentialisation du régime, un appel à « l’homme fort » né d’une certaine nostalgie des anciens régimes d’Habib Bourguiba voire de Ben Ali. Ensuite, celui d’une réforme constitutionnelle donnant au chef de gouvernement une plus grande capacité d’initiative. Dans le contexte actuel de demande de retour à l’ordre, celle-ci risque toutefois, note le rapport d’ICG, « de s’orienter vers la concentration des pouvoirs entre les mains d’un chef charismatique ».
A l’épreuve du terrorisme, la société et le pouvoir tunisiens restent, plus que jamais, pris entre deux feux contradictoires : le désir d’un retour à l’ordre ancien et la volonté de préservation les acquis démocratiques du « printemps arabe ».