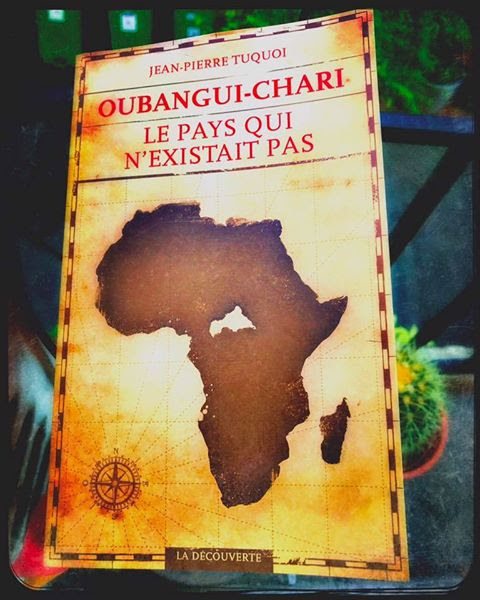Dans son ouvrage « Oubangui-Chari, le pays qui n’existait pas » l’ancien journaliste au Monde Jean-Pierre Tuquoi retrace plus d’un siècle d’histoire oubliée de cette ancienne colonie française si mal aimée. Un ouvrage rigoureux et nécessaire qui éclaire, au prisme du passé, l’actualité brûlante d’un pays en lambeaux vivant sous perfusion de la communauté internationale.
« Fantôme d’Etat », « fantôme de pays » dont la capitale n’a pas de musée et le registre de statistiques pas de données, la République centrafricaine a la mémoire trouble. La vérité de son histoire, elle, est limpide. En un peu plus d’un siècle, l’ancien Oubangui-Chari, territoire enclavé au cœur du continent, est passé d’une colonie mal aimée à un « quasi-protectorat » qui ne dit pas son nom. Cette histoire oubliée, l’ancien journaliste au Monde Jean-Pierre Tuquoi en déroule les épisodes passionnants, souvent violents, à travers les récits d’explorateurs, de missionnaires chrétiens, d’administrateurs coloniaux et de personnalités politiques centrafricaines.
Horreur coloniale
Les détails inédits extraits de ces archives et témoignages jettent une lumière crue sur quelques uns des pires volets de la colonisation et de ses conséquences sur « les corps et les âmes en Afrique ». A l’image des résumés sordides rapportés dans les écrits dépoussiérés d’un missionnaire capucin au sujet de l’expédition punitive menée dans le nord-ouest du pays par le lieutenant Duquenne en 1919. « En deux mois, Duquenne et ses deux cents tirailleurs (…) sèment la terreur dans la région de Bocaranga, encerclent des villages, capturent les chefs les attachent à des poteaux et les fusillent devant leur famille horrifiée, en égorgent d’autres, donnent la chasse aux habitants, coupent des têtes qu’ils emportent plantées sur des piquets (…) enfument les grottes pour faire sortir ceux qui s’y sont réfugiés et les tuent à coups de fusil à la sortie. (…) Aucun historien, aucun chercheur n’a travaillé sur ce dossier ».
Tortueuses, omniprésentes, les relations avec la France rythment le destin du pays sous des formes mouvantes qu’incarnent de sinueux personnages aux destinées hors du commun. Les périlleuses expéditions de Jean-Baptiste Marchand, Pierre Savorgnan de Brazza ou encore Emile Gentil qui entreprend la périlleuse remontée du fleuve Congo à bord d’un bateau à vapeur, ouvriront la voie à un marchandage territorial tous azimuts entre puissances européennes.
L’absurdité de ce Monopoly à grande échelle atteint son apogée en 1911 lorsque la France fait don d’un morceau d’Oubangui à l’Allemagne contre la garantie qu’au Maroc, « ils laisseront la main libre aux Français ». A l’époque, le dédain pour cette colonie « poubelle », lointaine, marécageuse « dont il n’y a rien à attendre hormis un peu d’ivoire et de caoutchouc » la transforme en une monnaie d’échange avec d’autres puissances coloniales. A défaut, les portes s’ouvrent en grand pour une myriade de sociétés anonymes qui « exploiteront au sens littéral du terme, le pays et ses habitants en toute impunité, avec la bénédiction des autorités ».
Boganda, l’homme qui marchait sur l’eau
Le vent des autonomies auquel succèdera celui des indépendances fait émerger une personnage hors du commun : Barthélémy Boganda, le père de l’indépendance de la République Centrafricaine. Jeune prêtre devenu député d’un pays où l’Eglise a une influence colossale, il portera jusque sur les bords de la Seine et à la tribune du Palais Bourbon les espoirs d’émancipation des Noirs de l’Oubangui. Les discours de cet homme visionnaire sur l’avenir de l’Afrique reflètent les idéaux qui nourrissent l’élan de libération qui bourgeonne à l’époque. Au coeur des années 1950, celui à qui l’on prête le pouvoir d’avoir marché sur l’eau devant le général De Gaulle rêve d’un grand ensemble comprenant l’Angola, le Cameroun, le Rwanda, le Burundi et une tranche du Congo belge : les « Etats-Unis de l’Afrique latine ». Sa mort précipitée dans un accident d’avion ne fera place qu’à de bien médiocres successeurs mus par les sirènes du pouvoir et l’appât du gain.
Caricature de la Françafrique
La France, qui tantôt soutient ces leaders tantôt les désavoue, ne cessera, après l’indépendance, de peser sur les évènements que traverse son ancienne colonie. « Quoi qu’il se passe dans le pays, la France n’est jamais loin et pas seulement pour assurer les fin de mois de l’Etat. Ses fonctionnaires sont installés à la présidence. Ses entreprises contrôlent l’embryon d’économie nationale. Dans aucune autre de ses anciennes colonies, ses militaires ne sont intervenus aussi fréquemment pour, selon les circonstances, se débarrasser d’un chef d’Etat, en remettre un autre en selle, mater une rébellion, jouer les arbitres, éviter un bain de sang, etc. Huit opérations au bas mot depuis l’indépendance (…). » C’est bien grâce au soutien de la France que David Dacko, candidat apprécié pour ses positions anti communiste, se retrouve parachuté la tête de l’Etat à la suite de Boganda dont il est le neveu. Paris conserve alors un millier de militaires cantonnés dans le pays. « Les plus proches conseillers de Dacko sont des Français. Le M. Services secrets envoyé par Paris pour avoir un oeil sur tout occupe le plus officiellement du monde un bureau à la présidence. »
Suivront parmi les plus célèbres et les plus ahurissant épisodes de l’histoire de la « Françafrique ». Le putsch de Jean-Bedél Bokassa auquel la France de De Gaulle s’abstient de réagir précède l’inénarrable cérémonie de couronnement impérial du chef de l’Etat financée au titre de la coopération française sous Giscard d’Estaing. Quand les massacres du leader sanguinaire contre sa propre population s’intensifient, Paris n’hésite pas à faire ramener Dacko sur le devant de la scène par les homme du SDECE, les services secrets. En coulisses, l’ancienne puissance coloniale continue de donner le la sous le règne d’André Kolingba à travers le lieutenant-colonel Jean-Claude Mantion. Officier de la DGSE, cet homme de confiance du président tirera les ficelles au point de devenir un véritable « chef de l’Etat bis ». Pourtant élu démocratiquement après un scrutin considéré comme transparent, Ange-Félix Patassé bénéficiera lui aussi de l’intervention des militaires Français pour calmer des mutineries qui éclatent à Bangui en 1996. Le putsch de son successeur, François Bozizé, soutenu par le président tchadien Idriss Déby mettra finalement un terme à une décennie de ce règne marqué par l’affairisme crapuleux.
« Quasi protectorat »
Difficile, voire impossible d’identifier les retombées positives héritées de cette accablante frise chronologique. Après des élections qui passent l’éponge sur son coup d’Etat en 2005, Bozizé arrive à la tête d’un pays au fond du gouffre. L’homme n’a guère les épaules pour s’y atteler. « Que ce soit l’espérance de vie, l’indice du développement humain ou n’importe quel autre indicateur, le pays affiche de résultats pitoyables ». C’est aujourd’hui toujours le cas.
Au nord, une rébellion s’éveille en 2012 portant le nom de Séléka et soutenue en sous-main par le président tchadien Idriss Déby contre son propre poulain Bozizé. Après s’être ingérée sans limite dans les affaires d’une ancienne colonie déconsidérée, la France anticipe mal la dégradation de la situation et ne prend pas partie. « A Bangui, ni les militaires ni les diplomates français n’anticipent la tempête qui va s’abattre sur la capitale. » Après tant d’immixtions infructueuses, l’envoi tardif des militaires française de l’opération Sangaris avec le feu vert de l’Onu interroge : « l’ancienne puissance coloniale fait-elle partie de la solution ou du problème? » D’autant que depuis le départ de l’essentiel des troupes françaises, les flambées de violences continuent à ensanglanter le pays jusque dans la capitale. Incapable de relever l’Etat effondré, la classe politique porte une grande responsabilité dans le naufrage du pays depuis des décennies. Malgré l’élection porteuse d’espoir du nouveau président Faustin Archange Touadéra, la Centrafrique continue à vivre sous la tutelle des bailleurs de fonds, des ONG et de l’Onu. Sans signe notable d’amélioration.
Nécessaire, l’ouvrage de Jean-Pierre Tuquoi agit comme une loupe posée sur le présent d’un pays dont l’actualité brûlante rapportée dans les médias n’est aujourd’hui examinée qu’à travers le prisme des conflits qui la submergent. Eclairant.