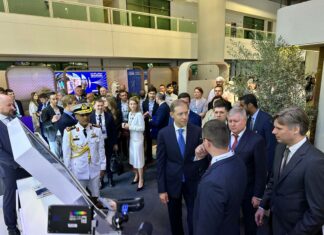Alors que le coup d’état du président Kais Saied qui vient d’organiser, ce dimanche, un deuxième tour d’élections législatives totalement contesté,a mis fin au formidable laboratoire démocratique que fut la Tunisie depuis dix ans, Mondafrique revient sur ce 14 janvier 2011 qui vit le président Ben Ali, décédé en 2019, prendre la fuite vers l’Arabie Saoudite.
La révolution tunisienne n’est pas seulement le fruit d’une mobilisation populaire exceptionnelle. Le 14 janvier 2011, personne ne s’attendait au départ précipité de l’ex-président Ben Ali. La défection d’une partie de ses proches a donné un sérieux coup de pouce au printemps tunisien.
Le 17 décembre 2010, un jeune marchand ambulant de fruits et légumes giflé par une policière, Mohamed Bouazizi, s’immole par le feu à Sidi Bouzid, une bourgade éloignée de Tunis de deux cent quarante kilomètres, mais à mille lieues de la vitrine touristique des villes côtières. À peine un mois plus tard, le 14 janvier 2011, le président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali quitte précipitamment le sol tunisien et se réfugie en Arabie saoudite. Le dictateur y est accueilli par son ami le prince Nayef, feu le ministre de l’Intérieur du royaume qui fut longtemps un grand adepte de la chasse au sanglier dans les forêts tunisiennes d’Aïn Draham. En moins d’un mois, les mobilisations populaires ont enflammé Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid, Béja, ces villes oubliées de la Tunisie de l’intérieur. Une mythologie est née, celle du printemps arabe.
En cette fin de décembre 2010, personne ne pressent vraiment la fin du règne de Ben Ali. Cinq jours après l’immolation de Mohamed Bouazizi, le chef de l’État et sa famille s’envoleront d’ailleurs pour Dubaï, une des destinations prisées par le clan présidentiel qui aime les galeries marchandes et les pièces d’eau de cet émirat en trompe-l’œil, artificiel et luxueux. Si ces vacances de Noël avaient été reportées de quelques jours, cela n’avait rien à voir avec l’immolation de Bouazizi, un non-événement à l’époque. Le changement de date était dû à la convalescence de Leila Trabelsi, l’épouse toute-puissante du président Ben Ali, qui se reposait d’une intervention de chirurgie esthétique réalisée quelques jours plus tôt dans la clinique aménagée dans le palais présidentiel de Sidi Dhrif.
À son retour de Dubaï le 28 décembre 2010, le président Ben Ali ne prend pas immédiatement la mesure des périls encourus et donne des instructions de grande fermeté. Début janvier 2011, la presse étrangère, qui ignore tout de la situation des villes rebelles de l’intérieur du pays, relaie à peine l’existence des troubles contre le pouvoir en place. Après tout, la classe politique française a voulu croire pendant vingt-trois ans que Ben Ali était le rempart contre la menace intégriste. Pourquoi changer de doctrine pour quelques jacqueries dans la Tunisie profonde ? Les troubles se poursuivant, le président Ben Ali tente ensuite de négocier avec les forces vives du pays. Les patrons du grand syndicat tunisien, l’UGTT (Union générale tunisienne du travail), qui fut depuis toujours un formidable contre-pouvoir aux régimes autoritaires de Bourguiba et de Ben Ali, ainsi que les principaux chefs des partis d’opposition, sont reçus au palais de Carthage. Même le chef du mouvement islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi, alors encore en exil à Londres, demande à son fidèle lieutenant, Hamadi Jebali, qui deviendra Premier ministre après l’élection de l’Assemblée nationale constituante d’octobre 2011, de rencontrer le président Ben Ali. Depuis 2008, en effet, des passerelles ont été jetées entre la mouvance islamiste et le pouvoir tunisien. Pratiquement tous les dirigeants d’Ennahdha ont été libérés lorsqu’éclate la révolte de décembre 2010 et beaucoup d’autres sont rentrés d’exil. Face à un peuple de plus en plus islamisé, le régime de Ben Ali aura eu l’intelligence politique, en toute fin de règne, de tenter un compromis avec les opposants « intégristes » de toujours. Personne ne veut jouer la politique du pire.
Nombreux en revanche sont les fidèles du régime, militants au Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), le parti au pouvoir, ou membres de la technostructure, à l’origine des performances économiques tunisiennes, qui souhaiteraient voir le chef de l’État se démarquer des clans familiaux, les Trabelsi et les Materi notamment, qui ont fait main basse sur le pays. Mais un Ben Ali faible face à son épouse, Leila Trabelsi, une intrigante devenue la véritable « régente de Carthage[1] », hésite à remettre de l’ordre dans son entourage. On verra, en ce début janvier, un Mohamed Sakhr el-Materi, l’un des gendres de Ben Ali et son dauphin désigné, expliquer sans complexe aux députés l’Assemblée nationale qu’il rachète la société Tunisiana pour un milliard de dinars, grâce à des prêts de la Banque centrale. Le pays brûle, mais le pillage continue !
Le mercredi 12 janvier, le ministre de l’Industrie, le technocrate moderniste Afif Chelbi, est reçu par le Premier ministre, Mohamed Ghannouchi, dont il est très proche : « Le gouvernement, lui explique-t-il, doit démissionner afin de ne pas endosser toutes les exactions commises. » Interpellé, le Premier ministre désigne du doigt le portrait de Ben Ali qui trône dans son bureau. Sortant ensuite de la pièce pour ne pas être écouté, il entraîne son ministre dans les escaliers attenants et, là, lui murmure : « Laisse-moi une semaine, tu verras… »[2]. Deux jours plus tard, le 14 janvier, la messe est dite. Le gouvernement n’a pas démissionné, mais le régime s’est effondré. Le ver était-il déjà dans le fruit ? Certains fidèles du régime avaient-ils déjà fait une croix sur le président Ben Ali ?
En s’exprimant à la télévision le jeudi 13 janvier au soir, veille de son départ, l’ex-président fait preuve à nouveau d’une certaine habileté tactique. Dans ce « je vous ai compris » gaullien concocté par quelques communicants en vue comme Jacques Séguéla, il donne des gages à la rue tunisienne. Le chef de l’État promet en effet trois cent mille emplois, de libérer les réseaux sociaux et d’écourter son mandat, qui ne devrait pas se prolonger au-delà de 2014. Demain à Tunis, assure-t-il, on rasera gratis… Tard dans la soirée, l’ambassadeur de France, Pierre Ménat, connu pour son goût pour le karaoké et sa complaisance vis-à-vis du clan au pouvoir, signe un télégramme diplomatique particulièrement optimiste pour le régime en place[3]. « Ben Ali reprend la main, explique le diplomate en substance, seuls les casseurs manifestent à Tunis et pas question d’émettre la moindre critique qui aiderait les “durs” du régime. » L’essentiel du télégramme de l’ambassadeur se retrouvera, grâce à une fuite organisée, dans le journal Le Monde daté du vendredi 14 janvier, au moment précis où le président tunisien monte justement dans l’avion pour quitter la Tunisie… Mauvaise pioche !
À la décharge de cet ambassadeur de France, qui poursuivra d’ailleurs une belle carrière au Quai d’Orsay, l’immense majorité des Tunisiens n’avait pas imaginé, un seul instant, un tel dénouement. Rien en effet ne laissait présager, ce vendredi 14 janvier, un départ aussi soudain. Dans la matinée, Ali Seriati, chef de la garde présidentielle depuis onze ans et homme de confiance du Palais, fait un point sur la situation pour Ben Ali.
– Le nombre des morts s’élève à vingt-huit, lui indique-t-il, des appels à une grande manifestation se multiplient dans les réseaux sociaux pour demander la chute du régime.
– Ne publiez surtout pas, répond un Ben Ali très présent, le chiffre des victimes[4].
Durant la manifestation du 14 janvier à Tunis, le ministre de l’Intérieur nommé deux jours auparavant en signe d’apaisement, l’universitaire pondéré Ahmed Friaâ, lance bien quelques messages alarmistes à la présidence. Du type : « La situation dégénère », « Les manifestants s’accrochent aux fenêtres, que faire ? ». Mais il en aurait fallu bien d’avantage pour déstabiliser un général Ben Ali qui, dans sa longue vie de militaire et de sécuritaire, a maté plus d’une révolte. Cette fois-ci, la mobilisation de la rue est singulièrement calme : pas un mort, pas un blessé et pas même une balle tirée. « La Révolution était une immense vague, sans leader, sans parti, sans référence, et de surcroît d’une grande banalité dans ses mots d’ordre : plus de justice, plus de liberté, plus de démocratie. Mais le départ de Ben Ali, le fameux vendredi 14 janvier, fut totalement fortuit », résume le constitutionnaliste Yadh Ben Achour, ex-doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis[5].
« Fortuit », en effet… De nombreuses questions se posent sur le départ précipité du président et des siens. Or la vérité qui apparaît aujourd’hui est plus complexe que l’épopée révolutionnaire qui fut saluée dans le monde entier. Certains dignitaires du régime défunt ont clairement joué, dans les coulisses, contre leur camp. L’histoire du printemps tunisien où un peuple en colère chasse le tyran a été largement réécrite. Quatre ans plus tard, les témoins commencent à s’exprimer, des accusations prennent corps et des acteurs sont désignés. Peu à peu, la journée mémorable du 14 janvier 2011, date de la fuite du président Ben Ali, livre ses secrets. Sur fond encore d’amnésie dans un pays privé de toute liberté d’expression depuis l’indépendance. Qui a joué le rôle du traître ? Quelle était l’étendue du complot au sein du sérail ?
Au centre des interrogations, l’armée tunisienne ne livre pas volontiers ses secrets sur son rôle exact, notamment après le départ de Ben Ali, lorsque de mystérieux snipers tirent sur la foule, causant plus de morts qu’il n’y en a eus jusqu’à la fuite du chef de l’État. Le rôle des militaires est désormais essentiel dans la lutte contre le péril djihadiste et la défense des frontières. L’armée tunisienne est sanctuarisée, inatteignable.
Il ne fait aucun doute que la chute du régime a été accélérée par une intox savamment distillée qui a provoqué une panique grandissante au palais de Carthage. Durant les derniers jours du règne de Ben Ali, les rumeurs les plus folles courent à Tunis. Deux jours avant la fuite en Arabie saoudite, le président Ben Ali s’adresse au général Ali Seriati : « Est-il vrai qu’il y aurait une taupe au sein de la présidence[6]. » Le lendemain, des services de renseignement amis, notamment français, font passer des messages, via Marouane Mabrouk, l’un des gendres de Ben Ali, sur le « complot » fomenté par une partie de l’entourage présidentiel. Le jeudi dans la soirée, des groupes d’individus masqués s’en prennent aux demeures appartenant aux clans familiaux dans les riches banlieues de Carthage et de Gammarth. Le vendredi, des hélicoptères non identifiés survolent le palais de Carthage. Plus tard, on annonce qu’un bateau de la garde nationale aurait aperçu deux vedettes mystérieuses dans les eaux territoriales tunisiennes. Autant d’indications, vraies ou fausses, qui créent un début de panique, notamment chez les proches de Leila Trabelsi, les plus exposés parce qu’unanimement détestés.
Inquiets pour leur survie, dix-sept membres de ce clan prédateur cherchent à gagner l’aéroport pour quitter le pays. Au palais de Carthage, le général Seriati, muni de trois portables qui ne cessent de sonner, distribue des passeports à tour de bras. On assiste à la fuite de Varennes, version tunisienne.
À la fin de la matinée, le général Rachid Ammar, le chef d’état-major de l’armée de terre, arrive à la salle d’opération du ministère de l’Intérieur pour prendre lui-même la direction des forces de sécurité. Ce militaire est au cœur des interrogations concernant ces journées historiques. Quel rôle a joué le général ? A-t-il précipité le départ d’un Ben Ali qui s’est toujours méfié de l’armée ? Le général Ammar passe pour être fort proche des Américains, dont on connaît, grâce aux télégrammes de WikiLeaks, l’hostilité croissante envers le régime de Ben Ali[7].
Dès le début de l’après-midi, l’état d’urgence est décrété. Le général Ammar, sous l’autorité du ministre de la Défense, Ridha Grira, originaire comme lui de la région du Sahel, devient le seul véritable maître de la situation. « Ce n’est plus notre affaire, mais l’affaire de l’armée », explique le président Ben Ali, relativement rassuré, à son fidèle Seriati[8].
Or à ce moment précis, alors que le pouvoir est reconfiguré au profit de l’armée, se produit l’intervention la plus surprenante et la plus spectaculaire de la journée. Un obscur colonel, Samir Tarhouni, chef de la Brigade antiterroriste qui dépend théoriquement, via le ministère de l’Intérieur, directement de la présidence, prend l’initiative de se rendre à l’aéroport avec douze hommes pour arrêter les Trabelsi en fuite. Ce serait, selon ses déclarations publiques, sa propre épouse, travaillant à la tour de contrôle de l’aéroport, qui l’aurait averti de la présence des fuyards. Comment ce simple exécutant pouvait-il raisonnablement prendre seul une telle initiative ? Le général Ammar peut-il à ce stade ignorer une telle opération de commando ?
Alerté immédiatement de la situation, le président Ben Ali s’en inquiète auprès du ministre de la Défense : « Ce sont des infiltrés intégristes, des terroristes. » Lequel Grira insiste alors auprès du général Ammar pour les éliminer Or le résultat de cette opération coup de poing, le voici : le colonel Tarhouni place les Trabelsi en détention à la caserne militaire de Larouna, sous le contrôle précisément des hommes du général Ammar. Comment ne pas croire à une opération couverte par le haut commandement militaire ?
La panique submerge le palais de Carthage, et le président Ben Ali décide d’accompagner son épouse, Leila, à l’aéroport. Sur le chemin, les informations qui proviennent de la salle d’opération du ministère de l’Intérieur, sous le contrôle du général Ahmed Chabir, chef du renseignement militaire et proche du général Ammar, sont de plus en plus alarmistes. « Cinq mille personnes venant de la commune du Kram se dirigent vers la présidence… [9]» Le général Seriati réussit finalement à convaincre le chef d’État de monter dans l’avion, le temps de rétablir l’ordre et de préparer son retour en Tunisie, tel de Gaulle revenant de Baden-Baden en 1968 après avoir consulté le général Massu.
Le vendredi 14 janvier à 17 h 30, l’avion présidentiel décolle de l’aéroport de Carthage. Tandis que le pilote met le cap sur Djeddah, la télévision nationale tunisienne interrompt brièvement la diffusion d’un reportage sur la robotique. Un présentateur gris et anonyme annonce, sans autre précision, une imminente « adresse au peuple tunisien ».
Dans la mêlée qui s’ensuit, les deux hommes forts du régime défunt vont se livrer une guerre sans merci. D’un côté, le général Rachid Ammar, devenu en vertu de l’état d’urgence l’unique patron des forces de sécurité. De l’autre, le général Ali Seriati, l’ultime confident de Ben Ali qui lui a conseillé, au pied de l’avion, de prendre le large. Alors que le patron de la garde présidentielle se trouve dans le salon d’honneur, le ministre de la Défense donne l’ordre à l’armée de l’air de l’arrêter. Remis à la Sécurité militaire et emprisonné à la caserne militaire de Larouna, le général est transféré, le dimanche 17 janvier, au tribunal de Tunis, où il est inculpé pour « complot contre la sûreté de l’État ». Autant d’accusations qui, à ce jour, n’ont jamais été prouvées, même si un tribunal militaire le condamnera pour sa participation supposée à la répression contre « les martyrs de la Révolution » dans un procès bâclé.
Fidèle d’entre les fidèles, Ali Seriati, en relayant durant les dernières heures des nouvelles alarmistes, aurait-il été manipulé ? C’est ce que prétendent ses proches, notamment son fils[10], en pointant la responsabilité du haut commandement militaire dans les malheurs de son père. Ali Seriati, expliquent ses proches, est le bouc émissaire idéal des exactions commises durant les manifestations sanglantes de janvier 2011, dont les militaires ne sont pas exempts.
Par une pirouette dont l’histoire est coutumière, ni le général Ammar ni le général Seriati ne vont jouer les premiers rôles dans la transition qui s’annonce. Une demi-heure en effet avant la fuite du clan présidentiel, le téléphone sonne chez Abdallah Kallel, un ancien ministre de l’Intérieur en froid avec les Trabelsi, qui avait été nommé, après une disgrâce et sur le tard, président de la Chambre des conseillers, l’équivalent du Sénat en France. « On a besoin de vous, Si Abdallah. » La formule est celle qu’employait généralement le factotum du palais de Carthage quand le président Ben Ali convoquait un ministre ou un proche. Au bout du fil se trouve le colonel Sami Sik Salem, numéro trois bis de la garde présidentielle dirigée par le général Seriati. Voici bien un nouveau rebondissement surréaliste dans cette journée mouvementée. Dans le tumulte général qui suit le départ de Ben Ali, un second couteau, inconnu et désormais seul dans le palais de Carthage déserté, appelle le Premier ministre, Mohamed Ghannouchi, ainsi que les présidents des deux assemblées.
Lorsqu’une Mercedes blanche, escortée par un garde du corps, s’arrête devant la villa d’Abdallah Kallel face au port punique de Carthage, ce dernier ne sait pas au juste pourquoi la présidence le convoque. Parvenu sur place, l’ancien ministre de l’Intérieur découvre le président de l’Assemblée, Fouad Mebazaâ, qui attend assis sur une chaise.
– Pourquoi nous a-t-on convoqués ? demande Kallel.
– Ben Ali s’est enfui, lui répond le colonel Sik Salem, il faut assurer la continuité de l’État.[11]
Le numéro trois de la garde présidentielle a-t-il agi vraiment, comme il l’a prétendu, de sa propre initiative ? En l’absence du général Seriati et du numéro deux de la garde présidentielle, injoignable ce jour-là, le colonel Sik Salem affirme avoir agi seul. Il existe pourtant un autre scénario. Le général Seriati, alors qu’il venait d’être placé en détention par les militaires, avait conservé sur lui son troisième portable, qui lui aurait permis de joindre le colonel Sik Salem. Il est fort possible qu’il l’ait encouragé à lancer le processus constitutionnel, afin d’éviter que le général Ammar prenne le pouvoir et fasse de lui le chef d’un hypothétique complot.
Le colonel Sik Salem est un des rares à connaître les secrets de cette journée historique, mais il refuse de s’exprimer. Et on le comprend. Le 1er février 2014, des militaires sont venus frapper à sa porte pour l’embarquer, les yeux bandés, dans une caserne militaire où il a passé une quinzaine de jours sans égards particuliers. Un avertissement ?
Au palais de Carthage, le 14 janvier, se décide, en moins d’une heure, l’avenir constitutionnel de la Tunisie, lors d’une scène surréaliste. Selon l’article 57 de la Constitution qui porte sur « la vacance du pouvoir », Fouad Mebazaâ devrait assurer les fonctions de président intérimaire. Or ce bourgeois tunisois et bon vivant est connu pour son amour des cigares de qualité et des parties de cartes, mais pas pour sa témérité. « Pas question, proteste-t-il, de me nommer à la présidence, je suis malade et cardiaque[12]. »
La logique constitutionnelle aurait voulu que ce soit le président de la Chambre des conseillers, Abdallah Kallel, qui soit désigné. Mais il a aussi été le ministre de l’Intérieur de Ben Ali. « Pas question », tranche le colonel Sik Salem, décidément très interventionniste, sans autre forme d’explication[13]. Mohamed Ghannouchi propose alors de se rabattre sur l’article 56 de la Constitution qui envisage l’« empêchement provisoire » du chef de l’État et confie dans ce cas l’intérim au chef du gouvernement. Seul souci, le président du conseil constitutionnel peut seul déclencher cette procédure. Mais, ce jour-là où l’histoire est en marche, cet homme est lui aussi introuvable. Peu importe, Mohamed Ghannouchi impose cette solution de fortune qui fait de lui le gardien du temple. Immédiatement, cet homme qui a servi Ben Ali pendant vingt ans sort de sa poche un papier où figure, sans une rature, l’intervention qu’il avait déjà préparée avec ses conseillers durant le court trajet qui l’a mené de la Kasbah, siège de la primature, au palais de Carthage. Un motard dûment escorté livre la cassette d’enregistrement à la télévision nationale.
À peine l’allocution diffusée, le téléphone sonne au palais de Carthage. Un garde passe le combiné à Mohamed Ghannouchi. « Le président de la République est en ligne. » Un Ben Ali furieux, en route vers l’Arabie saoudite, hurle :
– Mais qu’avez vous fait ? Démentez tout, annoncez-leur que mon départ du pouvoir est une erreur.
– Nous avons choisi d’appliquer l’article 56, répond un Ghannouchi obséquieux, vous êtes toujours président. Revenez quand vous le souhaitez.
Les vieux réflexes de courtisans n’ont pas disparu en quelques heures.
– Vous êtes le bienvenu, déclare Fouad Mebazaâ à Ben Ali avant de passer le combiné à Abdallah Kallel.
Mais la communication est interrompue, le téléphone sonne à nouveau.
– Si Abdallah, je vais revenir. Où se trouve le général Seriati ?
– Il n’est pas présent, lui répond Kallel, il est arrêté et nous sommes retenus contre notre gré.
– Ah oui ? se contente de conclure un Ben Ali en état de choc qui raccroche[14].
Au palais de Carthage, les trois hommes, Ghannouchi, Mebazaâ et Kallel, se dirigent alors vers la sortie. Les gardes les arrêtent : « Ne sortez pas ! » Le colonel Sik Salem appelle le général Ammar, via une ligne téléphonique sécurisée de la présidence, et le passe au président de la Chambre des conseillers. « Monsieur Kallel, vous êtes libres, vous n’êtes le prisonnier de personne, lui explique le militaire, vous pouvez partir. »
Alors qu’il quitte les lieux, Mohamed Ghannouchi est rappelé par le général Ammar : « Oui, très bien, ce sera fait, répond-il, Monsieur le président. » Un simple lapsus ? Ou la preuve que le général Ammar est bien le maître de la situation ? Mais, dans une telle hypothèse, pourquoi ce militaire soutenu par les Américains n’a-t-il pas cherché à prendre le pouvoir ? Aurait-il préféré rester dans l’ombre, le temps de se fabriquer une image de général courageux, qui aurait refusé, malgré les ordres de Ben Ali, de tirer sur la foule ? « L’homme qui a dit non », titre l’hebdomadaire français Jeune Afrique. Étrangement, les principaux acteurs de cette journée historique, Mohamed Ghannouchi et son plus proche conseiller, l’ancien Premier ministre Hédi Baccouche, le ministre de la Défense et le général Ammar, sont tous du Sahel, la région la plus riche de Tunisie d’où sont originaires les présidents Bourguiba et Ben Ali, et qui fournit à la nation tunisienne ses plus hauts cadres. « Le 14 janvier est un complot des sahéliens », tranche Ahmed Bennour, un homme d’État qui fit ses classes sous Bourguiba comme secrétaire d’État à la défense et à l’intérieur avant de devenir un opposant à Ben Ali[15].
Le 14 janvier au soir, les rumeurs de coups d’État enflent, les snipers tirent sur la foule depuis les toits de Tunis et la situation devient incontrôlable. Tard dans la soirée, le général Ammar reçoit sur son portable un coup de fil de Ben Ali :
– C’est le Président. Quelle est la situation dans le pays ? Est-ce que vous la contrôlez ? Puis-je revenir ce soir ?
– Je ne peux rien vous dire, la situation n’est pas claire, répond Ammar.
– Alors je vous rappellerai demain, mon général, conclut celui qui est encore chef de l’État[16].
Le lendemain, celui qui fut le maître de la Tunisie
pendant vingt-trois ans ne rappellera pas le général Rachid Ammar. Les
Saoudiens l’ont incité à une certaine réserve, s’il voulait bénéficier encore
longtemps avec son épouse Leila et leur jeune fils Mohamed de leur généreuse
hospitalité.
[1]. Cf. Nicolas Beau et Catherine Graciet, La Régente de Carthage, La Découverte, 2009.
[2]. Entretien d’Afif Chelbi avec l’auteur, Tunis, février 2014.
[3]. L’ambassadeur de France sera particulièrement absent lorsqu’il s’agira de soutenir le moral de la communauté française quand les troubles éclateront à Tunis.
[4]. Entretien de Samir Seriati, fils d’Ali Seriati, avec l’auteur, Tunis, avril 2014.
[5]. Entretien avec l’auteur, Tunis, février 2014.
[6] Entretien de l’auteur avec Samir Seriati, avril 2014, Tunis
[7]. Robert F. Godec, l’ambassadeur américain à Tunis durant les dernières années du règne de Ben Ali, recevait volontiers les opposants et se montrait très critique vis-à-vis du régime. Dans les télégrammes diplomatiques révélés par WikiLeaks et signés par ce diplomate, il est question de « l’entourage quasi mafieux » du président tunisien. De retour au Département d’État à Washington en 2010, Robert F. Godec est promu à la tête de la cellule de lutte contre le terrorisme. C’est dire que la religion que se sont faite du régime les Américains n’a pas changé durant les journées révolutionnaires de décembre 2010 et janvier 2011.
[8]. Entretien de Samir Seriati avec l’auteur, Tunis, avril 2014.
[9] Entretien de l’auteur avec un « sécuritaire » tunisien, avril 2014, Tunis
[10]. Entretien de Samir Seriati avec l’auteur, Tunis, avril 2014.
[11] Entretien de l’auteur avec Abdallah Kallel, février 2014, Tunis
[12]. Entretien d’un proche de Fouad Mebazaâ avec l’auteur Tunis, février 2014.
[13]. Entretien d’Abdallah Kallel avec l’auteur Tunis, février 2014.
[14]. Entretien d’Abdallah Kallel avec l’auteur Tunis, février 2014.
[15]. Entretien avec l’auteur, Paris, juin 2014.
[16]. Cet échange savoureux est rapporté par l’hebdomadaire Jeune Afrique, dont les récits de ces journées historiques auront été particulièrement complets et précis.