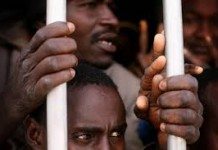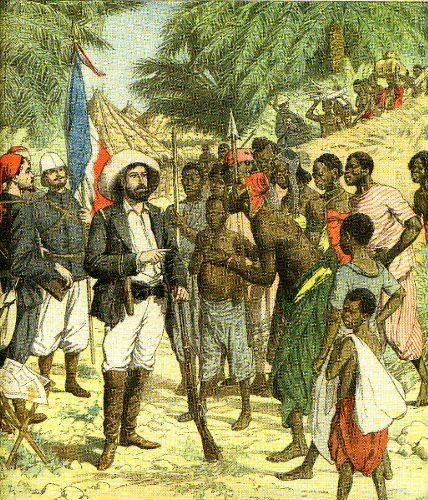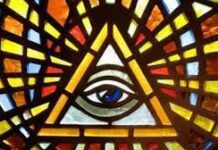Le verdict d’une sévérité implacable rendu samedi dans « l’affaire du complot » au terme d’un procès expéditif et sur la base d’une non enquète , condense tous les travers de la présidence de Kaïs Saïed.
Selim Jaziri
Tunisie, Bernard Henri Lévy condamné à 33 ans de prison dans un procès stalinien
Des exécutions judiciaires au terme d’un procès expéditif. C’est ainsi que l’on pourrait résumer le verdict rendu samedi avant l’aube, dans l’affaire dite « du complot ». Les peines prononcées s’abattent en effet comme un couperet sur les quarante accusés de ce qui a été décrit au terme de l’instruction, comme une « un complot contre l’État tunisien et le régime actuel en le faisant chuter par la force avec l’aide d’États étrangers ».
Une machine à broyer
Cette conjuration, selon l’accusation, aurait associé deux composantes : l’une, « terroriste », cherchant à mobiliser des armes et des mercenaires en vue d’une action violente, dirigée par l’homme d’affaires Kamel El Taïef, l’autre « complotiste », consistant à coaliser les opposants à Kaïs Saïed et à obtenir des appuis étrangers, dirigée par Khayam Turki. La cohorte des accusés est un assemblage hétéroclite, mêlant des opposants avérés à des personnalités sans relation avec les autres, comme Nadia Akacha, ancienne directrice de cabinet de Kaïs Saïed jusqu’à sa disgrâce en janvier 2022, ou Bernard Henry Levy, ajouté à la liste pour accentuer le caractère complotiste de l’affaire.
Kamel El Taïef écope de 66 ans de prison et Khayam Turki, de 48 ans. Noureddine Bhiri, ancien cadre du parti Ennahdha, accusé d’avoir été chargé d’activer les « cellules dormantes » islamistes au profit du « complot », en prend, lui, pour 43 ans. Les personnalités mises en cause dans l’aspect politique de l’affaire, sont condamnées à des peines allant de 8 à 18 ans de prison. Les accusés réfugiés à l’étranger, dont la militante féministe Bochra Belhaj Hmida, ou le militant des droits de l’homme Kamel Jendoubi, se sont vus appliquer une peine automatique de 33 ans.
Enfin, Slama Hattab, vendeur de voitures d’occasion dont l’un des véhicules s’est trouvé stationné à proximité du domicile de Khayam Turki au mauvais moment, a été condamné à quatre ans, alors même qu’aucun lien n’a été établi avec les autres accusés. Après deux ans de détention préventive, il pourra peut être obtenir une remise de peine, mais son cas illustre ce qui aura caractérisé ce procès : des accusations sans fondement, des détentions abusives, un refus de se dédire, à l’image de la rigidité de Kaïs Saïed, incapable de reconnaître ses erreurs, ni de tolérer la critique, et au final une machine à broyer des destins.
Un festival d’irrégularités
Les régimes d’Habib Bourguiba (1956-1987) et de Zine el Abiddine Ben Ali (1987-2011) n’ont pas été avares de procès politiques, mais au moins avaient-ils le souci du formalisme juridique. Le juridisme étant une ressource de légitimité centrale des régimes destouriens. Mais dans cette affaire, signe que le Droit n’a plus qu’une valeur instrumentale, la Justice ne s’est pas encombrée de ces scrupules. La liste des irrégularités et des incohérences de procédures serait trop longue à dresser ici, mais on peut en résumer les principales étapes.
Au point de départ, l’accusation a précédé l’enquête, puisque l’existence d’un prétendu complot a été signalée, en dehors de toute procédure légale, par un courrier du directeur de la police judiciaire (destitué depuis pour son implication dans une affaire de trafic d’influence) à la ministre de la Justice, le 10 février 2023, suivie, dès le 13 février, du début d’une vague d’arrestations. Le 14 février, Kaïs Saïed avait déjà scellé le sort des accusés, qualifiés de « terroristes » : « L’histoire a prouvé qu’ils étaient des criminels bien avant que les tribunaux ne le fassent », et d’ajouter quelques jours plus tard « quiconque oserait les disculper se ferait leur complice ». A quoi bon, dès lors, s’embarrasser d’une enquête et d’un procès ?
Le 4 mars 2023, l’Association des Magistrats tunisiens a d’ailleurs dénoncé les menaces et les intimidations exercées sur les juges, par le président de la république Kaïs Saïed et par ses partisans sur les réseaux sociaux.
Les témoignages « spontanés » venant étayer l’accusation ont été recueillis après coup, auprès de témoins officiellement anonymes, mais identifiés depuis, et dont la bonne foi et les motivations sont pour le moins douteuses. L’instruction s’est contentée de les intégrer sans chercher à les vérifier. Pour l’essentiel, l’enquête s’est limitée à explorer le contenu des ordinateurs et les téléphones des suspects pour tisser une trame en reliant une série de points dans une interprétation discutable. Durant leur détention préventive, prolongée au-delà du délai légal de quatorze moi, les accusés n’ont jamais eu la possibilité de s’expliquer devant le juge d’instruction.
Une fois sa tâche accomplie, celui-ci a préféré chercher une meilleure opportunité professionnelle au Qatar. Ce qui lui vaut d’être à son tour accusé de « complot la sûreté de l’État ».
Les trois audiences du procès, le 4 mars, les 11 et 18 avril, se sont tenues en l’absence des accusés. Ils ont refusé de comparaître en visio-conférence et de cautionner ainsi une décision qui détourne une procédure adoptée pendant la crise du Covid, permettant sous condition de juger en son absence en son absence. Six accusés avaient mené une grève de la faim avant l’audience du 11 avril, pour exiger d’être présents à l’audience. En vain. Dans ces conditions, leurs avocats ont décidé de ne pas plaider sur le fond mais de soulever les défauts de procédures.
La composition de la chambre criminelle en charge du dossier a été attaquée puisqu’elle a été constituée par simple note administrative émise par la ministre de la Justice, alors que les juges doivent être désignés selon des mécanismes indépendants garantissant l’impartialité de la justice. Ce recours a été ignoré. Ridha Belhaj, ancien conseiller politique de Béji Caïd Essebsi, a même accusé lors de l’audience du 18 avril, par l’intermédiaire de son avocat, le président de la cour d’avoir touché un pot-de-vin de 1,2 million de dinars en 2017 pour faire libérer un terroriste.
Le pourvoi en Cassation de Kamel Jendoubi, Noureddine Ben Ticha et Ridha Chaïbi qui contestaient l’ensemble de l’acte d’accusation, qui devrait avoir un effe suspensif, n’a pas été pris en compte. La demande de Kamel Jendoubi et de Ridha Driss, actuellement en France, d’être entendus en visio-conférence, n’a pas été acceptée.
Enfin, le public autorisé à assister au procès qui se tenait dans une salle bien trop étriquée pour une affaire de cette ampleur, a été de plus en plus restreint, pour exclure finalement tous les observateurs extérieurs.
Au terme de trois audiences consacrées aux questions de procédures écartées par les juges, la cour s’est retirée après la lecture de l’ordonnance de renvoi interrompue après 30 secondes pour délibérer, sans audition des inculpés, sans réquisitoire, ni plaidoiries. Elle a fait connaître par la voie d’une dépêche d’agence à 5 heures du matin, un verdict probablement dicté par le Chef de l’État, pressé d’en finir avec ce procès qui porte sa marque de bout en bout.
Un acte de pouvoir
Kaïs Saïed n’a même pas cherché à donner au procès de ce « complot », pourtant central dans son récit d’une Tunisie sapée de l’intérieur par des corrompus et des agents des ingérences étrangères, la théâtralité d’un procès stalinien, censé conforter le pouvoir en montrant sa capacité à amener l’accusé aux aveux ou au contraire à mettre en scène sa déchéance afin d’impressionner les masses dans un geste purificateur.
Le style Kaïs Saïed, au contraire, est tout d’obscurité. C’est au cœur de la nuit qu’il annonce régulièrement les décisions qui façonnent le régime qu’il veut instituer : la proclamation des pouvoirs exceptionnels le 25 juillet 2021, le décret du 22 septembre suivant, par lesquels il s’accordait les pleins pouvoirs, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (le 6 février 2022), l’annonce du texte de la nouvelle Constitution (le 30 juin 2022) ou de la loi organisant l’élection des nouvelles institutions locales (le 8 mars 2023), le limogeage des ministres ou le changement de Premier ministre… Même lorsqu’il s’est rendu le 18 avril à Mezzouna, éprouvé par la mort de trois lycéens dans l’éboulement d’un mur quatre jours plus tôt, et dont la population réclamait sa présence, c’est à 4 heures 30 du matin qu’il est allé à la rencontre des habitants qu’il a fallu tirer de leur sommeil (il devait le même jour célébrer les cérémonies d’anniversaire des forces de sécurité nationale).
Loin d’être anecdotique, on peut voir dans cette prédilection pour la nuit la marque d’un pouvoir solitaire effrayé par la confrontation avec le réel, qui brutalise les institutions depuis l’opacité d’un palais présidentiel devenu illisible aux yeux de l’extérieur.
Ce procès clos à la hâte et en catimini, par un verdict nocturne est à l’image du saïedisme : un acte de pouvoir plutôt que de justice, animé par des passions négatives.
Un agencement délétère
C’est la tragédie de ce nouveau moment de la trajectoire politique tunisienne : alors que la prise de pouvoir par Kaïs Saïed, lors de son élection en 2019 et plus encore en juillet 2021, a été accueillie dans l’espoir d’un second souffle (mais aussi par certains, il est vrai, avec la joie mauvaise de voir Ennahdha évincé du pouvoir), cette nouvelle phase ne met en mouvement aucune énergie constructive. Les attentes de renouveau étaient pourtant majoritaires après dix ans d’une transition qui n’avait pas tenu ses promesses. Même si elle apparaît a posteriori comme un âge d’or pour les libertés, elle s’est enlisée et coupée des préoccupations populaires.
Les « combinazione » parlementaires, la réforme des institutions clé du régime (justice et police) paralysée par le corporatisme, la transformation impensée des structures de l’injustice et de l’exclusion sociale, la persistance des mécanismes de l’économie de rente, la démultiplication des réseaux de corruption, l’inefficacité croissante de l’État, l’intervention voyante des pays étrangers dans la vie politique et les débats de société, pendant que la situation sociale de la majorité de la population se dégradait, ont fini par réduire la base sociale et politique de la jeune démocratie, tombée d’un souffle le 25 juillet 2021.
Mais au lieu de « rapprocher le peuple du pouvoir », comme il l’avait promis, de réactiver la puissance d’agir populaire qu’avait libérée la révolution, d’être le catalyseur de toutes les idées créatrices délaissées par les partis politiques, et en particulier de mobiliser une compréhension des racines historiques des fractures territoriales et politiques de la Tunisie, Kaïs Saïed n’a servi qu’un seul et même récit depuis son élection : tout le malheur des Tunisiens, toute l’impuissance de l’État, toutes les difficultés qu’il rencontre viendraient de comploteurs, de traîtres, de spéculateurs, de politiciens corrompus, de fonctionnaires non patriotes, d’agents de l’étranger… Seule variation dans ce motif répétitif, les migrants subsahariens, agents ou instruments d’un complot contre l’identité tunisienne.
Il n’a institué qu’une seule incarnation du pouvoir, de l’État et du Peuple : lui même. Les seules passions qu’il sollicite de la part des Tunisiens, avec un certain succès, sont le ressentiment contre les « profiteurs de la transition » — la classe politique, la société civile… – et un patriotisme identitariste et revanchard. Le procès du complot, son contenu et son déroulement, est un condensé de cet agencement délétère.
Un nouveau cycle répressif
On aurait pu penser qu’une fois la scène politique expurgée des « complotistes » avec le verdict (encore susceptible de recours) et ainsi close la séquence judiciaire, l’attention pourrait se tourner vers des réalisations positives. Mais à peine le procès terminé, une nouvelle affaire s’est amorcée mardi.
Ahmed Souab, ancien juge administratif, très impliqué dans la dénonciation de la corruption, devenu avocat et figure importante du comité de défense des accusés, a été arrêté mardi chez lui par une dizaine de policiers. A l’origine de cette arrestation, sa déclaration, le jour du procès, selon laquelle « les couteaux ne sont pas sous la gorge des accusés mais sous celle du président de la cour », en joignant le geste à la parole. Cette allusion pourtant claire aux pressions exercée sur les magistrats a été décrite par les soutiens de Kaïs Saïed, contre toute logique, comme une menace adressée au juge. Après trois jours de campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, la police a donné crédit à cette interprétation et arrêté l’avocat, perquisitionné son domicile pour confisquer les téléphones portables et interrogé son fils durant trois heures. Il a été déféré devant le pôle anti-terroriste pour « menace de crime terroriste » et « entente terroriste », une accusation lourde de conséquence qui pourrait enclencher un nouveau cycle d’arrestations et un nouvel épisode judiciaire.
La présidence de Habib Bourguiba avait dégradé les promesses de l’indépendance en une autocratie despotique et policière, et s’était achevée dans les intrigues de palais. Celle de Ben Ali avait trahi les discours de renouveau et de démocratie, et ajouté à la systématisation de la répression, la prédation de l’économie tunisienne par le clan Trabelsi. L’élan de la révolution a tourné court. La signification de ce procès et de son verdict, c’est que le saïedisme, sous couvert de rétablissement de la souveraineté de l’État et du peuple et de justice sociale, est à son tour en train de sombrer dans la dérive liberticide d’un pouvoir autocratique et paranoïaque, discréditant encore un peu plus la politique aux yeux d’une société tunisienne fatiguée.