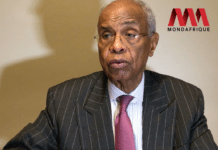Après plusieurs d’année de retard, la compagnie Woodside a annoncé mardi 11 juin avoir démarré l’exploitation du gisement offshore de Sangomar situé au large de Dakar. Avec une production journalière de 100.000 barils, le Sénégal est désormais membre du cercle restreint des pays producteurs d’hydrocarbures en Afrique. Le pays s’attend d’ailleurs à une plus-value annuelle de l’ordre de 700 milliards FCFA qui devrait faire du bien à son économie. Mais il subsiste la « malédiction » du pétrole auquel s’ajoute, dans le contexte africain, la méconnaissance du circuit de production.
Correspondance à Abidjan, Bati Abouè
C’est un jour historique, a annoncé l’australien Woodside Energy group qui a salué, le mardi 11 juin dans un communiqué « l’accomplissement en toute sécurité de la production du premier baril du champ Sangomar » à 100 km au large de Dakar. Le gouvernement sénégalais s’est plutôt gardé de commentaire officiel mais on imagine l’air frais qu’apporte cette nouvelle, puisque l’entrée en production du champ de pétrole Sangomar doit rapporter quelque 700 milliards FCFA annuels au budget national.
Aux yeux de Thierno Ly, directeur général de Petrosen Exploration et Production, , « le début de l’extraction du champ de Sangomar marque le commencement d’une nouvelle ère, non seulement pour l’industrie et l’économie de notre pays, mais surtout pour notre peuple », tandis que la patronne de la compagnie australienne, Meg O’Neill, parle, elle, d’un « jour historique pour le Sénégal et pour Woodside ». Il intervient après une longue attente, puisque la découverte des vastes gisements sénégalais de pétrole et de gaz dans l’Atlantique date de 2014. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, cette première extraction de Sangomar précède l’entrée en production, dès le troisième trimestre, de Grand tortue/Ahmeyim (GTA), à la frontière avec la Mauritanie. Développé par le Britannique BP avec l’américain Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et Petrosen, ce chantier doit produire environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an et faire apparaître le Sénégal au 5è rang des pays producteurs de gaz sur le continent africain dans un contexte de crise russo-ukrainienne qui a renchéri le cours mondial des hydrocarbures.
Un secteur à auditer
La production des deux matières premières est destinée à l’exportation et au marché intérieur. Elle est, bien évidemment, en dessous des niveaux des géants mondiaux et africains, notamment le Nigeria. Mais les revenus projetés devraient aider à la transformation accélérée de l’économie sénégalaise qui a besoin d’un second souffle. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye n’a d’ailleurs pas caché son intention d’auditer le secteur minier, gazier et pétrolier pour permettre à son pays d’engranger le maximum de ressources qui peuvent lui permettre de créer les emplois que recherchent les jeunes sénégalais. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a d’ailleurs réaffirmé dimanche la volonté de revoir ces contrats. « C’est nous qui vous avions promis qu’on allait renégocier les contrats et nous allons le faire, et on a même déjà commencé », a-t-il déclaré devant les jeunes de son parti réunis à Dakar.
La première phase de production du champ de pétrole Sangomar consiste en une unité flottante de production et de stockage. Celle-ci est reliée à des infrastructures sous-marines, conçues en prévision de phases ultérieures de développement. Au total, 21 des 23 puits, dont 11 de production, 10 d’injection d’eau et 2 d’injection de gaz sont achevés doivent entrer en production, a indiqué la patronne de la compagnie australienne.
Clauses léonines
La renégociation des accords gaziers et pétroliers n’est jamais une simple sinécure. Dans un entretien accordé le 19 mars à l’agence de presse Bloomberg, l’ex-président Macky Sall a estimé que les contrats « peuvent être améliorés, mais que dénoncer des contrats déjà signés avec les compagnies n’est pas possible. (En plus), ce serait désastreux pour le Sénégal », a-t-il insisté. La plus notable des difficultés qui se dressera sur la route des nouvelles autorités sénégalaises est qu’« il n’existe pas, de manière explicite, des clauses qui prévoient des renégociations dans les contrats pétroliers » mais, par contre il existe « des clauses qui règlementent les litiges éventuels », a expliqué l’expert pétrolier Ibrahima Bachir Dramé, cité par l’AFP. Mais aux yeux de Papa Demba Thiam, économiste international et spécialiste de développement industriel interrogé par l’AFP, la renégociation de ces contrats est tout à fait possible. Selon lui, « 40 à 92% des contrats sont (généralement) renégociés sur une période allant de 1 à 8 ans » après leur signature. Et puisque selon la constitution sénégalaise, « les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent lui profiter », Papa Demba estime que « toutes les conditions sont réunies pour justifier une renégociation de ces contrats » comme le souhaite le duo d’Exécutif sénégalais.
Mais quoiqu’il en soit, les ressources pétrolières profitent toujours presqu’exclusivement aux multinationales occidentales qui disposent de la surface financière indispensable pour peser sur le contenu des contrats. Selon le mensuel Jeune Afrique, le coût d’exploitation du champ gazier sénégalais initialement chiffré à 3,6 milliards de dollars a finalement dépassé les 9 milliards de dollars. Or face à elles, les pays africains n’ont pas toujours le personnel local qualifié pour contrôler efficacement le circuit de production de ces précieux minerais. De sorte que c’est la déclaration de l’exploitant qui fait généralement foi. A cette réalité, il faut également ajouter celle des administrations africaines qui font que la production de pétrole ou de gaz au lieu d’aider à sortir les populations de l’ornière, enrichit de manière ostentatoire des oligarques locaux.