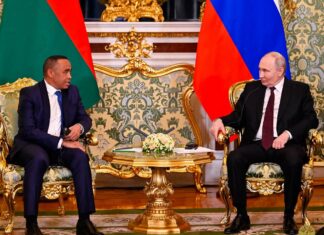Justine Brabant et Leïla Miñano, journalistes, racontent dans Mauvaise troupe – La dérive des jeunes recrues de l’armée française. le quotidien des jeunes soldats français en Centrafrique: la drogue, les filles, la prostitution
Paru le 11 septembre aux Éditions Les Arènes, le livre nous plonge en immersion totale dans le quotidien des soldats, de la Centrafrique à l’opération Sangaris.
Cette enquête journalistique, chiffres et témoignages exclusifs à l’appui, nous transporte bien loin de la vie vendue dans les campagnes de recrutement.
VOICI UN EXTRAIT DE L’OUVRAGE
La fin de la guerre a redessiné la ville. En janvier 2018, le camp de déplacés de M’Poko, autour duquel erraient nombre de godobe, a été démantelé. Devant nous, le terrain a été déblayé par les ONG: il n’y a plus d’abris de fortune ni de sanitaires d’urgence. L’immense bidonville a disparu et le terrain a repris son aspect d’avant-guerre: un cimetière de carcasses d’avions dévorées par les broussailles.
Mais à l’autre bout de la piste d’atterrissage, la base française, elle, n’a pas bougé. Elle accueille toujours le personnel militaire français. Malgré la fin de l’opération Sangaris, en octobre 2016, l’armée n’a pas quitté le pays. 350 soldats y sont restés, mobilisables en cas de «menace sérieuse contre la paix ou les institutions du pays», ou affectés à des opérations internationales (Casques bleus de la Minusca et mission européenne EUTM-RCA).
Certains godobe se sont donc déplacés vers le centre-ville, investissant un squat où ils détournent l’eau des canalisations du ministère de… l’Éducation. D’autres enfants ont préféré la banlieue de Bangui, notamment le PK 12, connu pour son intense activité économique. Le point kilométrique 12 marque l’entrée nord, passage quasi obligé pour les voyageurs en partance ou en provenance de la capitale. L’armée française en avait fait l’une de ses bases avancées durant la guerre civile.l
C’est là que nous retrouvons Dieu-Béni et sa bande de godobe. Le chef, coupe de footballeur et chapelet de plastique autour du cou, a peut-être 13 ans, mais commande sa bière avec l’assurance d’un adulte. La serveuse n’est guère plus âgée que lui. Dieu-Béni dort dans la rue depuis l’âge de 9 ans. Son meilleur copain, Loïck, flottant dans une veste trop large, s’exprime d’une voix cassée et nous jauge d’un regard sombre. Comprenant que nous parlons des Sangaris, d’autres se mêlent à nous. Les mômes doivent élever le ton pour se faire comprendre entre une noria de camions et une chaîne Hi-Fi poussée au maximum. Trois ans après, le souvenir des Français est encore vivace. «Mon camarade chez les Sangaris, le premier que j’ai rencontré, c’était Thierry, commence le chef de la bande. On l’appelait “papa Thierry”. C’est lui qui contrôlait la barrière du PK 12, l’ouvrait et la fermait. En passant devant lui, je l’ai salué. Il m’a vu, il a rigolé et m’a salué à son tour.»
Le point kilométrique 12 est un carrefour important: à droite, la route de Damara s’enfonce dans le nord-ouest du pays, d’où l’on rapporte coton, arachides, manioc, viande boucanée et bœufs; à gauche, la route de Boali pique vers l’est et le Cameroun, qui ravitaille Bangui en poisson, ciment, lait, riz, blé et huiles. La Centrafrique, elle, expédie aux Camerounais son bois, ses diamants et son or. Sous ses allures de quartier bouillonnant, le PK 12 constitue un point hautement stratégique. Le commandement de Sangaris l’a bien compris en y installant une de ses bases dès son arrivée, en décembre 2013. D’un geste, le «camarade Thierry», en relevant et abaissant la petite barrière du PK 12, contrôlait une grande partie de la vie économique du pays.
Autour de cette barrière s’étend à perte de vue le marché, avec sa foule des vendeurs et vendeuses, le flux et le reflux des piétons qui gagnent un bout de bitume avant d’en être chassés par les motos slalomant en klaxonnant à quelques centimètres des étals. Pour se nourrir, Dieu-Béni et sa bande exécutent mille petits boulots: balayer devant les commerces, laver la vaisselle en fer-blanc des vendeuses, trier les arachides. Trop jeunes ou trop maigres pour charger et décharger les marchandises, ils abandonnent cette tâche aux yankees, leurs jeunes aînés. En revanche, ce sont d’agiles pickpockets: téléphone, portefeuille, bijoux, ils ne ratent rien. Les commandants de gendarmerie qui se sont succédé racontent en roulant des yeux que PK12 est un coupe-gorge.
«Avant de repartir, il voulait me laisser ses lunettes et sa montre, mais son binôme lui a dit non. Alors à la place il m’a donné 15.000 francs.»
Pour les enfants sans toit, ce quartier vibrant d’activités plus ou moins légales est surtout la promesse de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Orphelins de parents, tués ou perdus pendant cette guerre ou la précédente, ces gosses règnent sur la rue. Beaucoup y ont aussi été jetés par une famille disloquée. D’autres enfin ont fui leur foyer après avoir été accusés d’être des «enfants-sorciers». Avec la guerre, les petits sorciers se sont multipliés: à force de voir des cadavres et leurs proches sombrer, beaucoup de petits ont développé des troubles du comportement –considérés comme le symptôme d’un esprit hanté. Ainsi se sont constituées, à ciel ouvert, des bandes de gamins livrés à la violence. Durant la guerre, l’un des moyens de survie consistait à se rapprocher des Sangaris aux poches bien pleines. Parfois, leur intérêt a croisé celui des militaires français cantonnés dans leur base.
«Quand ils se sont installés ici, à côté de la gendarmerie, les Sangaris avaient du mal à sortir pour acheter des choses, se souvient Dieu-Béni entre deux gorgées de Castel –la bière locale. Ça n’était pas autorisé pour eux de sortir de leur camp. Du coup, au bout de quelques semaines, ils ont commencé à appeler des petits pour les commissionner [pour faire leurs courses].» Loïck confirme d’un hochement de tête. «Souvent, Thierry m’envoyait chercher des choses. Il me donnait 2.000 francs CFA [3 euros] pour aller acheter des petits jus [sodas] en canette et des choses comme ça. Ou bien de bonnes bananes, ou des ananas. Comme c’était le début de la saison des mangues, j’allais aussi cueillir des mangues bien mûres que je lui amenais.» De ses mains fines, il mime la taille des fruits. En échange, Thierry lui remettait des rations militaires, des «rasquettes». «Dans un carton de ration, il y a des biscuits, du “pain commando”, du pâté, des sardines, du chocolat, énumère l’enfant. Moi, je préférais le chocolat et les biscuits. Le reste, je le partageais avec mes amis de la rue.»
Dieu-Béni nous guide dans son quartier, d’un pas tranquille, en tongs et jean retroussé à mi-mollet. Les yeux brillants, il se remémore le départ de son protecteur. «Thierry me donnait beaucoup de choses. Avant de repartir, il voulait me laisser ses lunettes et sa montre, mais son binôme lui a dit non. Alors à la place il m’a donné 15.000 francs. 15.000 francs!» 23 euros: un centième de la paie d’un militaire français et le revenu mensuel moyen d’un Centrafricain. Après ce départ regretté, il lui fallut, avec sa bande, trouver de nouveaux protecteurs.
«Quand il était à la guérite en haut [au niveau du mirador], il nous jetait des sachets de Nescafé en stick vides, puis l’argent pour payer le chanvre.»
Dieu-Béni
Cette fois, plus question de canettes ou de mangues fraîches, mais de cannabis. Cultivé en Centrafrique ou importé du Congo voisin, la substance, appelée sur place «chanvre indien» ou «chanvre», n’est pas très coûteuse, même pour les locaux: 50 à 100 francs CFA le sachet de 10 grammes (0,08 à 0,15 euro). Beaucoup de gens (taxis-motos, manutentionnaires, militaires centrafricains mais aussi godobe) se droguent avec ce chanvre ou des cachets de tramadol –un antidouleur puissant vendu sous forme de cachets, à 25 francs l’unité [0,04 euro]. Un jour, un soldat français, sentant l’odeur du cannabis dans le sillage d’un «grand frère» (un Centrafricain plus âgé) qui en consommait, interpella Dieu-Béni. «De la guérite, il m’a demandé: “Ce que ton frère fumait là, tu sais où ça se vend? C’est combien?”» Le godobe lui indique les tarifs. «Il m’a donné 500 francs. J’en ai acheté deux. Quand je les lui ai remis, il en a mis un à la bouche et l’autre dans sa poche. Ça n’est pas dur à trouver, ça se vend en face de la gendarmerie, de l’autre côté de la rue.»
Un second soldat, surnommé Alléluia, entra dans le même manège. «Quand il était à la guérite en haut [au niveau du mirador], il nous jetait des sachets de Nescafé en stick vides, puis l’argent pour payer le chanvre. On allait l’acheter, on le mettait dans le stick, et on retournait le lui jeter», raconte l’adolescent encore tout excité par son activité de dealer en herbe. La prise de substances stupéfiantes est pourtant strictement interdite aux militaires français en opérations extérieures, où ils sont systématiquement armés et au contact de populations civiles. Dieu-Béni a été tenté d’en fumer lui aussi. L’herbe lui donnait «envie de beaucoup marcher, de provoquer les gens et de somnoler», se souvient-il. Il a fini par arrêter après qu’on lui a dit qu’il risquait un «cancer du cœur».
Quelques jours après notre rendez-vous dans le bar, nous retrouvons Loïck et Dieu-Béni au PK 12. La circulation est encore plus chaotique qu’à l’ordinaire. La ville est enfiévrée: les fusils-mitrailleurs ont crépité dès le lever du soleil au PK 5. Une histoire de rivalités entre groupes d’«autodéfense». Les deux jeunes aux fines silhouettes qui nous accueillent chavirent un peu, ils ont mal dormi sur les bancs de bois de l’école laissée à leur disposition à condition de déguerpir au petit matin. Dieu-Béni n’a pu fermer l’œil qu’au lever du soleil. Tandis que son ami s’étire douloureusement, Loïck disparaît vers le marché en quête de leur petit job du matin. Il revient avec un sac de petits poissons séchés, encore tout mélangé de sable et de cailloux. Ils vont devoir le trier et le préparer dans des sachets de plastique bleu translucide pour le revendre au détail.
«Une fille passait dans la rue. Il m’a dit: “Je veux ça.” Je suis allé appeler la fille, elle est allée causer avec Minimi. Le soir, elle est revenue à la base.»
Ce faisant, Dieu-Béni tient à reprendre le récit de ses aventures avec les Français. Car, outre les sticks de Nescafé remplis de chanvre indien, les petits godobe ont dû satisfaire d’autres «envies» des soldats de Sangaris. Grisés par leur statut, la puissance que leur confèrent leurs famas et leurs salaires d’Européens dans un pays déchiré par la misère, les petits seigneurs de Bangui voulaient tout acheter. «Un soir, un Français qu’on appelait Minimi était de garde derrière les sacs de sable. Il m’a dit en sango: “baramo, petit” [bonjour, petit].» D’un coup de menton, Dieu-Béni désigne les alentours de la gendarmerie du PK 12 où Minimi était installé.
«Après, il m’a fait signe de venir. Une fille passait dans la rue. Il m’a dit: “Je veux ça.” Je suis allé appeler la fille, elle est allée causer avec Minimi. Puis le soir, elle est revenue à la base. Elle avait peut-être 17, 19 ans. […] Ça, c’était la première fois. Ensuite, c’est souvent qu’on nous envoyait chercher des filles. Les Français leur donnaient de 3.000 à 10.000 francs [4,60 à 15 euros] [pour se prostituer]. Dans la parcelle de la gendarmerie, il y a un coin derrière qui est un peu sombre, c’était là qu’ils se mettaient avec elles.»À lire aussiAffaires d’abus sexuels: les ONG ne se soucient pas vraiment de la confiance des populations locales
Cette jeune passante était-elle une professionnelle, ou simplement une Centrafricaine que la misère avait contrainte à accepter la proposition financière du soldat? Les gamins n’en savaient rien et, endurcis par la rue, n’y trouvaient rien à redire, sauf ce jour où Dieu-Béni estima qu’un Sangaris allait trop loin. «Plus tôt dans la journée, il y avait eu des détonations d’armes. Comme les gens avaient fui en catastrophe, j’allais là-bas pour voir si je pouvais trouver de l’argent qu’ils auraient laissé derrière eux. J’avais une petite lampe-torche et j’éclairais avec. Quand j’ai éclairé vers le camp [où logeaient les Français], j’ai vu une fille qui commençait à faire une pipe à un Français. Le gars était debout, il avait enlevé son casque et sa fermeture [braguette]. Je suis resté caché un moment dans l’obscurité. Et puis j’ai pris une pierre, et je lui ai jeté.» Ni haine ni triomphe dans la voix, juste le ton de celui qui a fait ce qu’il devait faire. «Souvent, au lieu de faire seulement le rapport [sexuel], les Français faisaient la pipe, répète-t-il offusqué en tirant sur son t-shirt trop court. Je ne trouve pas ça correct. Je trouve que c’est du mépris. Alors j’ai lancé la pierre.»