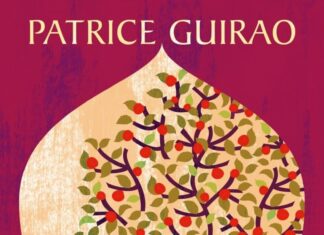Sur le port de Kos, petite île grecque à cinq kilomètres de la côte turque, cet homme originaire de Syrie est jeune, correctement vêtu. Dans un anglais hésitant, il explique que lui et son épouse sont arrivés par la mer, depuis Bodrum. Ils n’ont pas dormi depuis trois jours. Sa femme est enceinte. Pour lui venir en aide, nous téléphonons à son hôtel. Non seulement la gérante accepte de leur louer une chambre, mais, très accueillante, propose de diminuer la location, de 60 à 45 euros la nuit. Très digne, le Syrien insiste pour régler lui-même la note. Il sort une liasse de billets de cinquante euros, bien rangée dans une sacoche.
Tous ceux qui ont visité la Syrie avant la guerre connaissent la difficulté pour la population locale d’obtenir des devises étrangères, la livre syrienne n’étant pas convertible. Qu’en est-il à présent sous des pluies de bombes ? N’ont-ils pas été contraints de verser des fortunes pour s’approvisionner en devises ? Comment se sont-ils débrouillé pour obtenir des euros ? Les deux réfugiés préfèrent interrompre rapidement la conversation, prétextant la fatigue. La réalité, la voila: une grande part des réfugiés syriens qui frappent à la porte de l’Europe arrivent de Turquie où ils vivent parfois depuis des années et où ils ont trouvé des moyens de subsistance. A l’avant garde des secours européens, la Turquie a casqué sept milliards d’euros. D’où l’hypothèse que les Turcs saturés poussent désormais les réfugiés hors de leurs pays.
En effet, les aides financières des Etats aux ONG (HCR, CICR), au lieu d’augmenter, diminuent. Moins de 40 % des fonds attendus pour aider les réfugiés notamment en Turquie ont effectivement été versés. Résultat, le Programme alimentaire mondial (PAM) est « contraint de réduire les portions », a révélé un chef de département à Mondafrique. C’est la faim qui a fait fuir certains Syriens et Irakiens des camps. Quelques-uns ont même préféré abandonner des campements en Jordanie, où la situation est particulièrement catastrophique, pour retourner… en Syrie malgré la guerre.
Des camps de transit en Turquie
Plus tard, nous rejoignons l’hôtel désaffecté Captain Elias, à la périphérie de Kos. Faute de centre d’accueil, cette petite île de 40 kilomètres sur 8, loge un demi millier de migrants dans ce vaste bâtiment sans eau ni électricité. On trouve là des Irakiens, des Iraniens, des Pakistanais, des Afghans à qui la Grèce n’accorde pas le statut de réfugié de guerre contrairement aux Syriens. Pour leur malheur, ils risquent de passer de très longues semaines sur cette terre de l’archipel du Dodécanèse.
Comment expliquer que tous ces malheureux prennent (presque) tous le même itinéraire pour traverser la Turquie, avant de se déverser vers les mêmes îles grecques, d’abord Kos,? Les notions de géographie d’un Afghan ou d’un Pakistanais, en ce qui concerne la mer Egée, sont forcément restreintes. D’autant que la plupart s’expriment difficilement en anglais.
L’explication, nous ne la recueillerons que par bribes : ils ne viennent pas directement de leurs pays respectifs, ils ont transité eux aussi dans les camps en Turquie. Ce sont évidemment des réfugiés qui fuient la terreur ou la misère, mais ils sont partis depuis des semaines, des mois, ou même des années de leurs patries.
La Syrie et l’Irak n’existent plus
Dans ces vingt-cinq camps, installés souvent à quelque encablure de la frontière syrienne, ils ne bénéficient pas du statut de « réfugié », mais de celui d’« invité temporaire », qui leur garantit le « non refoulement », mais ne leur permet guère de travailler en Turquie. Ankara abrite actuellement 1,9 million de Syriens et plus de 300 000 Irakiens. Soit nettement plus que tous les pays réunis de l’Union européenne.
Pourquoi sont-ils partis massivement cet été ? D’abord, parce qu’il est plus facile de se déplacer par beau temps que sous la neige. Mais surtout, ils ont perdu tout espoir de retour. Pour eux, la Syrie comme l’Irak n’existent plus. Face à l’ampleur du mouvement, ni les organisations humanitaires, ni l’Europe n’ont souhaité dire la vérité sur ces déplacements de population aussi brutaux que massifs. Les raisons ? Ils ont eu peur de leurs opinions publiques, des réactions xénophobes. Ils ont voulu éviter de prêter le flanc aux attaques possibles des formations nationalistes et d’extrême droite. En effet, une famille syrienne avec de jeunes enfants inspire moins de compassion si l’on apprend, qu’en fait, elle vivait depuis trois ans loin des obus dans le sud de la Turquie. D’autant qu’elle appartient souvent à la classe moyenne. Sur les 1,9 million de Syriens en Turquie, 260 000 seulement vivent dans les camps. Les autres habitent dans des appartements et même dans des maisons, dans les villages et les agglomérations de Turquie. De son côté, le Liban accueille 1,1 million de Syriens, et la Jordanie, 630 000.
Aylan, 3 ans, sur une plage de Bodrum
Depuis, tous ces acteurs, à des degrés divers, se sont s’enferrés dans ce mensonge-omission, et peinent à en sortir. N’aurait-il pas été plus simple, dès le départ, de marteler que tous les réfugiés, y compris ceux qui ont transité par des camps, méritent d’être secourus ? Mondafrique a dû pendant des semaines multiplier les contacts téléphoniques et les entretiens afin de pouvoir confirmer les informations recueillies dans les îles grecques sur les plages autour de Bodrum. Là où s’est échoué début septembre le corps sans vie du petit Aylan, âgé trois ans. Les réponses dans les organisations humanitaires et des agences des Nations Unies restent très prudentes : il n’existe aucune statistique sur la proportion de réfugiés déjà installés dans des camps en Turquie et qui fuient vers l’Europe. Représentent-ils 10, 20, 30% ou davantage dans les longues files de migrants qui cheminent de la Macédoine à la Slovénie ? Et comment aujourd’hui dire cette réalité ?
Si l’Europe veut endiguer ce flux, elle est contrainte de mettre vigoureusement la main au portefeuille. Et sûrement pas de se contenter d’avancer un milliard d’euros, comme les 28 se sont engagés à le faire le 23 septembre dernier à Bruxelles. Le président turc Recep Tayyip Erdogan aura beau jeu de rappeler à Jean-Claude Junker, président de la Commission européenne, que son pays a déjà dépensé sept milliards d’euros, depuis le début du conflit syrien, pour aider les réfugiés.
Cyniquement, il pourra même lui suggérer discrètement : « A l’avenir, combien voulez-vous que je vous en lâche de nouveaux migrants ? ».