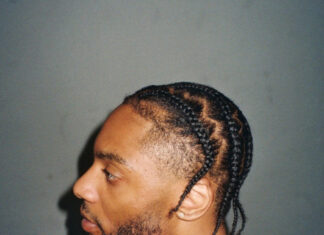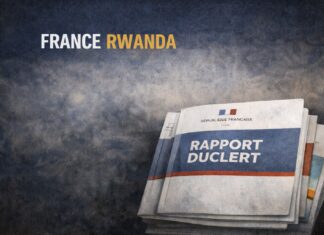Depuis le coup d’État militaire du 18 août 2020, la République du Mali semble avoir substitué à la quête de justice et de démocratie un dogme du développement vitrifié : construire des routes, ériger des ponts, découper des rubans — tout en muselant la société civile et en détournant les règles les plus élémentaires de la commande publique.
Dans une tribune incisive publiée en juillet 2025, explique le chroniqueur et expert Mohamed AG Ahmedou, l’analyste malien Sambou Sissoko dresse un tableau implacable d’un État devenu le théâtre d’un “hold-up infrastructurel” orchestré au profit d’un cartel d’entreprises aux accointances opaques. COVEC, EGK, EGMK, ATTM : ces noms reviennent avec une régularité métronomique dans les décrets ministériels, les annonces du gouvernement de transition, et les rares contrats consultables. Des noms que l’on croirait sortis d’un roman dystopique, et pourtant, ce sont les véritables bénéficiaires d’un Mali livré à une économie politique de la prédation.
Les propos de Sissoko, que certains dans la capitale accusent d’« exagération idéologique », trouvent pourtant un écho bien réel dans les rues de Kayes, dans les cercles de Tombouctou, et jusque dans les villages délaissés du Gourma. À Gossi, Issa AG Alhassane, enseignant à la retraite, soupire: « Ils parlent de routes, mais moi je vois des promesses. Des chantiers qui commencent et ne finissent jamais. Et quand c’est fini, la saison des pluies emporte tout. »
Même constat à Sévaré, où Aïcha, commerçante, rit jaune en évoquant les 32,6 milliards de francs CFA alloués à la route Sévaré-Mopti :
« Ils ont goudronné le centre-ville pour les caméras, mais les camions dégradent le peu de route praticable dès la sortie. On sait tous que c’est du théâtre. »
La fabrique du consentement autoritaire
« Les chantiers d’infrastructures, note Mohamed AG Ahmedou sur son site, sont devenus les piliers d’une gouvernance autoritaire, qui instrumentalise le développement pour consolider le pouvoir. L’autoritarisme malien ne se contente plus de menacer les journalistes ou de dissoudre les partis politiques. Il s’habille désormais d’enrobé bitumineux ».
La procédure dite « d’entente directe », mentionnée à de multiples reprises dans les décisions gouvernementales, est systématiquement utilisée pour contourner les appels d’offres ouverts. La législation de l’UEMOA est pourtant claire : sauf urgence avérée, la concurrence est la règle. Mais depuis 2020, aucun audit de la Cour des comptes n’a été publié. Le silence administratif est devenu l’allié le plus fidèle de la captation. Ces projets, sans exception , ont été confiés à des entreprises proches du pouvoir, souvent sans publication des résultats d’attribution, sans justification technique, sans contrôle parlementaire.
« La commande publique est devenue une affaire privée. » Sissoko
Dans les régions nord du pays, cette centralisation économique attise une frustration croissante. Un conseiller municipal d’Anefis confie, sous anonymat: « Le Nord est exclu des décisions économiques, sauf quand il s’agit de sécuriser les convois d’approvisionnement. Aucune route ne sort de chez nous, sauf pour aller vers les mines. »
Une diplomatie du béton
Le COVEC, bras armé économique de Pékin, est emblématique de cette diplomatie du bitume. Là où la Banque mondiale ou la BAD exigent des contreparties en matière de gouvernance et de traçabilité, la Chine se contente de résultats visibles — peu importe la manière.
À Bamako, le nouveau contournement RR9 trône comme un symbole de modernité. Mais aucun rapport n’en détaille les surcoûts, ni l’état d’avancement réel.
« La route n’est pas un bien neutre. C’est un choix politique », commente Youssouf Ag Rhissa, chercheur en développement basé à Niamey.