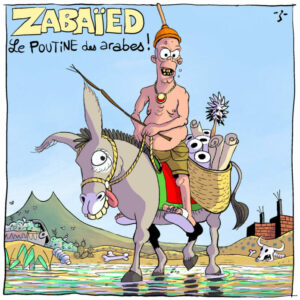Publiée par nos confrères tunisiens de businessnews, cette tribune est importante à plus d’un titre. D’abord par son analyse à la fois globale et détaillée -que nous ne partageons pas nécessairement- d’une situation que beaucoup d’observateurs ont du mal à saisir et à expliquer. Ensuite par son auteur, Mezri Haddad, philosophe et penseur politique idéologiquement inclassable, si ce n’est par son souverainisme radical et son bourguibisme jamais démenti. Enfin, par le moment choisi de la publier, c’est-à-dire à sept mois des prochaines élections présidentielles.
Comme il le dit lui-même, M. Haddad a soutenu le président Kaïs Saïed, y compris après le coup de force du 25 juillet 2021. Démarcation tactique ou profond désaccord avec l’actuel président ? Par son contenu autant que par son ton, cette tribune marque de toute évidence une rupture politique très nette avec le pouvoir actuel, ce qui constitue un acte fort et hautement symptomatique d’un certain mécontentement des élites tunisiennes. Nicolas Beau
Une chronique de Mezri Haddad
C’est un titre que j’ai déjà employé il y a vingt ans dans une tribune critique à l’égard de Ben Ali et qui a été publiée par Jeune Afrique[1]. Mon article avait à l’époque excité l’opposition dite démocratique et exaspéré le régime dit autocratique. Piqué au vif, ce dernier avait alors suscité contre moi ses mercenaires, que mon défunt ami Mohamed Masmoudi appelait « les Fellaga de la plume »[2]. Notamment un universitaire rcédiste, qui a été chargé de me stigmatiser dans Jeune Afrique même, avec une tribune intitulée « Avec Ben Ali, la Tunisie sait où elle va. Mais où va le bateau ivre de Mezri Haddad ? » Comme ce dernier article est accessible dans les archives numériques de Jeune Afrique et via internet[3], ce qui n’est pas le cas du mien (!), voici l’un des passages incriminés et qui m’a valu l’ire du pouvoir :
« L’époque que nous vivons ne tolère plus qu’un seul parti puisse détenir tous les leviers du pouvoir… Et cela devrait concrètement se traduire par une amnistie générale, par un élargissement du champ des libertés publiques, par la création des conditions nécessaires à une participation politique plus active de l’opposition, par l’abolition de tous les mécanismes (visibles ou sournois) qui limitent la liberté d’expression et bloquent le développement de la presse écrite et audiovisuelle…au-delà du besoin vital d’oxygéner les rouages de l’État. »
De l’éternel recommencement
Vingt ans après, me voici dans la même situation où, seule ma conscience, m’oblige à prendre position sans acrimonie et sans litote. Prendre position et non guère me positionner politiquement car, à 62 ans passés, j’ai perdu mes illusions et avec elles, mes ambitions de jeunesse. Comme je le dis souvent, mon royaume n’est plus de ce monde ; je ne cherche plus la célébrité, j’aspire à la postérité, qui « rend à chacun l’honneur qui lui est dû », pour emprunter cette pensée à Tacite. A tout âge, chaque fois que la situation exigeait une prise de position pour la vérité et contre le mensonge, pour la justice et contre l’arbitraire, pour les droits de l’homme et contre la dictature, je n’ai jamais reculé. Que ce soit sous la présidence finissante et désolante de Bourguiba, ou sous le règne autoritaire de Ben Ali, ou encore sous la démocrature de tous les imposteurs qui lui ont succédé après la fumisterie révolutionnaire. A plus forte raison aujourd’hui, que le pays s’est installé dans une médiocratie de plus en plus despotique et que les Tunisiens, désenchantés, désespérés et paupérisés, ne savent plus à quel saint se vouer.
Je confesse avoir longtemps hésité avant de publier cette tribune. Non point par calcul politicien comme je le disais, ou par la convoitise d’une fonction éphémère, ni par la crainte de subir le glaive de Tibère, plus exactement l’épée de Hajjej Ibn Youssuf. Comme disait Tocqueville, « ce n’est donc pas sans y avoir mûrement réfléchi que je me suis déterminé à écrire…Je ne dissimule point ce qu’il y a de fâcheux dans ma position : elle ne doit m’attirer les sympathies vives de personne. Les uns trouveront qu’au fond je n’aime point la démocratie…les autres penseront que je favorise imprudemment son développement » ! Qu’importe donc si elle sera bien ou mal comprise, et si le prix à payer serait à nouveau l’exil. Le troisième et dernier !
J’ai hésité à la publier par espérance logique et rationnelle : chaque jour, chaque semaine, chaque mois, je me disais que Kaïs Saïed va finir par se comporter comme un président digne de ce nom, par apprendre les bonnes manières de diriger un Etat, qu’il allait se résoudre à s’entourer de vraies compétences, à former un gouvernement à la hauteur des périls géopolitiques qui menacent et des défis nationaux qui restent à relever. Mais le régime actuel échappe à toute rationalité, même s’il obéit à sa propre « logique ». Persuadé de son génie inimitable et de sa vocation messianique et eschatologique, enivré par le pouvoir et ses apparats, flatté par un ramassis de zélateurs et de courtisans, Kaïs Saïed n’a fait qu’aggraver une situation politique, économique, sociale, diplomatique et intellectuelle, qui était déjà en piètre état lorsqu’il a accédé en 2019 à la magistrature suprême, après huit années de bourdonnement et de palabres pseudo-révolutionnaires, d’amateurisme politique, d’indigence économique, de corruption endémique, de dislocation sociale, d’abrutissement médiatique et de dilettantisme diplomatique. Une destruction massive sans précédent dans l’histoire moderne du pays. Une destruction dont il faut clairement désigner les coupables, qui ne sont pas exclusivement les islamistes comme on le raconte souvent, mais également les gauchistes, les droit-de-l’hommistes, les syndicalistes, les panarabistes et les nidaïstes.
Du braquage des réserves stratégiques de la Banque centrale[4], aux détournements à leurs profits des différents crédits ou aides accordés à la Tunisie entre 2011 et 2019, en passant par le sac des ressources publiques pour arroser les islamistes, les gauchistes et les affairistes des droits de l’homme -tous supposés avoir été « persécutés » par l’ancien régime-, tout a été fait pour détruire en une décennie ce qui a été construit en un demi-siècle de dur labeur. Quoi que puissent prétendre les imposteurs et les pilleurs, d’une économie qui était prospère, prometteuse et même compétitive, comme cela a été factuellement démontré par un ancien gouverneur de la Banque centrale[5], la Tunisie est passée à une économie indigente, besogneuse et quémandeuse.
Économiquement prospère, en effet, de 1989 à 2010, pays émergent de 2002 à 2011-malgré la corruption et la prévarication-, la Tunisie est désormais un pays en banqueroute financière, en dérive politique et en décomposition sociale, signes annonciateurs d’un nouveau tsunami qui pourrait replonger le pays dans une profonde discorde, susceptible d’établir au pouvoir -et cette fois-ci durablement- une nouvelle génération d’islamistes d’autant plus que leurs aînés ont fait leur mea culpa et appris de leurs erreurs. A moins, je l’espère toujours, d’une reprise en main sérieuse, responsable et immédiate, mieux vaut tard que jamais.
Les raisons de celui qui a tort !
Comme beaucoup de mes compatriotes lors des élections présidentielles de 2019, entre un candidat sans programme politique (Kaïs Saïed) et un programme politique sans candidat (Nebil Karoui), j’ai dû choisir : un homme intègre, professeur de droit constitutionnel, rcédiste de circonstance, révolutionnaire de contingence, souverainiste d’apparence, populiste d’obédience ; plutôt qu’un affairiste d’essence, publicitaire de compétence, folklorique d’expérience…bref, un Zelensky tunisien.
Et comme un certain nombre d’intellectuels-patriotes, notamment Moncef Gouja, qui intitulait son article « Le 25 juillet, la mort d’une révolution »[6], j’ai cru avoir vu dans le retournement politique du 25 juillet 2021, que j’ai immédiatement et publiquement soutenu, et même dès l’élection de Kaïs Saïed en octobre 2019, cette reprise en main sérieuse, responsable et immédiate, c’est-à-dire « un sursaut républicain »[7], comme je l’ai appelé dans Le Figaro.
Mais les différents événements depuis ont fini par corroder mon optimisme, fondé sur l’homme que j’ai cru connaitre. Premier acte décisif et corrosif, qui va commander tous les événements qui allaient suivre : la fuite en avant, ou plus exactement le retour en arrière ! En 2021, Kaïs Saïed avait le choix entre mettre un terme définitif à la mythologie et à la gabegie post-benalienne, ou entraîner le pays dans un second tour révolutionnaire. Otage de sa propre suffisance, soumis à des influences idéologiques antinomiques et d’un autre âge, les unes au nom d’un crétinisme léniniste ou d’un sectarisme trotskiste, les autres au nom d’un puritanisme salafiste, d’autres encore au nom d’un panarabisme verbal et verbeux, ou d’un passéisme crasseux, il a dû faire le second choix, celui de réaliser, enfin, les sacro-saints « objectifs de la révolution » sous le slogan populiste et populacier du peuple exige (الشعب يريد).
Je reste pourtant intimement convaincu que les milliers de manifestants ne sont pas sortis le 25 juillet pour uniquement honnir les islamistes, mais aussi et surtout pour vomir la « révolution du jasmin », dont ils furent le dindon de la farce. A l’exception des politicards, des « journaleux », des « chroniqueurs », des « artistes », des « experts », des « intellectuelloïdes » … qui doivent leur naissance au décès de la République bourguibienne, plus aucuns Tunisiens ne croient au « printemps arabe », encore moins à ses bienfaits. Ni les femmes, ni les hommes, ni les vieux, ni les jeunes, ni les ouvriers, ni les patrons, ni les bourgeois, ni les prolétaires, ni les soldats ni les civils, ni les justiciers ni les justiciables… En 2011, le peuple criait famine, en 2024, beaucoup de Tunisiens font la queue pour un paquet de lait ou 1kg de farine, lorsqu’ils ne fouillent pas dans les poubelles pour se nourrir ! En 2011, l’emblème révolutionnaire était Travail-liberté-dignité nationale (شغل حرية كرامة وطنية), aujourd’hui le triptyque est affligeant : chômage-servilité-misère. A posteriori, la « révolution » se porte bien, c’est le pays qui va de plus en plus mal.
Du syncrétisme constitutionnel à l’aventurisme constitutionnaliste
Restons dans l’action « fondatrice » du 25 juillet 2021, qui, je le répète, ouvrait deux perspective décisives et antagoniques : soit la démystification de la « révolution » pour reconstruire sur l’authentique et le durable, soit son réenchantement pour déconstruire dans le jusqu’au-boutisme et la logomachie. Bien malheureusement, Kaïs Saïed a dû faire le second choix. Et à partir de ce choix tactique -perpétuer le mythe d’une révolution fallacieuse et télécommandée- devenu pour lui une option stratégique, tout s’est déployé dans une suite implacable. Suspension (que j’ai soutenue) d’un Parlement clochardisé et totalement insoucieux du délabrement du pays ; levée d’immunité pour l’ensemble des « représentants du peuple » (que j’ai approuvé) ; inflexion autoritaire (que j’ai également approuvé), mettant fin au régime semi-présidentiel, qui paralysait l’Etat et qui a été instauré par la satanée Constituante pour laquelle Kaïs Saïed était d’ailleurs favorable dès janvier 2011 ; adoption par referendum d’une nouvelle constitution, mesure dont j’ai d’abord cautionné le principe, avant d’en découvrir, abasourdi et sidéré, le contenu indigeste et leucémique. Nous sommes ainsi passés d’une syncrétie constitutionnelle (2014) à un brouillon constitutionnaliste hilarant (2022) ![8] Je ne m’attarderai pas ici sur les circonstances de sa première rédaction frappée du sceau de l’omniscience, ni sur sa révision sous la plume de l’omnipotence, ni même sur son approbation par moins de 30% de « veaux bons pour l’abattoir », comme aurait dit le général de Gaulle en 1940. Je vais laisser de côté ces péripéties tragi-comiques pour aller à l’essentiel.
Selon le philosophe français Julien Freund, « le problème n’est pas pour un pays de posséder une constitution juridiquement parfaite ni non plus d’être en quête d’une démocratie idéale, mais de se donner un régime capable de répondre aux difficultés concrètes, de maintenir l’ordre en suscitant un consensus favorable aux innovations susceptibles de résoudre les conflits qui surgissent inévitablement dans toutes sociétés »[9]. En 2011, par mimétisme occidentaliste et pour obéir à la feuille de route du « libérateur » américain, les « révolutionnaires » de la 50ème heure et de la 5ème colonne ont préféré l’abolition de la Constitution du 1er juin 1959, celle des pères fondateurs, pour en proclamer, le 26 janvier 2014, une nouvelle, plus conforme à l’homo tunisicus.[10]
Tout cela pour dire qu’en juillet 2021, il était temps pour Kaïs Saïed de mettre un terme au système politique et constitutionnel qui, paradoxalement, l’a porté au sommet du pouvoir. Il était grand temps à la légitimité de mettre fin à la légalité, de faire du droit contre le droit ! Le 31 décembre 1851, soit quelques semaines après avoir commis son coup d’Etat du 2 décembre, Louis-Napoléon Bonaparte déclarait : « Je n’étais sorti de la légalité que pour entrer dans le droit. Plus de sept millions de suffrages viennent de m’absoudre ». Au sujet de l’article 80 invoqué par Kaïs Saïed, je rappelle au passage que son prédécesseur, Béji Caïd Essebsi n’a pas exclu d’en faire usage en cas de besoin. C’était dans son interview sur la chaîne nationale Al Wataniya, le 31 mars 2016, accordée à Soufiane Ben Farhat, Hatem Ben Amara et Boubaker Ben Akacha, lorsque celui-ci lui a posé une question relative à l’article 80 et à laquelle il avait répondu que « si la situation l’exige, je l’utiliserai », ajoutant même que « s’il faut changer la constitution, je n’y vois pas d’inconvénient ». Dernier baroud d’honneur ! Dernier bluff d’un président qui a trahi ses électeurs et qui n’a pas su distinguer le bon grain de l’ivraie !
Calcul électoraliste contre impératif catégorique
Encore aujourd’hui, je ne mettrai pas en cause l’essence du 25 juillet et je ne regrette point de l’avoir qualifié de « sursaut républicain ». Ce que je remets en cause et dénonce en revanche, c’est sa finalité qui s’est avérée autocratique et populiste. A mes yeux, la reprise en main sérieuse et urgente de la situation ne devait pas consister en l’intimidation ou l’emprisonnement des adversaires politiques, de quelque bord qu’ils soient, ou des journalistes et des internautes qui ont cru que la liberté d’expression était un acquis irréversible. L’urgence absolue était au redressement social et économique d’un pays dévasté par dix années d’amateurisme et de népotisme. Il aurait donc fallu constituer un gouvernement d’unité nationale, en impliquant nos jeunes compétences de l’intérieur comme de la diaspora. En rappelant les meilleurs commis de l’Etat pour les remettre à la tâche, y compris certains éminents ministres de Ben Ali, qui ont été sacrifiés sur l’autel de la révolution bouazizienne. En réintégrant certains grands directeurs de l’administration tunisienne, épine dorsale de la République bourguibienne et benalienne. Autant de ressources humaines perdues, autant d’hommes qui ont, pour la plupart d’entre eux, servi l’Etat avec dévouement, professionnalisme et patriotisme. Autant de compétences qui auraient pu et qui auraient dû initier nos jeunes cadres en les préparant à reprendre le flambeau du développement économique et de la bonne gouvernance.
L’urgence, l’impératif catégorique n’était pas au passé, en ostracisant la belle époque (العهد الجميل), ni à l’avenir, en se braquant sur les prochaines élections présidentielles, mais au présent, en regardant les Tunisiens et les Tunisiennes qui font les poubelles pour se nourrir et plus tragiquement encore, les milliers de jeunes candidats au suicide en Méditerranée. Depuis 2011, plus d’un-demi-million de mes compatriotes ont clandestinement quitté la Tunisie, sans compter nos ingénieurs, nos informaticiens, nos pilotes et surtout nos médecins qui se sont expatriés faute du moindre horizon dans le pays qui les a formés au prix de milliards de dinars. Auparavant, nos médecins sortis de nos meilleures facultés tunisiennes, quittaient le pays pour se spécialiser, ensuite y revenir pour dédier leurs vies aux soins de leurs compatriotes. Depuis la déstabilisation de la Tunisie, la plupart de nos jeunes médecins n’ont qu’une seule envie, quitter définitivement leur pays, malgré leur patriotisme. Sur les 1000 jeunes médecins que produit l’université tunisienne annuellement, plus de 80% choisissent de partir vers l’Europe, ce qui n’est pas pour déplaire à nos « amis » occidentaux ! Selon une étude réalisée en 2021 par Kapitalis, « 50% des médecins ont quitté la Tunisie à cause d’un harcèlement professionnel, 62% sont partis à cause de l’insécurité dans les hôpitaux, 75% jugent les conditions de travail inadaptées avec les règles de la bonne pratique, 50% ont quitté le pays à cause de l’instabilité sociopolitique, 30% des médecins qui ont immigré pensent qu’il n’y a plus de solution pour sauver le secteur de la santé »[11].
Casuistique juridique et purges politiciennes
L’urgence n’était donc pas à la neutralisation systématique de tous les candidats potentiels aux élections de 2024, à supposer qu’elles puissent avoir lieu ![12] Considérant que ce fût leur cas -et c’est leur droit le plus élémentaire-, concédant que ce soit une priorité pour le locataire de Carthage de les neutraliser, il aurait été plus loyal de le faire par le débat démocratique et non de l’anticiper par le bras de la justice, qui plus est en accusant certains d’entre eux de « crimes » fantasmagoriques et de délits fantaisistes. Pour avoir plusieurs fois dénoncé leurs turpitudes, ce n’est pas aujourd’hui que je vais les innocenter ou tenter de les blanchir. Je ne défends ici que leur droit de se défendre. Pas plus que d’autres, je ne connais leurs dossiers, encore moins les pièces factuelles ou les preuves tangibles qui les incrimineraient. Dieu Seul sait pourtant si parmi ces prisonniers politiques, certains n’étaient pas pour moi sinon les pires ennemis, du moins de redoutables adversaires. Ce n’est pas le cas de Abir Moussi qui, indépendamment de l’estime que j’ai pour elle depuis son acte héroïque du 2 mars 2011, reste le plus emblématique. D’abord, parce qu’elle a été la seule à affronter les islamistes lorsque tout le monde les convoitait, avant de les trahir. Ensuite, parce qu’il s’agit d’une femme et d’une mère de famille. Enfin, parce que c’est elle, et elle seule, qui a fait bouillir la marmite du 25 juillet sans y gouter par la suite. En d’autres termes, c’est à Abir Moussi que Kaïs Saïed doit le succès populaire avec lequel les Tunisiens ont accueilli son coup d’Etat constitutionnel.
L’emprisonnement des hommes d’affaires n’est pas moins arbitraire. Je ne doute pas que parmi ces naufragés-argentés, certains aient pu commettre des délits de corruption ou fiscaux, voire des crimes financiers. Durant toute la décennie effectivement noire, la corruption n’était plus, comme à l’époque de Bourguiba ou de Ben Ali une exception, c’est-à-dire conforme aux normes occidentales (!), mais elle était devenue la règle, à l’instar de l’Ukraine. Si certains parmi ces naufragés aient pu contrevenir aux lois, la règle en droit est limpide : tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. A l’exception des Etats de non droit ou carrément totalitaires, dans tous les pays du monde, la présomption d’innocence est un principe élémentaire de justice. Nul besoin d’être un éminent juriste comme c’est le cas du président actuel, pour savoir que le processus comme la procédure judiciaires sont tout aussi limpides : enquête préliminaire, réalisée par la police judiciaire sous l’autorité du ministère public pour recueillir les preuves et établir les faits ; instruction préparatoire menée par un juge d’instruction pour approfondir l’enquête, interroger les témoins et les suspects et rassembler toutes les preuves nécessaires ; contrôle de l’instruction, effectué par la chambre d’accusation qui vérifie la régularité de l’instruction et décide si l’affaire doit être renvoyée devant une juridiction de jugement ; jugement de l’affaire soit par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance pour les délits, soit par la chambre criminelle du même tribunal pour les crimes ; voies de recours, ouvrant la possibilité de faire appel ou de se pourvoir en cassation pour contester la décision rendue.
Condition sine qua non de ce déroulement : que la Justice soit absolument, effectivement et irréprochablement indépendante. Est-ce le cas en Tunisie dans le contexte actuel où les politiques, les hommes d’affaires, les journalistes… ont le choix entre la soumission, la prison ou l’exil ? Aussi bien dans le cas des prisonniers politiques que dans celui des prisonniers financiers, je n’ai qu’un conseil à donner au président de la République et à sa ministre de la Justice, un conseil que j’emprunte à Paul Lombard, en 1974 : « N’écoutez pas l’opinion publique qui frappe à la porte de cette salle (tribunal). Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche, il faut la chasser de nos prétoires, car lorsqu’elle rentre par la porte, la justice sort par l’autre » !
De la haine de classe au virus de la discorde
Extirpé de la préhistoire, devenu premier-ministre par un caprice de l’Histoire, Béji Caïd Essebsi s’est empressé de libérer les terroristes pour emprisonner les patriotes susceptibles de lui faire de l’ombre. Elu président en 2014, et pour briller et fanfaronner, il devait aussi neutraliser d’une façon ou d’une autre tous les rivaux potentiels, afin qu’au royaume des aveugles, les borgnes soient rois. Mais il l’a fait à la manière tunisoise, conseillé par le plus vaniteux de cette caste, un certain juriste Robespierrien qui le poussait même à dresser des potences ! Depuis plus d’une année, c’est plutôt de manière inquisitoriale que l’on procède !
Les arrestations arbitraires discréditent assurément la justice tunisienne, qui n’a jamais été auparavant aussi implacablement instrumentalisée. En outre, ses effets pervers sur l’économie du pays sont désastreux, puisque les hommes d’affaires, les chefs d’entreprises, les industriels et même les acteurs économiques les plus modestes sont tétanisés et s’abstiennent, par conséquent, de tout investissement dont la Tunisie a d’autant plus vitalement besoin que beaucoup d’entre eux ont déjà quitté le pays (2011-2015), ne supportant plus les grèves répétitives et le rançonnage, déjà à l’époque, par les nouvelles « élites » politiques et syndicales. Alors que la fraude fiscale caractérise surtout et massivement le secteur économique informel, voici maintenant que les rares entrepreneurs ou industriels ayant fait le choix patriotique de rester au pays, qui payent honnêtement leurs impôts, implicitement et indistinctement visés à leur tour à cause de quelques brebis galeuses effectivement coupables. C’est irresponsable et suicidaire d’anathématiser l’ensemble de cette catégorie socio-économique, de la jeter en pâture à ceux qui crient famine et qui ont réellement faim. Quant aux détenus actuels, préventivement emprisonnés et qu’il aurait fallu soit condamner, soit relaxer, l’opinion ne sait toujours pas ce qu’on leur reproche exactement et surtout matériellement, à part qu’ils « ont volé l’argent du peuple ». On sait en revanche qu’ils sont soumis à la « justice » expéditive, rançonneuse et comminatoire du tu payes, tu sors, tu ne payes pas, tu moisis en prison !
Facteur aggravant de cette chasse aux sorcières qui flatte les bas instincts du peuple, le climat de délation et d’aversion ou, comme disait Marx la « haine de classe », qu’elle suscite et distille. Cette haine de classe est pour le corps social ce qu’un cancer est pour le corps humain. Je parle évidemment du poison mortel de la discorde, que l’illustre et inégalable Bourguiba redoutait tant. Dans un discours du 25 juillet 1967, il avait déclaré, « que le plus grand danger qui menace la République, c’est le virus de la discorde ». Le fameux Démon numide ! Or, depuis la fallacieuse et chaotique « révolution du jasmin », mes compatriotes vivent sous la malédiction de ce démon atavique. Stigmate de la révolution après une brève et illusoire fraternisation pendant les événements de janvier 2011[13], le Tunisois en veut au Sahélien qui aurait confisqué le pouvoir dès 1956 ; le Sfaxien se méfie du Tunisois, les gens du nord et du Sahel méprisent les gens du Sud, et les gens du Sud détestent, méprisent et jalousent le Tunisois, le Sfaxien et le Sahélien, qui les auraient marginalisé et appauvri depuis l’indépendance, selon la propagande islamiste et les sornettes gauchistes. Les révolutionnaires de pacotilles, y compris les petits bourgeois de Carthage et de La Marsa, ont persuadé les « damnés de la terre » que s’ils sont pauvres, c’est à cause des riches, qui auraient volé leur argent Toutes ces balivernes, toutes ces haines, toutes ces zizanies couvertes d’une épaisse couche d’hypocrisie sociale et d’empathie artificielle, n’attendent qu’une prochaine occasion « révolutionnaire » pour se manifester encore plus violemment qu’en 2011. A moins de croire à cette pensée platonicienne qui est peut-être apocryphe mais qui donne ici tout son sens à une intention cachée : « pour maintenir la tyrannie, il faut que le tyran fasse en sorte que les sujets s’accusent les uns les autres, et se troublent eux-mêmes, que l’ami persécute l’ami, et qu’il y ait de la dissension entre le menu peuple et les riches, et de la discorde entre les opulents. Car en ce faisant ils auront moins de moyen de se soulever à cause de leur division ».
Despotisme éclairé et obscurantisme despotique
Si pour Pascal, « La justice sans la force est impuissante, et la force sans la justice est tyrannique », selon Rousseau, « Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir ». J’y vois à la fois la définition intrinsèque de la justice, y compris dans la pensée politique islamique, et la conception originelle du despotisme éclairé, à savoir une sainte alliance entre philosophie et pouvoir. Si la figure historico-occidentale du despote éclairé est le prussien Frédéric II, ou, en contexte arabo-musulman, les quatre premiers califes dits « bien guidés », dans l’histoire de la Tunisie, le despote éclairé par excellence a été et reste sans conteste Habib Bourguiba. Un homme d’Etat exceptionnel, un visionnaire hors pair dont certains entretiennent encore la haine compulsive. Son despotisme éclairé est aux antipodes de l’obscurantisme despotique actuel. Si Rached Ghannouchi n’a aucun mal à se définir comme un islamiste de droite, je me demande parfois si Kaïs Saïed n’est pas un islamiste de gauche ! Car, avant d’être un mouvement politique ou une idéologie, l’islamisme est d’abord un esprit, une mentalité, une façon de penser et d’agir.
Avec le triomphe électoral des islamistes sous la bienveillance de la très « transparente » ISIE, l’on craignait l’instauration d’une théocratie totalitaire. Par réalisme et prudence politique, Ennahdha ne l’a pas réalisé, ou n’a pas eu le temps de le faire. D’où cette question que beaucoup se posent : sous quel type de régime vivons-nous aujourd’hui ? Une démocrature plébiscitaire dans la pure tradition schmittienne, ou une dictature du prolétariat dans la discontinuité islamo-trotskyste ? Comme le dit si justement un éminent professeur tunisien de sciences politiques, « Le mal institutionnel, l’instabilité politique et les vices d’ordre constitutionnel sont remédiables par le dialogue, le consensus profond et le décisionnisme. Le décisionnisme seul, apparaissant comme une voie dictatoriale pure, risque de rajouter la violence des finalités à la violence des moyens »[14].
De la méritocratie autoritaire, véritable définition du régime politique sous Bourguiba et même sous Ben Ali, la Tunisie est ainsi passée à la démocratie ochlocratique et kleptocratique (2011-2020), avant de finir en peuplecratie[15] clientéliste. Dans la Tunisie post-bouazizienne, il était, même pour un cancre, psychologiquement plus réaliste de devenir député, gouverneur, ambassadeur, consul ou ministre, voire président, que balayeur ou plombier. Or, ce balayeur ou plombier, cette ouvrière agricole ou agent policier, ce professeur à l’école primaire ou secondaire, contribuent au bien commun et apportent beaucoup plus à la société qu’un consul recyclé, ou un gouverneur improvisé, ou un ministre parachuté, ou même un chef de gouvernement intronisé ! Si la véritable intention du président était réellement le redressement socio-économique du pays, il aurait fallu nommer à la Kasbah un économiste expérimenté, politisé et compétent, non pas un petit fonctionnaire aux ambitions disproportionnées (Hichem Mechichi), ou une honnête professeure de géologie (Najla Bouden), ou encore un brave homme, ancien cadre de la BCT chargé des ressources humaines, dont on a découvert récemment à Matignon la virtuosité oratoire, l’art politique et le talent diplomatique. Sans parler de certains mini-ministres ou maxi-gouverneurs ! On peut tout reprocher à Bourguiba et à Ben Ali, mais on ne pourra jamais leur dénier cette qualité essentielle chez le Prince : le bon flair, l’intelligence politique de placer l’homme ou la femme qu’il faut à la place qu’il faut. C’est à cela qu’ils doivent leur longévité au pouvoir et plus important encore, leurs nombreuses réalisations.
De la neutralité pragmatique au suivisme suicidaire
De talent diplomatique, parlons-en. Sous Bourguiba, notre diplomatie a connu son âge d’or avec Mongi Slim, Mohamed Masmoudi, Habib Chatti, Hassan Belkhodja, Hédi Mabrouk. Sous Ben Ali, elle a vécu son âge de bronze, avec Habib Ben Yahia, Abdelbaki Hermassi, Kamel Morjane… De 2011 à 2019, elle connut son âge de pierre, avec Mouldi Kéfi, Rafik Abdessalem, Khémaïes Jhinaoui… Et depuis 2019 jusqu’à ce jour, le darwinisme à l’envers a fait son œuvre ! Est-ce la faute au titulaire du poste ? « Donnez-moi de bons cuisiniers, et je vous ferai de bons traités », se plaisait à dire le maestro de la diplomatie, Talleyrand. Bien avant Henry Kissinger, la diplomatie -disait à son tour le journaliste américain Ambrose Bierce-, « c’est l’art patriotique de mentir pour son pays » ! Le patriotisme, ce n’est pas ce qui fait défaut à certains ministres de l’AE, ni d’ailleurs l’art de mentir. Mais c’est la politique générale du pays qui rend leur voie inaudible et leur action aléatoire. Il est vrai que le rétablissement de nos relations diplomatiques avec la Syrie, même s’il n’a pas été aussi rapide que je l’aurai souhaité, est une décision noble et courageuse d’autant plus que les Tunisiens ont été les premiers, en nombre et en sauvagerie, à prendre part au massacre de nos frères Syriens. Il est vrai aussi que l’insoumission au diktat de la Banque mondiale et du FMI est un acte souverain dont il faut saluer l’intrépidité. Il est tout aussi vrai que le rapprochement du BRICS, en ces temps d’accélération de l’Histoire dans un monde de plus en plus multipolaire, est un choix géopolitique majeur et vital pour l’avenir de la Tunisie. Encore faut-il avoir les reins bien solides pour rejoindre le BRICS sans nécessairement rompre avec nos partenaires traditionnels. En revanche, l’amateurisme et l’aventurisme avec lesquels nos relations mémorables avec le Maroc ont été malmenées constituent à mon sens une faute morale et politique indubitable. Casser la neutralité pragmatique et la non-ingérence dans les affaires d’autrui, qui caractérisaient et valorisait la diplomatie tunisienne depuis l’indépendance, est bien dommageable. Sauf à rapprocher les deux points de vue et d’agir dans le sens de la concorde, la Tunisie n’avait pas à s’immiscer dans ce conflit fratricide et absurde entre le Maroc et l’Algérie. La question du Sahara ne regarde que le Maroc, et cette position qui est la mienne n’est pas de circonstance. Mes amis Marocains autant qu’Algériens savent que telle a toujours été mon attitude, clairement exprimée dans mon essai, Carthage ne sera pas détruite (2002). Les Algériens sont nos frères et c’est bien parce qu’ils sont nos frères qu’il ne faut pas qu’ils deviennent nos maîtres !
Cette tribune est déjà bien longue et c’est par une ultime élucidation que je voudrai la terminer. Tant qu’il était défendable, j’ai fait ce que j’ai pu pour soutenir Kaïs Saïed. Aujourd’hui, il n’est plus possible de cautionner, même implicitement, sa politique. « Je n’ai jamais abandonné aucun régime avant qu’il se fût abandonné lui-même », confessait Talleyrand. Je l’abandonne avec amertume et sans rancœur. Ce n’est pas ici la tribune d’un opposant, ni d’un opposocrate, mais d’un proposant ! D’un homme libre qui, parce qu’il n’aspire à rien, espère toujours éclairer le Prince par le bon conseil et pour l’intérêt supérieur de la Nation[16]. Cette œuvre, disait précisément Machiavel, « je ne l’ai pas ornée et chargée de formules amples, de paroles ampoulées et magnifiques, ou de ces coutumes d’illustrer et broder leurs écrits ; car j’ai voulu ou que rien ne lui fît honneur, ou que seules la différence de la manière et la gravité du sujet la fassent agréer ».
Caprice de l’histoire ou ruse de la Raison, il s‘agit d’un vrai revers pour moi de me trouver, que je le veuille ou non, dans le camp de ceux que j’ai combattu et qui m’ont combattu des années durant. Pis, d’associer ma voix à celle des opposocrates, qui ont abimé le pays et qui partagent d’ailleurs avec le président Saïed le concept de « révolution permanente », une ineptie trotskiste et léniniste. Mais à mon âge, mieux vaut être en compagnie d’ennemis persécutés que d’amis persécuteurs ! Ce n’est pas le cas d’une certaine « élite intellectuelle » embourgeoisée, qui semblent avoir retrouvé sa servilité naturelle. En dépit du fanfaron plus jamais peur dans l’avenir (لا خوف بعد اليوم), elle ne critique plus publiquement, elle chuchote très discrètement. Le seul « acquis » de sa chienlit de 2011, à savoir le droit à l’aboiement, elle l’a perdu depuis l’inflexion autocratique du 25 juillet 2021. Cette élite n’aboie plus, elle miaule ! Quant au reste des Tunisiens, qu’on ne s’y méprend pas : les discours nationalistes, les homélies messianiques, les prouesses exégétiques, les envolées lyriques, les promesses édéniques…ne retiennent jamais un peuple lorsqu’il commence à avoir faim. C’est d’autant plus vrai que « Le silence du peuple n’est que la trêve du vaincu, pour qui la plainte est un crime. Attendez qu’il se réveille : vous avez inventé la théorie de la force ; soyez sûr qu’il l’a retenue. Au premier jour, il rompra ses chaînes ; il les rompra sous le prétexte le plus futile peut-être, et il reprendra par la force ce que la force lui a arraché »[17]. Et dans son infinie sagesse, l’Imam trahi et martyrisé, Ali Ibn Abi Taalib, enseignait dans son magistral (نهج البلاغة) La Voix de l’éloquence :
كراكب الأسد يغبط بموقعه وهو أعلم بموضعه السلطان
Mezri Haddad est docteur en philosophie de la Sorbonne et auteur de plusieurs essais politiques et géopolitiques. Après avoir été au début des années 1990 l’un des plus redoutables opposants à Ben Ali, exilé politique en France de 1989 à 2000, il en est devenu à partir de 2002 un défenseur critique du régime. Nommé ambassadeur auprès de l’UNESCO, il a démissionné le 13 janvier 2011, soit 24h avant la chute du régime tunisien. De 2011 à 2022, ayant été l’un des rares intellectuels en Tunisie et même dans l’ensemble du monde musulman à critiquer violemment le « printemps arabe », il va connaitre son second exil en s’opposant à tous les gouvernements issus de la « révolution du jasmin ». Dernier essai paru en Tunisie et préfacé par Ahmed Manaï, qui est décédé en janvier 2023, La face cachée de la révolution tunisienne. 12 ans après le coup d’Etat déguisé, AC Editions, Tunis, 2023.
[1] « Avec Ben Ali, où va la Tunisie ? », Jeune Afrique, du 7-13 novembre 2004.
[2] Les Arabes dans la tempête, Paris, 1977. Militant destourien de la première heure, considéré comme étant l’un des principaux négociateurs de l’indépendance, Masmoudi a été ministre des Affaires étrangères (1970-1974), poste dont il fut limogé à la suite du projet d’unification tuniso-libyenne. C’est à lui que je dois mon retour en Tunisie en avril 2000 et ma réconciliation avec Ben Ali.
[3] https://www.jeuneafrique.com/60982/archives-thematique/avec-ben-ali-la-tunisie-sait-o-elle-va-mais-o-va-le-bateau-ivre-de-mezri-haddad/
[4] 5600 millions de dinars laissés par Ben Ali avant que les Américains ne jettent le président trahi dans un avion pour un exil sans retour ? 5600 millions de dinars comme fonds stratégiques dédiés aux futures générations.
[5] Taoufik Baccar, Le miroir et l’horizon. Rêver la Tunisie, Tunis, 2018.
[6] Moncef Gouja, « Le 25 juillet, la mort d’une révolution », L’Economiste Maghrébin du 19 juillet 2022, https://www.leconomistemaghrebin.com/2022/07/19/25-juillet-mort-revolution/
[7] Mezri Haddad, « Ce qui se passe en Tunisie n’est pas un coup d’État mais un sursaut républicain », Le Figaro du 27 juillet 2021, https://www.lefigaro.fr/vox/monde/ce-qui-se-passe-en-tunisie-n-est-pas-un-coup-d-etat-mais-un-sursaut-republicain-20210727
[8] Dans mon prochain livre Qu’avez-vous fait de la Tunisie ? je reviendrai plus longuement sur le guêpier constitutionnaliste dans lequel s’est embourbée le pays depuis 2011 et, plus grave encore, sur la magistrature et surtout l’avocature qui a totalement phagocyté la vie politique tunisienne.
[9] Dans sa préface au livre de Carl Schmitt, La notion de politique (suivi de) Théorie du partisan, Paris, éd. Calmann-Lévy, 1972.
[10] Dès 2011, j’avais publiquement pris position pour une réforme de la Constitution de 1959 et contre son abolition, voir mon article, « Du passé, ne faisons pas table rase », La Presse du 28 janvier 2011.
[11] https://kapitalis.com/tunisie/2021/06/17/pourquoi-les-medecins-tunisiens-quittent-ils-leur-pays/
[12] En effet, je n’en suis pas si sûr. Il y a beaucoup de soupçons et d’interrogations, notamment au sujet de la loi électorale émanant structurellement de la Constitution de 2014, qui est caduque ! La question est donc de savoir si on va conserver la loi électorale de 2014, ce que suggèrent les allusions du président lui-même et certains membres de l’ISIE, ou confectionner une nouvelle, en sachant qu’on n’a vu nulle part s’instituer une loi électorale quelques mois avant la tenue des élections en question.
[13] Il en va de même dans toutes les révolutions. Au sujet de mai 1968, Régis Debray s’interrogeait : « Ce que l’individu gagnait en liberté, le citoyen n’allait-il pas bientôt le perdre en fraternité ? Derrière une Love Parade ouverte à tous les exclus, des free parties sans interdits, se faufilaient, sans mot dire, le trader, l’insatiable show-biz et le tout-à-l’égo », Régis Debray, Modeste contribution aux discours et cérémonies officielles du dixième anniversaire, Paris, éd. Maspéro, 1978.
[14] Hathem Mrad, Les dérives contraires en Tunisie, éd. Cérès, Tunis, 2022, p. 27.
[15] Ilvo Diamanti et Marc Lazar, Peuplecratie. La métamorphose de nos démocraties, Paris, Gallimard, 2019. Par ce néologisme, les auteurs désignent le régime politique qui s’établit sur la gestion des émotions, des haines sociales, des rancœurs, des colères populaires, en court-circuitant tous les corps intermédiaires.
[16] C’est ce que j’ai essayé de faire auprès de Ben Ali à partir de 2000, soit directement, soit par le biais de mon essai, Carthage ne sera pas détruite, édition Du Rocher, 2002. S’il m’avait écouté un tant soit peu à cette époque et surtout en janvier 2011, la Tunisie n’aurait jamais connu un tel destin.
[17]Maurice Joly, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, éd. Calmann-Lévy, 1968, p. 20.