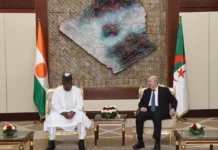Dans quelques semaines, la France quittera la ville de Gao, sa dernière base au Mali, et mettra officiellement fin à l’opération Barkhane. Ce retrait ne signifie pas la fin de la guerre de la France au Sahel. Un nouveau dispositif allégé est d’ores et déjà en discussion avec les pays de la sous-région. Mais il acte la défaite de la force Barkhane face aux groupes djihadistes sahéliens qui ne cessent de gagner du terrain.
Retour en cinq actes sur la plus longue opération militaire extérieure de la France depuis la guerre d’Algérie. Ce deuxième volet est consacré aux premières critiques vis-à-vis de Barkhane, plus de deux ans après son déclenchement.
Une enquête signée David Poteaux

Tout se passe au mieux pendant plusieurs années. C’est du moins ce que cherchent à faire croire les autorités françaises. Régulièrement, les journalistes embarqués avec la force Barkhane, qui semblent avoir laissé leur esprit critique chez eux à Paris (si tant est qu’ils en aient un) au moment de faire leur valise, tressent les lauriers des militaires. Les responsables politiques, ministres ou parlementaires, s’autocongratulent dès que la mort d’un chef djihadiste est annoncée par l’état-major – un « coup » porté à l’ennemi qui aura du mal à s’en remettre, nous explique-t-on -, et assurent, contre toute évidence, que l’ennemi est au plus mal et que les armées sahéliennes « montent en puissance ».
Pourtant, quelques chercheurs qui ont de solides réseaux sur le terrain commencent à évoquer « l’impasse » dans laquelle risque de se retrouver l’opération Barkhane, et à parler d’« enlisement ». Ils soulignent que les groupes djihadistes se sont réorganisés et semblent s’être partagés les tâches – la katiba Macina d’Hamadou Koufa dans le centre du Mali, Aqmi dans la région de Tombouctou, Ansar Eddine, le groupe d’Iyad Ag Ghaly dans la région de Kidal, et le Mujao dans le grand est (Gao, Menaka, Ansongo). En mars 2017, tous ces groupes se réuniront dans une coalition, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), dirigée par Iyad Ag Ghaly. Des dissidents issus du Mujao et d’Aqmi, actifs dans la zone des trois frontières (Mali-Burkina-Niger) feront pour leur part allégeance à l’État islamique en 2016.
Les djihadistes sont en capacité de mener des actions d’envergure quand et où ils le souhaitent
Les experts constatent en outre que ces mouvements recrutent en masse et jouissent de soutiens communautaires de plus en plus importants. Qu’ils gagnent du terrain, notamment dans les zones rurales du centre du Mali. Et qu’ils sont en capacité de mener des actions d’envergure quand et où ils le souhaitent : à Bamako (attaque de l’hôtel Radisson le 20 novembre 2015, 21 morts), à Ouagadougou (attaque du restaurant Le Cappuccino et de l’hôtel Le Splendid le 15 janvier 2016, 30 morts) et même en Côte d’Ivoire, dans la cité balnéaire de Grand-Bassam (le 13 mars 2016, 19 morts).
Dès le mois de décembre 2015, Yvan Guichaoua, spécialiste du Nord-Mali et du Niger, emploie le mot qui fâche – « l’impasse » – dans un texte publié sur le site The Conversation (lien : https://theconversation.com/limpasse-du-contre-terrorisme-au-sahel-52171). « En matière d’anti-terrorisme, écrit-il, les réponses étatiques font autant partie du problème que de sa solution. Les mouvements radicaux n’évoluent pas dans le vide, selon leur propre logique, indépendamment de tout contexte. La compréhension de ce contexte, dans lequel les États occupent le premier rôle, offre des leviers politiques. Trois ans après le début de Serval et devant le constat glaçant de l’impasse dans laquelle se trouve la logique répressive, de profonds et ingrats chantiers politiques sont toujours attendus ».

`
La volonté de se protéger, de protéger sa famille, sa communauté ou son activité économique apparaît comme un des facteurs importants d’engagement`
Des études démontent en outre le discours concocté à Paris, en dressant notamment un portrait bien différent des « ennemis » que combat l’armée française au Sahel. En août 2016, l’Institut d’études de sécurité, un think tank africain, publie un rapport basé sur des entretiens avec 63 ex-engagés, qui remet en question « certaines idées reçues sur l’extrémisme violent au Mali » (lien : https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/policybrief89-fr-v3.pdf). « Chômeurs, désœuvrés et fanatisés. C’est ainsi que sont généralement présentés les jeunes qui grossissent les rangs des groupes armés djihadistes au Mali », peut-on lire au début du rapport, qui aboutit à cinq conclusions :
« 1. Des facteurs qui n’ont rien d’économique, de religieux ou d’idéologique expliquent la présence de jeunes dans les rangs des groupes armés djihadistes au Mali.
2. La volonté de se protéger, de protéger sa famille, sa communauté ou son activité économique apparaît comme un des facteurs importants d’engagement.
3. Les facteurs interagissent dans la plupart des cas ; il est donc vain de rechercher un seul et unique motif d’adhésion.
4. Il importe d’analyser de façon détaillée les réalités locales à l’origine de l’engagement des jeunes et de résister à la tentation d’appliquer les conclusions à d’autres contextes.
5. Les notions actuellement en vogue de « radicalisation », de « dé-radicalisation » et d’« extrémisme violent » doivent être utilisées avec prudence car elles peuvent engendrer l’élaboration de réponses inadéquates. »
Mais à Paris et à N’Djamena, au QG de la force, on préfère ignorer ce genre d’études et balayer d’un revers de la main les alertes des chercheurs. Le principe d’un ennemi à éradiquer car lobotomisé par la propagande salafiste est plus confortable – plus facile à vendre aux journalistes et aux électeurs aussi.
Le 30 novembre 2016, des soldats de la force Barkhane en mission dans la région de Tessalit, dans l’extrême nord du Mali, tirent depuis un hélicoptère
Pourtant, les « experts » n’ont pas toujours tort. Et ils voient parfois même très juste. Dans son texte publié en décembre 2015, Yvan Guichaoua avait carrément prédit l’avenir en posant cette question : « Combien de temps avant qu’une bavure choquante ne se produise ? » Il expliquait en effet que « si les canaux officiels ne fournissent que peu d’information sur l’activité militaire française – hormis pour célébrer les succès opérationnels –, les canaux locaux offrent occasionnellement plus de détails, souvent difficilement vérifiables », et font parfois état de bavures ou de méthodes criticables. Près d’un an plus tard, son avertissement prendra une tournure prémonitoire.
Le 30 novembre 2016, des soldats de la force Barkhane en mission dans la région de Tessalit, dans l’extrême nord du Mali, tirent depuis un hélicoptère sur un enfant de 8 ans que ses parents avaient envoyés chercher les ânes. Puis ils reviennent quelques heures plus tard pour l’enterrer. Ni vu ni connu… Sauf que des habitants du campement voisin ont entendu les tirs et les ont aperçus se démener pour creuser un trou, qu’ils ont alerté la famille de l’enfant, qui le cherchait désespérément, et que celle-ci a filmé la tombe improvisée et les traces d’impact au sol et a envoyé un émissaire à Tessalit pour dénoncer ce meurtre. Pour la première fois depuis le déclenchement de l’opération Serval, la France est pointée du doigt au Mali.

L’affaire, révélée par Jeune Afrique, fait grand bruit début janvier. François Hollande est sommé de s’expliquer alors qu’il se trouve justement à Bamako, où est organisé le 13 janvier le 27ème sommet Afrique-France. Il promet qu’une enquête est en cours et que ses résultats seront rapidement rendus publics. L’armée de son côté, après avoir tenté d’étouffer l’affaire, la minimise en indiquant que l’enfant était un complice des djihadistes. « Le 30 novembre 2016 dans la région d’Aguelhok, les armées françaises en opération ont neutralisé un membre d’un groupe armé terroriste chargé de localiser les éléments des forces françaises au profit de poseurs d’engins explosifs improvisés », explique-t-elle dans un communiqué de presse.
L’enquête ne donnera évidemment rien – les soldats français seront lavés de toute faute par l’enquête interne, publié en novembre 2017 (ce en dépit du fait qu’un rapport de l’ONU publié en 2021 remettra en cause les explications de la France). Mais elle a laissé des traces. L’opération Barkhane n’est pas aussi propre qu’elle n’en a l’air. Les choses ne sont pas aussi simples que ne veut le faire croire l’exécutif. Une partie de la presse commence à regarder cette force avec un regard critique. D’autres bavures seront médiatisées, au Mali et en France. Un exemple qui a heurté les consciences à Bamako : en octobre 2017, la frappe d’un camp d’Aqmi par l’aviation française tue des djihadistes, mais aussi onze soldats maliens qui avaient été faits prisonniers. La France nie toute erreur, mais le gouvernement malien confirme qu’il s’agissait bien de militaires.

Les soldats français mènent des opérations sur le terrain en s’appuyant sur deux milices communautaires anti Peuls
En France, Mediapart révèle en novembre 2018 que les soldats français mènent des opérations sur le terrain avec deux milices communautaires, le Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), constitué de Daoussaks, et le Gatia, la milice du général El Hadg Gamou, constituée de combattants Imghads. Ces mouvements sont accusés d’avoir commis des exactions contre des civils, des Peuls pour la plupart.
Ces accusations proviennent de sources locales et d’associations peules, mais aussi de la Mission des Nations unies au Mali, la Minusma. Celle-ci déplore en avril 2018 que ces deux groupes armés ont tué au moins 95 civils à la frontière entre le Mali et le Niger.
Voilà qui est très gênant pour la France. L’état-major a beau assurer que jamais les soldats français n’ont couvert de crimes, l’armée française s’en est de fait rendue complice en accompagnant ces milices sur le terrain, en leur donnant des conseils et en leur assurant un appui aérien.
Fait notable : cette coopération sur le terrain est intervenue peu de temps après l’élection d’Emmanuel Macron. Après son arrivée à l’Elysée en mai 2017, ce dernier, inquiet de voir l’armée française s’enliser au Sahel, a demandé des résultats tangibles et rapides à l’armée. Il a exigé du chiffre aussi. Sous pression, l’armée, qui était tombée dans une forme de train-train quotidien (convoi, fouilles de villages, déminages, retours à la base), a donc entrepris de multiplier les opérations et les frappes. Des chefs ont encore été tués. Des combattants ont été neutralisés. Mais aucune parcelle de terrain n’a été reprise aux djihadistes. Bien au contraire, ils n’ont cessé d’en gagner.
Dans le centre du Mali, c’est presque toute la zone inondée située entre Mopti et Tombouctou qui tombe sous leur contrôle en 2015 et en 2016. Puis fin 2016, un groupe, Ansarul islam, qui a des liens avec la katiba Macina, prend les armes et occupe une partie du nord du Burkina Faso. Des attaques sont également menées dans des zones à l’origine très éloignées du Nord-Mali : dans la région de Tillabéri au Niger (tout près de la capitale, Niamey), dans le sud-ouest du Burkina, dans la région de Niono au Mali… En 2018, une grande partie de l’est du Burkina, une zone constellée de forêts classées et de parcs nationaux, échappe au contrôle des autorités étatiques et est soumise au joug de djihadistes affiliés au JNIM ou à l’État islamique.
Sur le papier, la force Barkhane est toujours présentée comme une réussite totale : militaire, politique, diplomatique. Mais sur le terrain, c’est l’inverse qui est constaté.
Notre série sur Barkhane (volet 1), le temps de l’insouciance (2014-2016)