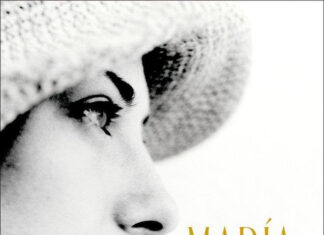Lors d’un colloque à La Sorbonne en juin 2001, l’écrivain Sadek Sellam, sous le pseudonyme d’Hamid Lamine, dressait un bilan des responsabilités françaises dans le coup d’état de 1992 qui écartait le président Chadli du pouvoir. Voici le premier volet de ce texte fondateur sur « l’approbation française du coup d’Etat de 1992 »
QUAND LA FRANCE ENCOURAGEAIT ALGER A INTERROMPRE LE PROCESSUS DEMOCRATIQUE DES ANNEES 1988-1992
La crise algérienne de la décennie noire qui va provoquer la mort de près de 150000 personnes dans une quasi guerre civile aura eu pour prémisse la démission du premier ministre du président Chadli, Mouloud Hamrouche, qui est intervenue le 5 juin 1991. Cette démission d’un gouvernement qui avait tenté de réformer l’économie algérienne et de tenir l’armée à l’écart du pouvoir avait été favorablement commentée par l’hebdomadaire « Vendredi », alors le journal officiel du Parti Socialiste. L’éditorial consacré à cet épisode était illustré par la photo d’un char prise au carrefour de la Grande Poste [1]: « La voie est désormais ouverte à la démocratie »!
Le FIS, bête noire des Français
Le premier ministre réformateur venait d’être victime d’un coup d’Etat non avoué et fomenté par un groupe de civils et de militaires qui le soupçonnaient de se préparer à respecter les résultats des élections législatives qui devaient avoir lieu fin 1991, y compris en cas de victoire des islamistes indépendants des clans du pouvoir. Il était reproché à cette force montante de manquer de « modération », par opposition aux partisans du Cheikh Mahfoud Nahnah, qui n’étaient pas moins attachés à la Charia, mais que les adversaires de l’alternance appréciaient en raison de leurs bonnes relations avec les plus influents parmi les généraux.
La rédaction de Vendredi n’était pas sans savoir que M. Hamrouche avait découvert les vrais mobiles, et les limites, de l’aide apportée par l’Elysée à l’expérience démocratique algérienne. Il s’agissait pour des membres de l’entourage de Mitterrand d’aider par leurs conseils à empêcher le Front Islamique de Salut de remporter aux prochaines élections législatives une victoire aussi éclatante que celle des municipales du 12 juin 1990 [2] . Cette aide comportait notamment le tracé d’une nouvelle carte électorale par des experts français du ministère de l’Intérieur [3] . Selon ce découpage sur mesure, il aurait fallu à un candidat du FIS, pour se faire élire, dix fois plus d’électeurs qu’à un candidat du FLN.
Cela rappelait la composition de l’Assemblée Algérienne de 1948, où les délégués musulmans du deuxième collège, qui représentaient les neuf dixièmes de la population, n’étaient pas plus nombreux que ceux du premier collège, émanation de l’autre dixième constitué par les Européens.
Un ambassadeur appelé Audibert
Cette « aide liée » de la France à la jeune démocratie algérienne avait pour artisan l’ambassadeur Jean Audibert, un ancien animateur de la commission Tiers-Monde du PS devenu conseiller diplomatique à 1’Elysée. Après un passage par la « Françafrique » où il avait eu le loisir de substituer le réalisme de la « culture de gouvernement » à l’idéalisme du discours de Cancun, cette figure représentative de la « diplomatie socialiste » est arrivée à Alger en 1989. Audibert y est vite devenu une sorte de pro-consul qui influençait la vie politique algérienne grâce aux liens étroits avec des responsables comme le général Larbi Belkheir [4] .
Le parti-pris de l’ambassadeur était tel que son entourage recommandait aux journalistes français en visite à Alger d’aller s’instruire auprès de Saïd Sadi, le chef d’une micro-formation régionaliste qui a opté pour l’entrisme, et dont la création était le fruit d’une action concertée entre l’ambassade de France et L. Belkheir. Les jeunes diplomates de l’ambassade de France n’hésitaient pas à comparer ce dialecticien berbériste à P. Mendès-France et à R. Aron réunis. L’homme de confiance de Mitterrand a été jusqu’à oublier le devoir de réserve en donnant son point de vue sur les élections. Dans une déclaration remarquée à l’hebdomadaire Algérie-Actualités, il a en effet fait état de sa qualité de fils d’instituteur attaché à la laïcité et désireux de voir les électeurs algériens partager ses préférences [5] . De telles interventions ravivaient les souvenirs des financements, par le consulat de France à Constantine, de manifestants chargés de déployer, durant les émeutes d’octobre 1988, des pancartes hostiles à l’arabisation et favorables à la langue française [6] .
Le paternalisme de l’ambassadeur était assez conforme à la place accordée aux critères idéologiques et linguistiques dans l’action diplomatique française en Algérie. La primauté de ces considérations amenait le chroniqueur de Vendredi à être peu regardant sur les vraies raisons de l’éviction de Hamrouche. Il était surtout reproché à celui-ci de s’apprêter à accepter le verdict des urnes, et de ne pas exclure de composer avec un courant culturaliste jugé aussi dangereux pour l’influence française que le mouvement des Oulémas réformistes des années 30 [7] .
Sid Ahmed Ghozali, le « moderniste »
La nomination au poste de premier ministre de Sid Ahmed Ghozali, un technocrate presque exclusivement francophone et réputé « moderniste », avait de quoi rassurer les défenseurs de l’influence française en Algérie. Le premier ministre nommé par les militaires a reçu de Matignon un message dithyrambique de félicitations – dont la chaleur n’était peut-être pas sans rapport avec les financements dans les années 70 des « bureaux d’études » du PS par la Sonatrach, dont Ghozali avait été le PDG [8] .
L’indulgence française pour les militaires algériens avait pour origine la crainte irrationnelle des islamistes (laquelle résultait de la méfiance à l’égard de l’Islam), ainsi qu’un ersatz de reconnaissance pour les financements occultes. Elle a reçu une caution savante lorsqu’une équipe de politologues de Paris est rentrée d’Algérie avec un préjugé très favorable à l’armée algérienne. Après avoir passé une partie de l’été 1991 à faire des « enquêtes de terrain », ces « algérologues » occasionnels étaient persuadés que les généraux n’allaient plus jamais intervenir en politique [9] ! Grâce à l’audience qu’ont les politologues dans le monde politico-médiatique, leur parti-pris a durablement influencé une bonne partie des commentateurs de l’actualité algérienne. Ces enquêteurs contribuèrent à accréditer, en France et en Algérie, la thèse du déclin inéluctable du FIS, au vu du bilan contrasté de la gestion des municipalités par les islamistes [10] .
Vers l’annulation du scrutin
Ces précédents dénotent un état d’esprit extrêmement favorable aux adversaires d’une véritable alternance en Algérie. D’où le bon accueil fait en France à la « démission » du président Chadli, et, surtout, à l’interruption du processus électoral.
L’ambassadeur de France à Alger a été mis dans la confidence par les artisans de cette périlleuse opération. Invité durant l’automne 1992 au cercle Bernard Lazare, J. Audibert a révélé que le président Chadli lui avait téléphoné le lendemain du premier tour des élections législatives du 26/12/1991, pour lui annoncer son intention de « cohabiter » avec les vainqueurs de ce scrutin. Le diplomate dit avoir exprimé ses doutes sur les chances de succès de cette cohabitation, malgré l’engagement de gouverner dans le cadre de la Constitution de 1989 pris par Abdelkader Hachani, le chef du FIS qui venait de frôler la majorité au premier tour. Ce qui excluait a priori la proclamation d’une « République Islamique ».
Mais J. Audibert a eu une réaction plus enthousiaste quand son ami le général Belkheir, à l’époque le véritable « parrain » de l’institution militaire, est venu lui annoncer, quelques jours plus tard, l’intention de ses pairs du collège des généraux d’annuler les résultats d’une élection pourtant qualifiée par le premier ministre de « propre et honnête ». L’ambassadeur a dû informer immédiatement F. Mitterrand d’une décision si lourde de conséquences. En dehors d’une demande concernant la sécurité de Chadli, le président socialiste a apporté sa caution au plan des généraux qui reçurent début janvier son émissaire, le général arabisant Philippe Rondot, pour lui communiquer les détails sur la création de la direction collégiale qui sera chargée de gérer l’état d’urgence. L’officier de renseignement a pris pour argent comptant les promesses des putschistes de mettre en pratique leur opération dans « le respect des droits de l’homme ». L’annonce de la nomination dans le Haut Comité d’Etat d’Ali Haroun, un avocat d’affaires qui avait été désigné ministre des droits de l’homme dans le gouvernement de Ghozali, lui paraissait être une garantie suffisante [11] .
Le coup d’état du « soulagement »
C’est ainsi que la France a décidé de bénir à l’avance ce qu’un éditorialiste de gauche appellera, avec une singulière audace, le « coup d’Etat du soulagement »(sic).
Le caractère anti-constitutionnel de l’opération a été oublié sous l’effet des promesses d’en finir en quelques mois avec les radicaux du FIS qui réagiront par la violence. Une vision économiciste des problèmes algériens faisait escompter l’afflux de plusieurs milliards de dollars, qui auraient été versés par l’Europe pour servir à la relance de l’économie, comme une manière de reconnaissance à un régime qui se disait soucieux de sauver toute la région d’une « contagion fondamentaliste ».
(1) No du 11/5/1991 de l’hebdomadaire Vendredi.
[2] J. Attali et J.L. Biancho faisaient de fréquents séjours à Alger en atterrissant à la base militaire de Boufarik, afin d’éviter les indiscrétions de l’aéroport international d’Alger.
[3] Selon les révélations faites à l’époque, cette équipe a travaillé sous la houlette du juriste et politologue Maurice Duverger.
[4] Général-Major issu de l’armée française qu’il n’avait quittée que peu de temps avant l’indépendance de l’Algérie. Il a eu une ascension fulgurante après l’arrivée de Chadli Bendjedid au pouvoir en 1979. On lui attribue la décision de traduire en justice Messaoud Zeggar, l’ancien homme de confiance de Boumédiène qui avait noué des relations avec les Américains au grand dam des Français. Voir Hanafi Tagamout, L’Affaire Zeghar, Paris, Publisud, 1993.
Après avoir donné de pareils gages, L. Belkheir est devenu le garant de l’influence française dans l’Algérie des années 1980 et 1990. Grâce à lui, Audibert pouvait obtenir la nomination des cadres francophiles à des postes importants. (Entretiens avec un ancien collaborateur de M. Hamrouche).
L’influent ambassadeur intervenait pour vérifier les contenus des résolutions de colloques, comme celui qui a été organisé début mars 1991 à Alger contre la guerre du Golfe. Audibert a réécrit le texte de ces résolutions pour supprimer toute appréciation déplaisante sur F. Mitterrand, qui était honni en raison de son militantisme pour la « logique de guerre ».
[5] lnterview publiée début novembre 1991.
[6] Entretien avec l’ancien président de l’Union des Ecrivains Algériens Larbi Zoubiri, qui était aussi un proche collaborateur du patron du FLN d’alors, M.C. Messadia.
[7] Selon l’avis exprimé par l’ancien directeur des Affaires Musulmanes au Gouvernement Général d’Alger, Augustin Berque, dans un document inédit daté de 1932.
[8] Des photocopies de chèques versés par l’Algérie pour le financement des campagnes électorales du PS de 1981 ont été publiées en 1984 par le magazine El Badil qu’éditait le Mouvement pour la Démocratie en Algérie de Ben Bella, puis par le Canard Enchaîné sans que ces révélations aient été démenties.En acceptant le contrôle de la mosquée de Paris par l’Algérie,le ministre de l’Intérieur G. Defferre a récompensé, en 1982, ces largesses, contre l’avis des juristes du culte, et au mépris des Français musulmans.
La droite a également bénéficié des largesses de l’Algérie pour le financement de ses campagnes électorales. Elle a seulement été plus discrète que la gauche.
[9] Les têtes pensantes des généraux, futurs éradicateurs, envisageaient alors de déclencher une guerre-éclair contre le Maroc juste pour disposer d’un prétexte pour renoncer aux élections tant redoutées.
Le démenti apporté à ces pronostics optimistes par le tournant du 11janvier 1992 a amené une bonne partie de ces politologues à renoncer définitivement à l’étude du système politique algérien : l’espoir de ce groupe fait de la vulgarisation historique à la télévision ; un autre ex-futur algérologue a été placé à l’émission islamique de France 2 où il montre chaque dimanche la maigreur théologique de l’islamologie de Sciences-Po ; les plus tenaces enquêtent sur les hommes d’affaires algériens ou les à-côtés mercantiles de l’éradication et se laissent décourager par la complexité d’un problème d’essence politique. Ces choix ont laissé le champ libre à l’islamo-futurologie de Gilles Képel qui, en examinant l’islamisme dans le monde à travers l’éviction brutale du FIS algérien, a imprudemment prédit la fin d’un courant qui a montré sa vitalité à de nombreuses reprises depuis la parution de son Djihad, Gallimard, Paris, 2000.
[10] Cette confusion entre les désirs et la réalité a été momentanément confortée par les résultats d’un sondage effectué par un institut algérien qui attribuait au FIS le tiers des suffrages, au même titre que le FLN et le FFS. Ce pronostic réconfortait ceux qui redoutaient une vraie alternance et admettait la très faible audience des petites formations comme le Hamas, le RCD et le PRA, dont les chefs de file s’avéreront mauvais perdants en appelant à l’interruption des élections.
[11] La visite faite à Alger par P. Rondot, début janvier 1992, avait été annoncée par la presse après le coup d’Etat du 11 janvier 1992. F. Mitterrand avait eu une conversation téléphonique avec l’homme fort du régime, le général-major Khaled Nezzar. Voir Abdelhamid Brahimi, Hizb França, Lausanne, Hoggar, 2000, p. 265.
Dans le deuxième volet de notre enquête, nous reviendrons sur « la France, vent debout contre l’intégrisme musulman »