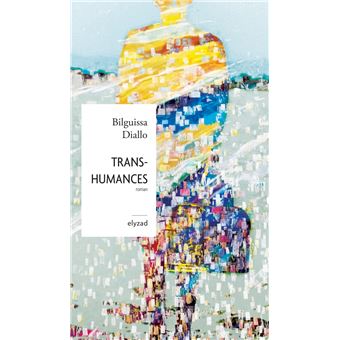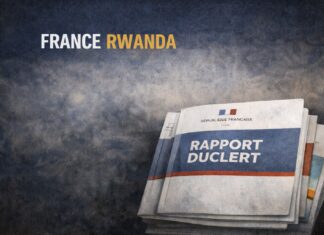Bilguissa Diallo signe avec Transhumances un roman polyphonique ancré dans la Guinée contemporaine. À partir du massacre du stade du 28 septembre 2009 à Conakry, elle déploie le récit de cinq jeunes Guinéens dont les trajectoires se fracturent brutalement ce jour-là. Entre Paris, Dakar et Conakry, l’autrice compose une cartographie de l’exil — géographique, corporel et intime — tout en interrogeant les possibilités de reconstruction après le trauma collectif et individuel.
Le roman s’ouvre sur une scène prophétique : Adama, qui n’a que peu dormi à cause de la chaleur et des moustiques, fait un rêve prémonitoire où il se voit “à la tête d’un groupe, dans une large étendue où s’opposent des jeunes et des êtres surarmés“. À son réveil, il se prépare pour cette journée qui “sera un tournant pour le pays”. La date est d’ailleurs “symbolique” : c’est celle du référendum qui avait vu les Guinéens dire “NON au projet de communauté franco-africaine porté par le général de Gaulle à l’été 1958″. Cinquante et un ans plus tard, c’est à un autre abus de pouvoir qu’Adama et ses amis veulent dire non : le maintien du capitaine Moussa Dadis Camara à la tête du pays, après son coup d’État.
Cette mise en place, en apparence classique, révèle pourtant toute la densité historique du roman. Bilguissa Diallo inscrit d’emblée son récit dans une continuité de luttes contre diverses formes d’oppression : coloniale hier, dictatoriale aujourd’hui. La Guinée apparaît comme le terrain d’affrontements cycliques entre aspirations populaires et confiscation du pouvoir. Cette dimension historique n’est jamais didactique. En effet, l’autrice distille les informations à travers les souvenirs des personnages, comme lorsque Diaraye, la mère d’Adama, se remémore la peur qui l’habitait enfant quand elle entendait “La Voix de la Révolution à la radio“, où “on citait les traîtres à la patrie”. Ce passé traumatique se transmet malgré les silences : “Elle lisait la crainte dans les yeux de son père, sentait l’effroi dans le silence des adultes, mutiques face à ses questions.“
L’expérience du 28 septembre 2009 est décrite avec une précision glaçante : les coups, les viols, la panique, les balles. Bilguissa Diallo nous fait progressivement entrer dans l’horreur : “Derrière lui, Sadou s’est vidé de son sang et personne n’y prête attention, car chacun cherche à sauver ce qui lui reste de vie. Au stade ce jour, les digues d’une violence contenue pendant des décennies ont lâché.” La violence éclate comme le symptôme d’une société où “tout était sale dans cette ville, surtout depuis ces derniers temps. L’atmosphère était pourrie et la moisissure s’insinuait dans tous les interstices, même dans les rapports humains.“
Ce qui fait la force du roman, c’est la manière dont cette violence collective infiltre les corps et les âmes des personnages. Aucun n’en sort indemne, même ceux qui n’étaient pas physiquement présents au stade. La tragédie irradie, contamine les consciences, modifie les trajectoires. En cela, le roman de Bilguissa Diallo s’inscrit dans une tradition littéraire qui fait du corps le réceptacle des violences historiques – comme ont pu le faire Assia Djebar dans L’Amour, la fantasia ou Scholastique Mukasonga dans Notre-Dame du Nil.
Être Peul en Guinée, être Guinéen ailleurs
Les personnages de Transhumances sont d’abord définis par leur appartenance à l’ethnie peule, majoritaire en Guinée, mais historiquement marginalisée. Cette dimension ethnique, souvent instrumentalisée politiquement, traverse tout le roman. Lors du viol de Dalanda, les militaires lui crachent : “Bandes de putes peules, c’est ça que vous méritez ! […] On ne fera pas de quartier, enfants ou vieillardes, vous allez toutes y passer, et après on vous finira, comme ça on sera tranquilles dans ce pays ! Vous saurez qu’il est à nous !“
Cette violence ethnique traverse également le processus électoral décrit plus tard dans le roman : “Le candidat qui comptabilisait à peine vingt pour cent des suffrages est parvenu à surpasser celui qui aurait presque pu être élu dès le premier tour, avec plus de quarante pour cent des voix.” Ce détournement démocratique se fait sur fond de tensions identitaires : “Désormais, en Guinée, on pense en terme ethnique, sans même s’en défendre. L’ethnie majoritaire est peu à peu devenue une sorte d’ennemi intérieur, un État dans l’État. Il y a les Peuls, et il y a les autres.”
Cette fracture identitaire se répercute dans la diaspora, où les personnages éprouvent d’autres formes de décentrement. Alassane, à Paris, se sent “ni totalement français, pas vraiment guinéen“, tandis qu’Adama découvre à Dakar qu’il peut être “anonyme et couleur locale” tout en n’étant “pas un Guinéen lambda non plus. Cette condition d’entre-deux est magistralement résumée par la formule : “En France il était un Français diminué, en Guinée, un Guinéen augmenté.”
La question identitaire traverse même les rapports hommes-femmes, comme l’illustre le mariage d’Awa et Alassane – union arrangée qui révèle les contradictions intérieures des personnages. Quand ils se retrouvent dans leur chambre d’hôtel : “Elle avait été surprise de son audace, réalisant qu’il fallait y repasser […]. Aucun recul possible malgré les images d’horreur qui se bousculaient dans sa tête et la grimace qu’elle ne pouvait réprimer. Lui ne voyait rien ou ne voulait rien voir, il avait envie.” Dans cette scène, l’autrice touche avec justesse aux zones grises du consentement, sans jamais tomber dans le manichéisme.
La transhumance comme métaphore existentielle
Le titre du roman, Transhumances, offre une métaphore complexe qui se déploie au fil des pages. Dans son acception première, la transhumance désigne le déplacement saisonnier des troupeaux en quête de nouveaux pâturages. Ici, elle devient le symbole d’une condition humaine marquée par l’errance et la quête d’un lieu habitable. Les personnages transhumants sont nombreux : Adama fuit Conakry pour Dakar après avoir été menacé pour son engagement politique ; Awa rejoint Alassane à Paris dans un mariage précipité ; Dalanda retourne au village natal après le traumatisme du viol. Chacun cherche des “pâturages” plus cléments, mais doit affronter de nouvelles épreuves.
Car la transhumance n’est pas qu’un mouvement géographique, elle est aussi déplacement intérieur, transformation psychique. On le voit notamment avec Dalanda qui, après le viol, constate que “la nouvelle Dalanda refait surface, cette femme étrangère aux traits de l’aimée.” Le trauma l’a exilée d’elle-même, l’a rendue étrangère à son propre corps.
Ces déplacements permanents engendrent une sensation de non-appartenance qui saisit même Alassane, pourtant né en France : “Étais-il parti en Afrique voir ce qu’il était possible d’y réaliser. C’était la seconde fois qu’il effectuait un tel voyage.” Il incarne cette génération née en France qui cherche ses racines dans un “ailleurs” idéalisé, mais se retrouve confrontée à une autre forme d’altérité.
En filigrane, Bilguissa Diallo interroge la possibilité même de l’enracinement dans un monde fracturé. Peut-on encore appartenir à un lieu quand l’Histoire a transformé l’espace natal en territoire hostile ? Qu’est-ce qu’habiter un pays qui mutile ses enfants ? Comment faire sienne une terre étrangère quand on porte en soi les stigmates du déracinement ? Ces questions tissent la trame existentielle du roman.
Une poétique du fragment et du silence
Le titre du roman, Transhumances, offre une métaphore complexe qui se déploie au fil des pages. Dans son acception première, la transhumance désigne le déplacement saisonnier des troupeaux en quête de nouveaux pâturages. Ici, elle devient le symbole d’une condition humaine marquée par l’errance et la quête d’un lieu habitable. Les personnages transhumants sont nombreux : Adama fuit Conakry pour Dakar après avoir été menacé pour son engagement politique ; Awa rejoint Alassane à Paris dans un mariage précipité ; Dalanda retourne au village natal après le traumatisme du viol. Chacun cherche des “pâturages” plus cléments, mais doit affronter de nouvelles épreuves.
Car la transhumance n’est pas qu’un mouvement géographique, elle est aussi déplacement intérieur, transformation psychique. On le voit notamment avec Dalanda qui, après le viol, constate que “la nouvelle Dalanda refait surface, cette femme étrangère aux traits de l’aimée.” Le trauma l’a exilée d’elle-même, l’a rendue étrangère à son propre corps.
Ces déplacements permanents engendrent une sensation de non-appartenance qui saisit même Alassane, pourtant né en France : “Étais-il parti en Afrique voir ce qu’il était possible d’y réaliser. C’était la seconde fois qu’il effectuait un tel voyage.” Il incarne cette génération née en France qui cherche ses racines dans un “ailleurs” idéalisé, mais se retrouve confrontée à une autre forme d’altérité.
En filigrane, Bilguissa Diallo interroge la possibilité même de l’enracinement dans un monde fracturé. Peut-on encore appartenir à un lieu quand l’Histoire a transformé l’espace natal en territoire hostile ? Qu’est-ce qu’habiter un pays qui mutile ses enfants ? Comment faire sienne une terre étrangère quand on porte en soi les stigmates du déracinement ? Ces questions tissent la trame existentielle du roman.
Le travail du temps et les multiples visages de la guérison
Transhumances n’est pas qu’un roman sur le trauma. C’est aussi un récit qui interroge les possibilités de reconstruire une vie après la catastrophe. Les personnages tracent différents chemins : l’engagement politique pour Adama et Lamine, la maternité pour Awa, la vengeance pour Dalanda.
Le roman propose ainsi une réflexion nuancée sur la mémoire et le pardon. Faut-il oublier pour avancer ? Peut-on pardonner l’impardonnable ? Comment la mémoire traumatique peut-elle devenir une force plutôt qu’un piège ? Ces questions hantent les personnages, comme lorsque Dalanda “prie pour que mes frères trouvent un terrain d’entente et que tous, nous puissions aspirer à des jours plus heureux. Pour cela, il nous faut regarder nos crimes en face, analyser nos failles d’hier et nos lâchetés collectives.”
La note finale de l’autrice rappelle que “treize ans après le 28 septembre 2009, s’est enfin ouvert à Conakry le procès de Moussa Dadis Camara et de dix autres responsables.” Cette mise en perspective souligne l’actualité brûlante du roman, sa dimension testimoniale, et sa participation à un travail collectif de mémoire qui refuse l’oubli.
Transhumances s’impose ainsi comme une œuvre nécessaire, qui fait de la littérature non pas un refuge coupé du monde, mais un espace où s’élabore une pensée critique face aux violences de l’Histoire. En donnant chair et voix aux transhumants d’aujourd’hui – ces êtres déplacés, déchirés entre plusieurs mondes – Bilguissa Diallo nous invite à repenser l’appartenance et l’identité au-delà des frontières nationales, tout en nous rappelant qu’aucune société ne peut se construire sur le déni de ses blessures.
Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique