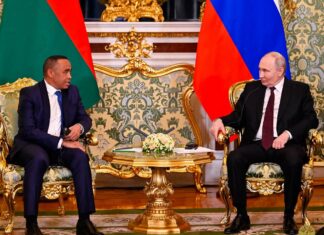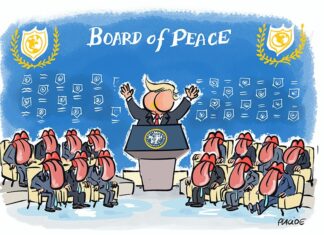Né dans un milieu pauvre en Amérique latine, François aura été le premier pape à représenter ce qu’on appelait naguère le tiers-monde. Il était le premier pape non-européen depuis mille trois cents ans. Le dernier non-Européen fut le Syrien Grégoire III, qui dirigea l’Église catholique de 731 à 741.
Renaud Girard, chroniqueur du Figaro, avec son aimable autorisation
Le plus bel hommage qui lui a été rendu est venu du fils d’un Kényan noir et d’une Américaine blanche, qui s’est converti au christianisme lorsqu’il était étudiant, Barack Obama. « Le pape François était l’un des rares leaders à faire en sorte que nous voulions devenir des gens meilleurs », a écrit, le 21 avril 2025, celui qui fut président des États-Unis de 2009 à 2017. « Il nous a bousculés dans notre résignation (face à la misère) et nous a rappelé que nous avions tous des obligations morales envers Dieu et envers les autres », a ajouté Barack Obama dans son tweet.
«Des obligations morales envers Dieu et envers les autres»
Durant son ministère en Argentine puis à Rome, François a été le témoin d’un immense paradoxe. Dans les dernières décennies du XXe siècle et les premières du XXIe, le christianisme a régressé dans les régions où il était établi depuis le plus longtemps, à savoir l’Europe et le Moyen-Orient, alors qu’il progressait dans les régions de relativement fraîche conversion, comme l’Afrique.
La régression du christianisme au Moyen-Orient et en Europe a des causes tout à fait différentes. Elles sont politiques dans le premier cas et sociales dans le second.
À lire aussi Pape François : un « signe de contradiction » pour le monde et dans l’Église
Au Moyen-Orient – région de naissance du Christ, de sa prédication et de celle de ses apôtres -, le christianisme s’est heurté à un islam de plus en plus radical, de plus en plus intolérant, à partir du début du XXe siècle. En Anatolie, le génocide des Arméniens de 1915, a brutalement éliminé l’une des plus anciennes communautés chrétiennes d’Orient. En 1928, Hassan al-Banna fondait, en Égypte, le mouvement très radical des Frères musulmans, dont l’idéologie s’est étendue à l’ensemble du monde arabo-musulman. C’est une idéologie suprémaciste, celle de la suprématie de l’islam sur les deux religions monothéistes l’ayant précédé, le judaïsme et le christianisme, dont les fidèles sont, au mieux, condamnés à la dhimmitude.
L’autocrate qui préside depuis vingt ans aux destinées de la Turquie est lui-même un Frère musulman. Il n’est pas étonnant qu’il ait aidé militairement l’Azerbaïdjan, son allié pantouranique, à vider, à l’automne 2023, l’une des plus vieilles communautés chrétiennes d’Orient, le Haut-Karabakh.
L’amitié entre les religions
La radicalisation de l’islam est la première cause de la lente disparition du christianisme en Orient, que ce soit en Mésopotamie, en Syrie, ou même en Haute-Égypte. Dans leurs conquêtes coloniales, les Européens n’ont jamais cherché à évincer l’islam. En revanche, les Frères musulmans et les djihadistes (qui sont des Frères prêts à aller jusqu’au bout de leurs idées) ne supportent pas la présence chrétienne, ou juive, en terre d’islam. En 2024, cinq mille chrétiens ont été tués pour le seul crime de pratiquer leur foi. La très grande majorité de leurs tueurs étaient des musulmans radicalisés.
« Reconnaissable à son effondrement démographique, le malaise de l’Europe est qu’une grande partie de sa jeunesse ne maîtrise même plus la connaissance du christianisme, qui est pourtant fondateur de sa civilisation ». Renaud Girard
En revanche, certains États musulmans modernes, comme les Émirats arabes unis, prêchent la tolérance et l’amitié entre les religions, comme le faisait d’ailleurs le pape François. Je conseille à tous nos lecteurs faisant escale à Abu Dhabi la visite de la magnifique « maison abrahamique », inaugurée en 2023. Sur ce site au bout d’une île, non loin de celui du Louvre, coexistent, dans une beauté à couper le souffle, une synagogue, une église, et une mosquée, dessinées par le même architecte. Les fidèles de toutes les religions s’y précipitent.
Au cours des vingt-cinq dernières années, les musulmans sont passés de 1,3 milliard à 2 milliards d’êtres humains. Les chrétiens ont connu une moindre progression : ils sont passés de 2 milliards à 2,5 milliards (dont 270 millions de progression rien qu’en Afrique). Il ne serait pas incongru que le prochain pape soit un Africain. En tout cas, quelle que soit sa nationalité, l’une de ses priorités devra être la consolidation d’une coexistence entre les deux premières religions du monde, le christianisme et l’islam.
Deux défis majeurs
En Europe, le recul du christianisme s’est fait parallèlement à la progression de l’idéologie consumériste. Ce qu’un homme consomme ou possède y devient plus important que ce qu’il est culturellement et spirituellement. L’avoir l’emporte sur l’être. L’Union européenne a refusé d’inscrire dans sa Constitution que ses racines étaient chrétiennes (à l’instigation de Jacques Chirac, hélas, mille fois hélas). À Bruxelles, on a toujours un peu de mal à comprendre que les hommes sont des êtres culturels avant d’être des agents économiques.
Reconnaissable à son effondrement démographique, le malaise de l’Europe est qu’une grande partie de sa jeunesse ne maîtrise même plus la connaissance du christianisme, qui est pourtant fondateur de sa civilisation. La liberté, l’égalité, la fraternité, sont des valeurs directement héritées du christianisme.
En prenant sa charge, le prochain pape ne trouvera pas une situation catastrophique. Le message chrétien d’amour est encore attendu à travers les cinq continents. Deux défis majeurs devront cependant être relevés : la bonne coexistence avec l’islam, la rechristianisation de la vieille Europe.