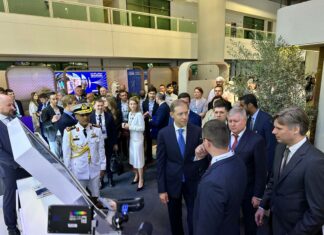Dans « La guerre perdue d’Algérie », Charles Ceccaldi-Raynaud, militant SFIO et commissaire à Alger de 1950 à 1958, dénonce les pratiques de torture. Voici l’avant-propos, signé par Sadek Sellam
 L’insurrection du premier novembre 1954 en Algérie a été perçue par l’ensemble de la classe politique française comme « un coup de tonnerre dans un ciel serein ». La quiétude des politiques était confortée par les propos rassurants que leur tenaient des spécialistes influents comme Robert Montagne qui mettait ses savoirs ethnographiques et islamologiques au service des politiques coloniales. Pour se dispenser d’une réflexion approfondie, les hommes politiques de la IVe République préféraient s’en remettre à de pareils « experts » dont on surestimait la prescience. C’est sans doute en souvenir d’une fameuse conférence qui avait été prononcée à Rabat par cet ancien de la guerre du Rif devenu professeur au Collège de France (après avoir cautionné savamment le Dahir berbère de 1930 au Maroc) que le ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Mendès France tenait à être rassurant. Le 29 septembre 1954, Mitterrand déclarait en effet qu’« il ne faut pas énerver l’opinion par la répression, le MTLD étant représenté au Parlement. D’ailleurs le pays est calme. »(1). Mais, en réponse à Louis Massignon, venu début novembre 1954 le mettre en garde contre l’usage de la torture en Algérie où débutait la politique de répression, le même Mitterrand a tenu à avertir: « Monsieur le professeur, dans le passage de la pensée à l’action, il y a de l’impur. »(2).
L’insurrection du premier novembre 1954 en Algérie a été perçue par l’ensemble de la classe politique française comme « un coup de tonnerre dans un ciel serein ». La quiétude des politiques était confortée par les propos rassurants que leur tenaient des spécialistes influents comme Robert Montagne qui mettait ses savoirs ethnographiques et islamologiques au service des politiques coloniales. Pour se dispenser d’une réflexion approfondie, les hommes politiques de la IVe République préféraient s’en remettre à de pareils « experts » dont on surestimait la prescience. C’est sans doute en souvenir d’une fameuse conférence qui avait été prononcée à Rabat par cet ancien de la guerre du Rif devenu professeur au Collège de France (après avoir cautionné savamment le Dahir berbère de 1930 au Maroc) que le ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Mendès France tenait à être rassurant. Le 29 septembre 1954, Mitterrand déclarait en effet qu’« il ne faut pas énerver l’opinion par la répression, le MTLD étant représenté au Parlement. D’ailleurs le pays est calme. »(1). Mais, en réponse à Louis Massignon, venu début novembre 1954 le mettre en garde contre l’usage de la torture en Algérie où débutait la politique de répression, le même Mitterrand a tenu à avertir: « Monsieur le professeur, dans le passage de la pensée à l’action, il y a de l’impur. »(2).
Guerre d’Algerie : le déchirement
Une semaine plus tard, Mitterrand annonçait à l’Assemblée Nationale qu’en Algérie, « la seule négociation, c’est la guerre ! » Joignant le geste à la parole, le ministre de l’Intérieur, devenu en fait celui de la Guerre, a dépêché dans les Aurès plusieurs bataillons de parachutistes et ordonna à leur chef, le colonel Ducournau : « Allez là-bas et balayez-moi tout ça. »(3). C’est après l’envoi de ces renforts, que le député de Constantine, le docteur Bendjelloul (qui était médecin de colonisation dans les Aurès et parlait donc en connaissance de cause) a protesté contre les bombardements au napalm dans la région d’Ichmoul. À ces graves accusations, Mitterrand s’est contenté d’opposer des dénégations plus embarrassées que convaincantes. Il a eu la même attitude quand le député de Batna, Benbahmed, lui a signalé de nombreux cas de mauvais traitements infligés par des policiers, des militaires et même des administrateurs de commune mixte (habitués de longue date à la confusion du judiciaire et du policier), à des suspects ne bénéficiant pas de la présemption d’innocence. La France s’est trouvée installée ainsi dans la guerre, non pas par quelque va-t-en-guerre désireux de venger Dien Bien Phu dans les djebels, mais par un « humaniste » qui passait lentement de la droite (voire de l’extrême-droite) vers le centre gauche, et qui était persuadé de devenir l’artisan d’une victoire rapide sur une insurrection sous-équipée. Il croyait surtout qu’une telle victoire servirait sa carrière politique. Cette option répressive de novembre 1954 a condamné le gouvernement Edgar Faure (qui a succédé à celui de Mendès France en février 1955) à intensifier une guerre qui n’osait pas dire son nom. On pensait que la création des SAS et la politique d’intégration (4) du gouverneur général Jacques Soustelle allaient apporter une solution rapide au conflit. Les Sections Administratives de Sécurité, avaient été crées dans le cadre des états d’urgence locaux d’avril 1955 et inspirées des «Bureaux Arabes» du Second Empire qui furent supprimés par les assimilationnistes de la IIIe République. Le projet de promotion d’une « Troisième Force » sur laquelle misait Soustelle a été fortement contrarié par « l’Appel des 61 » qui dénonçait la dureté de la répression, et qui jugeait la politique d’« intégration totalement dépassée ». Pour les modérés élus musulmans signataires de ce texte – que Soustelle cherchait à mettre à la tête de sa future « Troisième Force », l’Algérie a « vocation à être une Nation indépendante ». C’est après ces déconvenues que l’ancien, et brillant, ethnographe spécialisé dans l’étude de l’Amérique précolombienne, qui était arrivé à Alger avec des idées « progressistes », fit son deuil de la « Troisième force »(5), et décida de réserver sa sympathie aux seuls Pieds-Noirs qu’il comparait aux Aztèques – et les Musulmans aux colons espagnols ! En réponse à ceux qui recommandaient de négocier avec des « interlocuteurs valables », le supérieur hiérarchique de Soustelle, Bourgès-Maunoury, ministre de l’Intérieur de Faure, répondit, le 13 mai 1955 : « Il n’est pas question pour la France de chercher un interlocuteur en Algérie où la répression sera impitoyable ».
Des horreurs complaisantes
Ce successeur de Mitterrand à la place Beauvau ne leva pas le petit doigt quand Moulay Merbah (un adjoint de Messali) a été torturé par l’inspecteur Forcioli, auteur de deux meurtres de sang froid. Ces deux crimes valurent à ce policier (qui devient plus exalté que républicain dès qu’il traverse la Méditerranée) d’être seulement muté en France, sans jamais avoir été jugé, ni condamné. Bien avant le 1er novembre 1954, la justice coloniale était déjà complaisante avec la police. Moulay Merbah faisait partie des suspects raflés à l’aveuglette que le commandant Monteil, du cabinet militaire de Soustelle, voulait faire libérer. Mais cette « politique de détente » a buté sur l’opposition obstinée du procureur général Susini, « poulain » de René Mayer (le tombeur de P. Mendès France), et beau-frère du tout-puissant sénateur radical-socialiste Borgeaud. Ne s’avouant pas vaincu, Monteil essaya de faire approuver cette politique par le Garde des Sceaux, Robert Schuman. Mais l’ancien président du Conseil MRP lui avoua son impuissance : « Vous savez qui a nommé à Alger M. Susini ? C’est R. Mayer. Eh bien on ne se bat pas contre R. Mayer ! ». L’impasse dans laquelle s’est trouvé le gouvernement E. Faure l’a amené à dissoudre l’Assemblée nationale pour provoquer des élections législatives anticipées. Pendant la campagne électorale, « le Populaire », l’organe de la SFIO, s’est fait l’écho, dans un numéro de janvier 1956, d’un grand désir de paix chez les militants et sympathisants socialistes : « Finie la répression féroce et imbécile. Qu’on en finisse, que l’on recherche des interlocuteurs représentatifs des aspirations populaires, que l’on fasse des élections libres ». « Les jeunes Français ne veulent être ni complices d’assassinats préméditées, ni victimes expiatoires des erreurs commises par ceux qui n’ont pas voulu en temps utile rechercher en Afrique du Nord les interlocuteurs valables et négocier avec eux ».
La gauche complice
Le Front Républicain a gagné les élections législatives de janvier 1956 et le gouvernement Guy Mollet a commencé par faire de la paix promise en Algérie son objectif principal. Mais la seule mention du nom du général Catroux pour succéder à Soustelle a suscité l’ire des ultras d’Alger. Les plus radicaux envisageaient même l’assassinat du président du Conseil à son arrivée à Alger le 6 février 1956, et projetait la formation d’un nouveau gouvernement à Alger (6). J. Mairey, le directeur de la Sureté Nationale a été averti de ce qui se tramait par Loffredo, inspecteur de police à Alger, qui connaissait depuis 1939 Achiary (le sous-préfet de Guelma qui s’était illustré dans les tueries de mai 1945) et qui était mêlé au plan d’assassinat de Guy Mollet. On sait maintenant qu’en dénonçant le complot, Loffredo songeait à se couvrir. En effet, Mairey avait fait effectuer une enquête personnelle après la mort de Kassem Zeddour. Ce suspect avait été arrêté à Oran le 3 novembre 1954 par la DSTqui s’est empressée d’annoncer son « évasion ». Il est apparu que les hommes de Loffredo étaient responsables de la mort de Zeddour. Loffredo avait d’ailleurs avisé le préfet Vaujour (7) du meurtre. Il avait décidé que l’affaire ne serait pas ébruitée pour raison d’État. Pour mieux étouffer l’affaire, Soustelle a même eu recours à Massignon qui, à grand renfort de poésie mystique arabe, a tenté de dissuader le père du supplicié de porter plainte. Mais les confidences de Loffredo furent enregistrées au magnétophone. C’est ainsi que pour se « dédouaner » entièrement Loffredo est allé voir Mairey. Guy Mollet a choisi de donner des gages aux ultras en renonçant à nommer le général Catroux à Alger. Il lui a préféré un homme à poigne, l’ancien chef syndicaliste et résistant Robert Lacoste, dont les attributions se sont trouvées accrues par le titre de « ministre-résidant. »(8). Comme tous les candidats du Front Républicain, Lacoste avait fait campagne pour la paix en Algérie (9). « Pour la paix, votez Socialiste et Front républicain », lisait-on dans les tracts de la SFIO. Guy Mollet promettait de « garantir la paix en recherchant par la négociation les formes d’une association librement consentie qui conviennent à chaque territoire ». Mais, dès le 11 février 1956, le Garde des Sceaux F. Mitterrand, resté fidèle à sa politique algérienne de novembre 1954 a ordonné d’enchaîner les condamnés à mort algériens dont il avait refusé le recours en grâce.
Le 16 février 1956, Guy Mollet a envisagé, de donner, pour le maintien de l’ordre, des moyens exceptionnels à Lacoste. Ce seront les « pouvoirs spéciaux », votés en mars, y compris par les communistes (10), pour « légaliser » la généralisation de pratiques aussi vieilles que la barbarie du début de la conquête, et qui étaient adaptées au goût du jour à chaque fois que le système colonial se sentait menacé. Le 19 mars, le Garde des Sceaux a signé le décret qui le dessaisit, en Algérie, en faveur des tribunaux militaires, même dans la phase de l’instruction, pour des faits commis après le 30 octobre 1954. La « légalité » républicaine du Front du même nom autorisait les perquisitions, de jour comme de nuit, au domicile des citoyens. En donnant un habillage légal à des pratiques dignes du colonel Montagnac (qui décrivit tranquillement la barbarie de la conquête dans « Lettres d’un soldat », paru en 1885) et des régimes totalitaires, les « pouvoirs spéciaux » ont transformé l’Algérie en une vaste zone de non-droit. Encouragés par l’abdication du pouvoir politique en leur faveur, les militaires se lancèrent dans une politique de déplacement de populations en multipliant les zones interdites dont les anciens habitants, plus de 2 millions, furent parqués dans des « camps de regroupement » (11). La torture, qui avait été pratiquée par des administrateurs de commune mixte, par des policiers persuadés que la guerre pouvait être gagnée par le renseignement et même par les SAS, est devenue la spécialité des DOP (Dispositif Opérationnel de Protection) qui synchronisaient à partir de septembre 1956 les recherches du 2e Bureau, de la Gendarmerie, de la DST, des Renseignements Généraux et de la Police Judiciaire. Tout algérien devenu suspect pouvait être enlevé, interrogé, torturé et enfermé dans des « camps d’hébergement » (que le résistant Claude Bourdet n’hésitait pas à appeler camp de concentration ), sans trop tenir compte de l’instance judiciaire. En application du décret des pouvoirs spéciaux, et face aux grandes difficultés rencontrées par la « pacification », le 2e Bureau allait jusqu’à recommander l’application du principe de la responsabilité collective, sous forme de vengeances contre les civils (12).
Le processus de libération
Il n’était plus question de contacts secrets (via des émissaires épris de paix comme Barrat, Stibbe, Verny, Schneider, Farès, Mandouze, etc) que Mendès France était autorisé à avoir avec le FLN avant sa démission en mai 1956. « Vous imaginez les réactions des chefs de l’armée s’ils apprennent cela », expliquait Guy Mollet à P. Mendès France, fin mars 1956. Les pouvoirs spéciaux consacraient ainsi le passage de la politique répressive inaugurée par F. Mitterrand en novembre 1954 à la « guerre totale », chère aux colonels Argoud, Gardes, Godard et Trinquier, et qui s’en prenait à tout un peuple. Massu a donné à Trinquier (13) le pouvoir de garder plus d’un mois les détenus dans les locaux militaires, lorsqu’il le jugera bon : « Les OR (officiers de renseignement) des sous secteurs pourront demander au commandant de secteur que certains hébergés soient mis à leur disposition pour complément d’enquête ». On était loin de la citation d’Alain par Mollet : « l’essentiel n’était pas l’indépendance du pays, mais la liberté des individus à l’intérieur du pays ». Robert Lacoste et Guy Mollet n’étaient pas sans savoir tout ce qui se passait à Alger. Au moment de l’affaire Boumendjel, Lacoste expliqua à l’Assemblée nationale que l’avocat disparu avait été assigné à résidence ». À ce sujet, G. Mollet recevait en mars 1957 une lettre explicative. « Cet arrêté n’a pas pu être notifié à l’intéressé le lieu de détention de l’avocat musulman ayant été gardé secret par les paras de Massu… Il est évident que si cet arrêté avait pu être notifié et exécuté, Boumendjel serait encore vivant »(14). Cette lettre était rédigée par Charles Ceccaldi-Raynaud qui occupait la fonction de secrétaire de la fédération de la SFIO d’Alger. Cela le rapprochait de Lacoste et de Mollet, sans doute désireux de ne pas trop dépendre des nombreux services, officiels ou officieux, comme celui monté par Soustelle avec Achiary. Mais en restant attaché aux promesses de paix, faites par le Front républicain en janvier 1956, Ceccaldi-Raynaud n’hésitait pas à exprimer ses désaccords avec la politique suivie après le revirement de Mollet. Il a tenu à mettre ses camarades de la SFIO devant leurs responsabilités. Sa nomination à la tête du centre de transit de Béni-Messous, en février 1957, l’a mis aux premières loges et lui a permis d’informer le gouvernement en connaissance de cause. Dans une lettre d’avril 1957, il a tenu à mettre au courant G. Mollet de la généralisation des pratiques illégales, mais tolérées par les « pouvoirs spéciaux », dont l’article premier stipulait la « suspension des libertés » en Algérie. Après avoir désapprouvé la « pacification » menée par Lacoste, il a déploré « l’indulgence intolérable dont bénéficient les ultras européens, même quand ils sont inculpés de crimes, et la liberté laissée aux paras d’agir à leur guise qui ont provoqué une dangereuse abdication du pouvoir civil. »(15). Ceccaldi-Raynaud se faisait plus précis : « Mais à partir du moment où la torture n’est plus le cas isolé d’un irresponsable, à partir du moment où les supplices ne sont sanctionnés que lorsqu’ils sont connus du public et sont susceptibles de faire scandale, à partir du moment où les perquisitions et les arrestations sont faites sans discrimination par quartiers entiers et maison par maison, à partir du moment où la charge d’assurer la sécurité urbaine ne repose plus ni sur la police classique ni sur l’armée du contingent, mais sur des régiments de para étrangers, il est évident que la pacification est abandonnée au profit d’une guerre de régression aveugle et répressive. »(16). « Tous ceux qui ont eu le malheur d’être appréhendés par les soldats du REP (Régiment Etranger Parachutiste), ont connu la douleur et la honte de la torture. Le 1er REP composé le plus souvent d’ex-SS allemands, est installé à Alger à la Villa Sésini, dans les locaux de l’ancien consulat d’Allemagne, ce qui constitue tout un symbole et tout un programme. De nombreuses personnes libérées de cette villa après plusieurs jours de détention, sont venues spontanément à la Fédération socialiste raconter leurs souffrances et montrer les traces des sévices subis. »(17).
La dérive autorisée par les pouvoirs spéciaux a été ainsi dénoncée par Ceccaldi-Raynaud, comme il avait refusé les mensonges officiels servis au moment de l’affaire Zeddour. Kassem Zeddour était né en 1923 près d’Oran dans une famille de notables. Après des études à l’école fondée en 1910 à Oran par son père, le cheikh Tayeb Mehadji, il s’est rendu en 1949 au Caire où il a obtenu une licence de littérature arabe. Il trouvait le temps d’apprendre plusieurs autres langues dont le persan et l’allemand, en plus de l’anglais qu’il avait étudié au centre culturel britannique d’Oran. Il a été l’adjoint de Mohamed Khider au Bureau du Maghreb Arabe du Caire. Il faisait partie aussi de l’entourage de l’émir Abdelkrim al Khattabi, le héros de la guerre du Rif (1921-1926). Le Bureau du Maghreb avait été durement éprouvé par la catastrophe aérienne de fin décembre 1949 qui coûta la vie aux brillants membres de sa délégation (le Marocain Mehdi Benaboud, l’Algérien Ali Hamami et le Tunisien Habib Thameur) au congrès sur l’économie du monde musulman de Karachi. K. Zeddour pouvait être comparé à Ali Hamami pour sa connaissance de nombreuses langues et sa façon de concilier des études poussées avec un engagement militant. De vieilles photos le montrent aux côtés de Mohamed Boukharouba (le futur Haouari Boumédiène) et de Mouloud Kassem (qui sera ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses à partir de 1970). En 1954, Zeddour, après avoir effectué plusieurs missions secrètes en Europe, notamment auprès de Messali-Hadj à Niort, est rentré à Oran, sans doute à la demande de Ben Bella qui le voulait aux côtés des hommes du CRUA le 1er novembre. Le 3 novembre, il a été arrêté par les hommes de l’inspecteur de la DST Loffredo. Après son transfert à Alger, la DST a essayé de faire croire à son évasion. Grâce à Charles Ceccaldi-Raynaud, la famille saura qu’en fait son enfant est mort après avoir été torturé par le commissaire Longchamp.
Un article paru dans l’Express du 10 octobre 1955 révélait que ce divisionnaire de la DST avait noyé, en haute mer et en pleine nuit, le corps du militant qu’il avait torturé à mort, après l’avoir lesté de 70 kgs de plomb (18). L’article soulignait qu’après le rejet du corps par la mer, les hiérarchies policière et judiciaire eurent recours à la complaisance du médecin légiste et à la complicité des services de l’identité judiciaire pour étouffer l’affaire. Cet article a été inspiré par le courageux journaliste de l’Express par Charles Ceccaldi-Raynaud qui aida aussi la famille Zeddour à porter plainte et à rechercher la vérité. Mais le tribunal a prononcé un non-lieu. Alerté par Charles Hernu (alors député mendésiste) en février 1956, le Garde des Sceaux a rappelé le non-lieu et promit vaguement l’ouverture d’une enquête. C’était sans doute trop demander à une hiérarchie policière sous l’influence de Borgeaud et à de hauts magistrats sous la tutelle de René Mayer, que Mitterrand devait ménager autant que son prédécesseur à la place Vendôme, R. Schuman (19).
Pour son courage et son humanisme, Ceccaldi-Raynaud mérite le titre de « Juste » de la guerre d’Algérie, comme ceux qui firent preuve de bravoure et de fraternité humaine durant la deuxième guerre mondiale. Sa discrétion et son silence prolongé ont empêché que son nom soit mentionné en même temps que ceux de : Bourdet qui a parlé de « Gestapo d’Algérie » et de « pratiques hitlériennes »; Barrat qui a parlé de la « Question » trois ans avant Alleg ; Stibbe qui a remis à Monteil un rapport sur des « faits précis de détentions arbitraires par la police, de sévices prolongés, d’aveux extorqués sous la torture, de dénis de justice. »(20). Ceccaldi-Raynaud avait vainement essayé d’infléchir la politique menée par ses camarades de parti. Il a cependant obtenu d’eux le déplacement (à défaut de son jugement) du tortionnaire de Zeddour et même le limogeage de son protecteur Pontal, le chef de la DST d’Algérie, supposée – à tort – plus républicaine que la police qui dépendait de la Sûreté générale du gouverneur général. Enfin, après avoir échappé en mai 1958 à l’arrestation ordonnée par Trinquier, Ceccaldi-Raynaud a choisi de « changer de camp pour ne pas avoir à changer d’avis sur l’Algérie ». Ses mises en garde récurrentes furent vite passées sous silence dans son ancien parti, où l’on s’est employé par la suite à diaboliser à outrance G. Mollet, sans doute pour mieux faire oublier les lourdes responsabilités de Mitterrand, pour les besoins de son ambition présidentielle (21). Mais Ceccaldi-Raynaud n’a pas été oublié par la famille Zeddour. Elle le considère comme l’exemple qui a sauvé l’honneur au nom d’une conception élevée de la fraternité humaine. Elle a tenu à le contacter pour le faire participer au documentaire réalisé à la mémoire de Kassem Zeddour (22). Ce contact a pu être établi au moment où Ceccaldi-Raynaud achevait la rédaction du livre que j’accepte volontiers de présenter ici aux lecteurs. Sa lecture m’a conduit à retracer brièvement dans ces pages la dégradation qui a amené plusieurs gouvernements de la IVe République à « abjurer les valeurs françaises et chrétiennes. »(23). Un livre dont la lecture est aussi stimulante mérite d’être mis à la disposition du grand public. La première partie de ce témoignage porte certes la marque des sélections de l’historiographie française concernant l’Algérie ottomane dont les institutions n’étaient pas jacobines. Les synthèses relatives à l’histoire de la conquête et à celle des statuts de l’Algérie d’une part, et l’examen de la montée des courants nationalistes d’autre part, montrent la connaissance par l’auteur de l’ancienneté des problèmes dont l’accumulation et l’aggravation ont conduit tout droit à l’explosion de novembre 1954. Quant aux récits sur la période allant de 1954 à 1958, ils aident à combler de sérieuses lacunes qui persistent parfois dans de bons livres d’histoire. Des publications récentes font commencer par exemple la perversion du système judiciaire après le vote des pouvoirs spéciaux et ne remontent pas plus loin que la création des DOP en septembre 1956 pour la datation de la pratique de la torture. D’autres, qui s’en tiennent aux seules dénonciations publiées dans un journal comme « Le Monde », font même croire que la torture ne daterait que de la « bataille d’Alger »de 1957.
Le rôle de Mendès France
La lecture du livre de Ceccaldi-Raynaud rappelle que toute cette dérive était inscrite dans les faits par l’option répressive du gouvernement Mendès France. Pour avoir côtoyé les grands responsables politiques de cette période, Ceccaldi-Raynaud apporte un éclairage qui permet de mesurer la part des calculs de carrière et les considérations de politique politicienne dans l’aveuglement qui a pris les «fictions juridiques» (selon la formule du général De Gaulle) comme prétexte pour installer le pays dans la guerre pour une durée indéterminée. Les politiques de l’époque ne voulaient pas élargir leur horizon au-delà des grandes échéances électorales – comme les militaires ne voyaient pas « plus loin que le bout de leur djebel », comme le leur reprochait le général De Gaulle. On dit que la première victime des guerres, c’est la vérité. Pour contribuer à la rétablir, des témoignages aussi attachants que celui de Ceccaldi-Raynaud peuvent être aussi utiles que les ouvrages des historiens probes et érudits.
1. Le Mire : Histoire militaire de la guerre d’Algérie. A. Michel. 1996.
2. L. Massignon : Opéra Minora. Dar al Maaref. Beyrouth. 1963.
3. Vincent-Mansour Monteil : le linceul de feu , Vegapress. Paris. 1987
4. L’Algérie, divisée en « trois départements français », était « intégrée » à la France depuis 1834. Mais le gouvernement ne s’est avisé de faire de « l’intégration » que lorsque l’ALN algérienne mettait en échec les unités d’élite de l’armée française. Soustelle promettait également une application effective du statut organique de l’Algérie qui avait été voté en septembre 1947, à la suite des promesses solennelles de rupture définitive avec les errements du passé, faites devant les deux Chambres par le ministre de l’Intérieur Edouard Depreux, un authentique homme de gauche qui était outré par les iniquités coloniales autant que par les inégalités sociales.
5. Quand E. Faure s’est enquis de la « Troisième force », Soustelle a eu la franchise de lui répondre, après la défection des 61, qu’il ne restait plus pour la constitution de ce courant que « les illettrés, les corrompus et les folkloriques ».
6. Les ultras qui voulaient mettre à exécution ce projet évolueront vers l’idée de « république française d’Algérie ». Mitterrand aurait manifesté un intérêt pour ce projet, si l’on en croit les révélations faites par Robert Lacoste dans ses entretiens avec Odile Rudelle. Archives du Centre d’Histoire contemporaine. Institut des Études Politiques de Paris.
7. Vaujour avait été nommé directeur de la Sûreté générale à Alger en 1953. Il sera conseiller technique de Gilbert Jules, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Guy Mollet. Nul doute que s’il n’avait pas étouffé l’affaire Zeddour sa carrière aurait suivi un cours moins favorable. Vaujour reviendra en 1959 en Algérie comme membre du cabinet du Délégué général Paul Delouvrier.
8. Guy Mollet a justifié son virage à 180 degrés en expliquant que les manifestants qui le conspuaient sur la route Moutonnière « ressemblent » à ses « électeurs d’Arras ». À son ministre du travail Albert Gazier, qui l’accompagnait à Alger début février 1956, il déclare que « si la classe ouvrière est contre nous, c’est que nous avons tort ». Il fallait donc, selon lui, changer immédiatement de politique. Cf. l’entretien d’Albert Gazier avec Odile Rudelle. Archives du centre d’Histoire contemporaine de l’IEP de Paris.
9. Un tract diffusé fin 1955 dans la circonscription électorale de Lacoste en Dordogne était intitulé : « Halte à la guerre en Afrique du Nord » ! Lacoste proclamait sa préférence pour « une solution de paix honnête et juste par la voie des négociations » et dénonçait la « solution de force, avec tous les sacrifices de misère et de sang qu’elle implique ». Et le candidat d’appeler les électeurs à chasser « ceux qui persistent à croire qu’il suffit d’un fantoche et d’une armée pour maintenir la présence française dans les pays d’Outre-Mer ».
10. En 1965, osant parler encore des pouvoirs spéciaux, F. Mitterrand félicitera les communistes (pêche aux voix oblige) d’avoir « consenti ce sacrifice pour l’unité de la Gauche ».
11. Le tiers de la population algérienne de l’époque a été ainsi déplacé. Les habitations des zones interdites étaient dynamitées ou rasées au bulldozer. Dans une note manuscrite de février 1958, le lieutenant Schmitt demandait à sa hiérarchie des tonnes de dynamite pour achever la destruction des mechtas des zones interdites de Bouzegza. Schmitt fera une brillante carrière qui l’amènera à être promu général, puis chef d’état-major par… le président Mitterrand, qui avait de la suite dans les idées.
12. Une note du deuxième bureau du futur corps d’armée d’Alger recommandait en mai 1956 cette pratique nazie. Son rédacteur était sans doute sous le choc provoqué par la spectaculaire embuscade de Djerrah, près de Palestro, où la section d’Ali Khodja (et non pas le commando du même nom qui a été créé fin 1956) mit en déroute une unité de rappelés. Les massacres collectifs de civils se multiplient au point de faire réagir des modérés francophones exclusifs et francophiles. La fille du cadi sénateur Chérif Benhabylès écrit une lettre ouverte à Lacoste pour dénoncer les méthodes de « pacification ». Le délégué à l’Assemblée algérienne Imalahyen (père de la romancière Assia Djebbar) dénonce également les massacres de civils par les fils d’un colon d’El Affroun. En septembre 1956, le très modéré Abderrahmane Farès (qui avait présidé l’Assemblée algérienne et à qui Soustelle pensait pouvoir céder son poste de gouverneur général) adresse une lettre ouverte à Lacoste pour dénoncer des opérations de « pacification » qui firent plus de 300 morts parmi les civils des Ouled Antar et Ouled Hamza (entre Médéa et Boghari).
13. Commandant d’un régiment de la 10e DP, Roger Trinquier a créé le DPU (Dispositif de Protection Urbaine), un système de quadrillage des villes et des villages où des « chefs d’îlot » nommés par les militaires sont chargés de renseigner sur le moindre aller et venu. Cette délation baptisée « protection » était empruntée au système mis en place par la Gestapo sous l’Occupation. C’est pour cela qu’un ancien résistant comme Claude Bourdet se permettait de parler de « méthodes hitlériennes ».
14. Patrick Kessel : Guerre d’Algérie. Écrits censurés, saisis, refusés. 1956-1960-1961. L’Harmattan. 2002. p. 38. Dans ce libre, Kessel a tenu à publier plus de 40 ans après la guerre d’Algérie ses articles de 1956-1958 que son journal l’Express ne trouvait pas “politiquement corrects”.
15. Les Disparus (Le cahier vert), par Mes Vergès, Zavrian et Courrégé. Edition La Cité. Lausanne. 1959
16. Ibid.
17. Ibid. Le colonel Dufour, successeur de Jeanpierre, mort au combat (en avril 1958 à Souk Ahras), s’opposa à ce qu’une plaque faite avec le granit de Mauthausen soit apposée pour commémorer la mort de son prédécesseur, un ex-déporté. Il ne fallait pas blesser la sensibilité de certains hommes du REP. Il est arrivé à une historienne de la torture, qui a décidé de négliger l’avis et les témoignages des torturés, de citer des extraits des lettres et rapports de dénonciation de la « pacification » adressés à G. Mollet par certains de ses « camarades ». Il s’agit essentiellement des protestations de Ceccaldi-Raynaud contre la torture, qui sont conservées dans des fonds d’archives. On se demande pourquoi cette historienne s’est employée à taire soigneusement son nom. Est-ce pour des raisons plus politico-idéologiques que “scientifiques” ?
18. Cet article de l’Express a permis de faire connaître l’affaire Zeddour à l’échelle internationale. Il a été suivi par la publication de nombreux autres articles dans les pays arabes, comme celui de Othmane Saadi dans une grande revue de Baghdad. Cela a contribué à l’information des élites arabes, qui comptaient bon nombre de francophiles, sur l’ampleur de la répression et la nature de la guerre menée par la France en Algérie. C’est grâce à ce genre d’articles que le colloque organisé au Caire en 1958 sur la situation en Algérie a pu réunir des intellectuels arabes (dont Taha Husséin) qui hésitaient à condamner la politique algérienne de la France. Les actes de ce colloque ont été réédités à Alger sous le titre « Ma’a al Djazaïr » (Avec l’Algérie) par les éditions Alam al Afkar. Par ailleurs, dans sa thèse sur « les étudiants algériens de l’université française », Guy Pervillé attribue le succès de la grève ordonnée en 1956 par l’UGEMA à l’émoi provoqué par la médiatisation de l’affaire Zeddour.
19. Interrogé sur ces affaires au moment de la campagne présidentielle de décembre 1965, Mitterrand ne regrettait rien : « si j’avais dit autre chose, cela aurait provoqué la chute du gouvernement… pour faire cesser les tortures, j’ai réalisé l’intégration de la police algérienne dans la police métropolitaine… ». On mesure la faiblesse de ces arguments quand on sait que la torture a été pratiquée dès le 3 novembre 1954 par la DST qui dépendait directement de Paris, Vaujour n’ayant jamais cherché à la rattacher à la direction de la Sûreté du Gouvernement Général. Quant à la chute du gouvernement Mendès France, elle aura lieu moins de trois mois après les fortes paroles de Mitterrand devant les députés. Les choix faits à ce moment-là précipiteront la chute, non pas d’un gouvernement, mais de la IVe République elle-même. Mitterrand aura attendu d’avoir quitté le pouvoir pour reconnaître la gravité de ses erreurs sur l’Algérie, en recevant Jean Lacouture près d’un mois avant sa mort !
20. V. M. Monteil : le linceul de feu, Vegapress, Paris, 1987
21. Voir le livre consacré à Guy Mollet par Lafon, Fayard, 2006. Dans « Pourquoi Mitterrand ? », P. Joxe va jusqu’à accabler Mendès France lui-même pour essayer d’atténuer les responsabilités du ministre de l’Intérieur qui avait opté pour le tout-répressif en novembre 1954.
22. Ce documentaire comble une bonne partie des lacunes de l’historiographie en ce qui concerne les activités des étudiants algériens dans les pays arabes avant 1954.
23. Malek Bennabi : SOS-Algérie, Le Caire, 1957. Repris dans M. Bennabi : Témoignages sur la guerre de libération, Préface de Sadek Sellam, Editions Alam al Afkar. Alger. 2010.