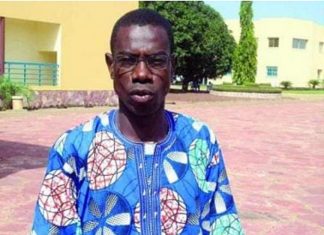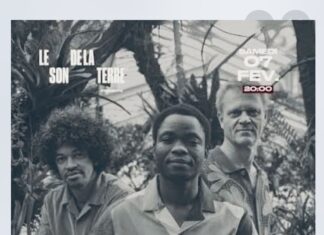Un rapport gouvernemental, intitulé « Frères musulmans et islamisme politique en France », présenté lors d’un Conseil de défense, mercredi 21 mai, pointe des menaces graves de la part d’une nébuleuse liée à la confrérie secrète des Frères musulmans, fondée en Égypte en 1928. Le chercheur Franck Frégosi, spécialiste de l’islam français, dénonce chez nos confrères de l’excellent site « The Conversation » une communication politique et une interprétation erronée de ce que représente le « frérisme » dans la France d’aujourd’hui. Entretien.
politiste, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
The Conversation : Dans quel contexte se situe ce rapport ? Qui le produit et dans quel but ?
Franck Frégosi : On parle du rapport Retailleau – ce dernier, dont les ambitions présidentielles sont connues, l’utilise habilement pour sa communication politique, notamment en faisant « fuiter » des extraits dans le Figaro dès dimanche 8 mai – mais, en fait, il s’agit d’un rapport commandé par son prédécesseur Gérald Darmanin, il y a plus d’un an. La cible du rapport, c’est la question de l’influence des Frères musulmans et, plus largement, de l’islamisme politique en Europe. Les rapporteurs et une commission ont procédé à des auditions et des déplacements, en France et à l’étranger. Ils ont sollicité le point de vue – dont le mien – d’universitaires ou d’experts sur les questions d’islam, il y a aussi toute une partie qui concerne les services de sécurité et qui n’a pas été rendu public.
Rappelons qu’au départ, ce rapport était annoncé comme classifié, mais le ministre Retailleau a souhaité le déclassifier. La version que j’ai pu consulter m’interroge. Est-ce le rapport tel qu’il a été écrit par les rapporteurs ? Cette version a-t-elle été retouchée sous l’influence du politique ? Il n’est pas du tout illégitime que l’État s’empare de ce sujet, mais il est important que l’on comprenne un peu plus précisément les conditions de sa production.
Le rapport parle de « risques », de « dangers » et de « menaces » liés à la mouvance « frériste », mais il donne aussi des chiffres : 400 personnes constitueraient le noyau dur de cette confrérie. Le rapport évoquer 139 lieux de culte affiliés à l’association Musulmans de France, héritière de l’Union des organisations islamiques en France (UOIF), elle-même héritière de la confrérie des Frères musulmans. Le document estime que 10 % des lieux de culte ouverts dans la période 2010-2020 y seraient affiliés, ce qui correspond à un ensemble de 91 000 fidèles (sachant qu’un fidèle peut fréquenter une mosquée sans adhérer à la « mouvance », comme le précise le rapport) qui représentent 0,01 % des 7,5 millions de musulmans de France. Ces chiffres signalent-ils un danger ?
F. F. : Considérant ces chiffres, j’avoue ne pas comprendre la nature de cette menace. Il est important de rappeler que ce n’est pas parce que des individus fréquentent un lieu de culte qu’ils adhèrent nécessairement à la philosophie de celui qui l’a créé. La proximité géographique de la mosquée explique beaucoup la logique de fréquentation. Doit-on considérer que 400 personnes, qui constitueraient le centre de la confrérie, pourraient subvertir les institutions républicaines voire islamiser la société ? Ce n’est pas crédible. Notons que, les Frères musulmans sont en perte de vitesse dans les pays musulmans et que l’association Musulmans de France, supposée être l’héritière de la « mouvance frériste » est plutôt en perte de vitesse dans notre pays – si l’on considère le nombre d’associations qui sont affiliées.hFaire un don
D’un point de vue idéologique, la mouvance frériste porte-t-elle un islam « intégral » menaçant la République comme le souligne le rapport ?
F. F. : Il faut dissocier les Frères musulmans des origines de ce qu’ils sont devenus en France aujourd’hui. Lors de la création de la confrérie en 1928, Hassan Al-Banna, le fondateur, veut clairement « réislamiser » la société égyptienne de façon gradualiste. Au cœur du projet, il y avait la référence centrale à la charia, mais dans un contexte majoritairement musulman et aussi par réaction à la présence coloniale britannique aux côtés du roi Farouk. Depuis, la confrérie a essaimé dans l’ensemble du monde musulman et a donné naissance dans plusieurs sociétés à différentes formations politiques.
Au cours des années, ces formations ont dû tenir compte de l’histoire propre de chaque société et des systèmes politiques locaux. En Europe, des militants, principalement issus de la branche égyptienne de la confrérie ont essayé de repenser ce projet « intégraliste », répondant à tous les aspects de la vie quotidienne en tenant compte du contexte d’un islam minoritaire au sein de sociétés sécularisées de surcroît. Mais, progressivement, ils ont pris conscience que la centralité de la charia ou d’un État islamique n’était guère envisageable dans l’espace européen et ont adapté leur discours.
Ainsi, Saïd Ramadan a-t-il proposé de réinterpréter la notion de charia comme « justice sociale ». La tonalité politique des origines s’est diluée, a progressivement disparu de leur agenda européen. Aujourd’hui, en France, l’objectif est surtout cultuel : il s’agit de ramener les musulmans présents en Europe à une observance de plus en plus conservatrice de la religion et de ses principes. Proposer un encadrement pour les prières, développer des bribes d’enseignement ou d’éducation islamique, construire des écoles sous contrat, surtout après l’interdiction du voile dans l’école et dans les lycées publics.
Les héritiers de cette mouvance sont devenus des notables communautaires plus soucieux de conservatisme moral et social en rupture de ban avec les éléments les plus activistes de la société, notamment certains jeunes musulmans nés en Europe, plus mobilisés et résolument critiques envers les gouvernements en place.
Le rapport souligne que les Frères musulmans sont une confrérie secrète. La démarche de respectabilité ou d’institutionnalisation est soupçonnée d’être une stratégie de dissimulation. Le but final serait toujours d’instaurer un califat.
F. F. : Les rapporteurs évoquent un projet secret, mais finalement ils n’avancent aucun élément sérieux pour le démontrer. Ils ne font que leur prêter des intentions sans être en mesure de les raccorder à des faits ou à des comportements délictueux. La confrérie secrète des origines est-elle toujours opérationnelle ? En France, l’appartenance à la « mouvance » n’est plus subordonnée à une prestation de serment au guide. Il y a à la fois, d’un côté, le mythe de la confrérie et de son cercle restreint qui tirait les ficelles de l’histoire et, de l’autre, la réalité de terrain. Ce que j’ai pu observer, depuis des décennies, ce sont des acteurs communautaires qui communiquent beaucoup, y compris sur leurs propres désaccords – cela ne ressemble pas aux pratiques d’une confrérie secrète. L’idée d’un double agenda ne tient pas véritablement la route à mon sens.
Certains spécialistes cités par le rapport considèrent que « d’ici une dizaine d’années, certaines municipalités seront à la main d’islamistes, à l’image de la Belgique où au moins cinq communes de l’agglomération bruxelloise, comme Saint-Josse ou Molenbeek, composée d’une écrasante majorité d’habitants d’origine étrangère, présentent les caractéristiques de territoires confisqués où le contrôle social des islamistes sur la population apparaît presque complet ». Qu’en pensez-vous ?
F. F. : Le rapport passe d’une étude sur la mouvance « frériste » à des considérations sur l’« islamisme » en général, et à l’islamisme municipal plus particulièrement ! Plus largement, il y a un glissement entre, d’une part, la légitime prévention contre tout courant qui légitimerait le recours à la violence et, de l’autre, le fait qu’il y a, dans nos sociétés, des personnes de confession ou de culture musulmane engagées en politique qui auraient l’ambition de faire élire un maire susceptible de leur venir en aide dans des projets collectifs (équipements cultuels, soutien financier d’associations…). C’est une autre manière de suggérer l’existence de logiques clientélistes qui pourraient trouver à s’exprimer lors des prochaines municipales.
Concernant la France, des études en sciences sociales montrent que, dans certains quartiers populaires, des groupes musulmans actifs – qui n’étaient pas spécialement Frères musulmans et qui étaient plutôt, jusque-là, politiquement abstinents – ont approché des élus, lors d’échéances électorales, afin d’être leurs interlocuteurs dans le quartier, principalement en vue d’objectifs matériels de proximité, comme le fait d’acquérir ou de louer un bâtiment communal pour un usage associatif ou tout simplement pour dénoncer l’insalubrité chronique dans certains quartiers périphériques. On est loin de tout projet de subversion de la République et d’instauration d’une zone où la charia serait l’unique norme en vigueur. Ces électeurs de confession musulmane tentent tout simplement de se faire entendre des élus et de défendre leurs intérêts de citoyens engagés dans le vie des territoires. D’autres ont essayé de créer des « listes communautaires », dans lesquelles la référence à l’islam était très ambiguë, mais elles n’ont pas rencontré le succès escompté, l’abstention étant très forte dans ces quartiers.
J’ajoute que le rapport entretient également une certaine confusion entre la visibilité urbaine du fait musulman (liée au voile ou à d’autres signes d’appartenance religieux, écoles musulmanes, commerces de produits halals…) qui s’est clairement développée et d’autres phénomènes, tels que la radicalité violente, dont peuvent se faire échos certaines mouvances ou certains sites.
Concernant le sport ou l’éducation, le rapport décrit un réseau étendu lié à la mouvance frériste. Il donne des chiffres : en 2020, 127 associations sportives sont identifiées comme « ayant une relation avec une mouvance séparatiste », rassemblant plus de 65 000 adhérents, parmi lesquelles 29 structures apparaissaient fondées ou noyautées par des tenants de l’islam radical, majoritairement salafiste (18) et fréristes (5) rassemblant plus de 11 000 adhérents. Le rapport admet pourtant que ce « chiffre peut paraître modeste » au regard des 156 000 structures sportives et 16,5 millions de licenciés…
F. F. : Ces chiffres concernent une infime minorité d’associations. Or, le rapport raisonne comme si le phénomène se généralisait à l’ensemble des clubs sportifs. Par ailleurs, ces différentes structures associatives sont présentées comme liées dans un projet commun, global et cohérent. Je serais extrêmement prudent. Qu’il y ait des associations sportives dans lesquelles on met en avant le respect d’un certain nombre de normes, on va dire éthiques ou vestimentaires, c’est un fait. Mais dans la galaxie de satellites qui peut être associée au frérisme, les associations ne sont pas forcément liées entre elles par une espèce de pacte commun visant à renverser la République et à instaurer le califat. Ce « complot » n’est à aucun moment démontré de façon crédible et n’est pas attesté par les enquêtes de terrain.
Je rappelle, par ailleurs, que ces associations doivent respecter un cadre légal, a fortiori pour les écoles qui visent une contractualisation. On soumet donc ces organisations musulmanes à un régime du soupçon systématique, il vaudrait mieux les juger sur ce qu’elles font concrètement.
Pourquoi cibler la mouvance frériste alors que d’autres courants de l’islam politique sont ignorés dans le rapport ?
F. F. : Le rapport constate que la dynamique des Frères musulmans est affaiblie dans le monde musulman, mais il affirme qu’elle serait majeure en Europe. Or, en France, on observe plutôt un essoufflement de celle-ci qui est largement concurrencée par d’autres dynamiques, notamment le salafisme et certaines formes de littéralisme que le rapport se garde d’étudier. Ayons à l’esprit que l’État saoudien, qui a tout de même permis le développement du salafisme (après avoir accueilli, dans les années 1950, lesdits Frères musulmans) sont aujourd’hui à la pointe du combat anti-Frères, de même que les Émiratis. Il y a sans doute une dimension géopolitique en jeu dans le fait de cibler exclusivement les Frères musulmans et, accessoirement, la Turquie d’Erdogan, comme si d’autres sensibilités n’étaient pas plus problématiques aujourd’hui. Le jihadisme n’est pas non plus évoqué, alors qu’il devrait être une priorité pour les pouvoirs publics !
Il y a beaucoup de choses à reprocher aux Frères musulmans. En Égypte historiquement et en Palestine, ils ont pu avoir recours à l’action violente. Mais de là à considérer que ce qui se passe aujourd’hui en France serait la préfiguration que ce qui s’est passé dans le Moyen-Orient… Il faut savoir raison garder et hiérarchiser les problèmes.
Quelles seront les conséquences de ce rapport ?
F. F. : Il a déjà des effets politiques, avec de nombreux commentaires de tous bords et une agitation médiatique immédiate. Le chef de l’État, débordé par le ministre de l’intérieur, tente de reprendre la main en demandant au gouvernement de faire des propositions d’ici au mois de juin. Il y a clairement un plan de Bruno Retailleau qui se positionne pour la présidentielle de 2027. Certains ténors réclament des interdictions d’associations.
Je rappelle l’importance de rester dans le cadre du droit et de la loi, et de ne pas glisser vers une logique d’arbitraire ou d’exception. J’observe qu’une des conclusions du rapport pointe que les outils du droit commun ne semblent pas adaptés à la « menace frériste ». Que faut-il entendre ? Doit-on à nouveau s’attendre à une nouvelle loi qui, après la lutte contre le séparatisme, ciblerait cette fois « l’entrisme frériste » ? Ne sommes-nous pas en droit de nous demander si la lutte contre le frérisme n’est pas un prétexte de plus pour suggérer que les musulmans pieux de ce pays devraient se voir imposer un régime de discrétion dans l’espace public ?
Propos recueillis par David Bornstein.
Nous comptons sur vous.
La démocratie fait face à des menaces croissantes : perte de confiance, montée du populisme et explosion de la désinformation. Votre soutien peut changer cela. En faisant un don pour soutenir un journalisme basé sur des faits et l’expertise, vous encouragez un débat public éclairé et constructif, plus que jamais nécessaire.