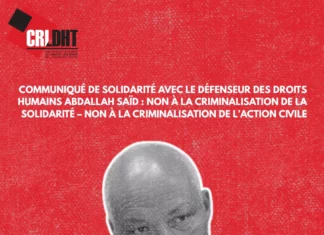Pour rendre hommage au grand islamologue Ali Merad, le Centre Culturel Algérien (CCA) de Paris, en collaboration avec l’Institut « ETIC » de Villeurbanne (69), organise une journée d’étude le jeudi 6 décembre 2018 (1).
Le professeur Ali Mérad, décédé le 23 mai 2017 à Lyon, a laissé une oeuvre considérable. Celle-ci résulte de l’étude phénoménologique du mouvement réformateur algérien dans ses connexions avec ceux de l’Orient. Mérad a ensuite élargi ses horizons pour étudier l’évolution de tout l’Islam contemporain.
De telles études nécessitaient la connaissance des principaux courants de la pensée musulmane classique, auxquels il a consacré des travaux novateurs, notamment sur l’exégèse coranique et la science du hadith. Il s’est avisé aussi d’inclure dans son enseignement, dès le début des années 70 et alors que l’Islam est devenu la deuxième religion de France, l’examen de la situation des musulmans en Europe.
Cela l’a conduit à siéger dans la première commission chargée de l’Islam en France par le gouvernement au milieu des années 70.
L’actualité d’Ali Merad
Dans un premier temps, la journée sera consacrée à l’étude de son itinéraire, marqué notamment par un parfait bilinguisme et une participation active aux débats religieux, culturels et politiques dans lesquels se sont trouvés impliqués les étudiants musulmans de l’université d’Alger dès le début des années 50.
Dans un deuxième temps, des lecteurs de son œuvre souligneront son originalité et, dans une large mesure, son actualité.
Participeront à cet hommage: Nadjib Achour, Azzedine Aïnouche, Khattar Abou Dhiab, Omar Carlier, Charlotte Courreye, Ahmed Djebbar, Azzedine Gaci, Youssef Girard, Mohammed Harbi, Michel Lelong, Kénizé Mourad, Guy Pervillé, Sadek Sellam, Ahmed Taleb-Ibrahimi,…
La journée a lieu de 10 heures à 18heures au CCA, 171, rue de la Croix-Nivert 75025 Paris.
LE PORTRAIT D’ALI MERAD, LE PLUS GRAND DES SPECIALISTES DE L’ISLAM EN FRANCE
Malgré son retrait volontaire et son refus délibéré de participer aux débats agités sur l’Islam, ALli Merad est reconnu pour la pertinence de ses propositions par tous ceux déplorent, depuis janvier 2015, la carence éducative de l’Islam en France. Un portrait signé Sadek Sellam
Né en 1930 à Laghouat, dans le sud algérien, dans une famille traditionnelle, Ali Mérad a fréquenté simultanément l’école coranique et l’école communale de sa ville natale. Il connaissait le Coran par cœur quand il a quitté Laghouat pour le lycée Bugeaud d’Alger dont il a été un très brillant élève. Son professeur d’arabe s’appelle Hamza Boubakeur qui a obtenu l’agrégation d’arabe après avoir tenté, vainement, de se faire « élire » à l’Assemblée algérienne en avril 1948.
Il avait comme jeune condisciple Ahmed Taleb-Ibrahimi, ce qui lui valut de nombreuses rencontres avec le président de l’association des Oulama musulmans d’Algérie, le cheikh Bachir Ibrahimi qui le recevait chez lui.
En 1952, Taleb et Mérad fondent le « Jeune Musulman », périodique destiné à diffuser les thèmes du mouvement réformateur parmi les jeunes algériens francophones.
Ali Mérad y tient deux chroniques, signées de deux pseudonymes. La première, signée « Abou Djamil Taha », expose les croyances et l’éthique qui forment l’idéal islamique. Le jeune chroniqueur fait preuve d’une familiarité avec le Coran et le hadith, commentés de façon vivante et dans une belle langue. La deuxième, signée « Mohamed Arab », décrit les préoccupantes réalités musulmanes et explique les possibilités de leur transformation en s’inspirant de l’idéal islamique. L’auteur, qui était encore étudiant, témoigne d’une bonne connaissance de l’actualité du monde musulman, qu’il complète en 1953 par un séjour au Caire où il s’est rendu en autobus. « Mohamed Arab » fait œuvre de grand reporter. La série d’articles sur l’Egypte montre une fascination de la jeunesse algérienne attachée à un biculturalisme pour ce pays qui jouait un rôle de leader de l’arabité, en modernisant la langue arabe, et se propose, après la révolution des Officiers Libres, de prendre la tête du monde arabe, au nom de l’arabisme. « Mohamed Arab » s’intéresse aussi au roman algérien francophone considéré comme principal source d’informations utiles pour une histoire sociale allant au-delà de l’horizon politique. C’est à ce titre qu’il commente très favorablement les deux premiers livres de Mohamed Dib, « la grande maison » et « l’incendie », parus aux Seuil.
Mérad trouvait aussi le temps de se consacrer au dialogue islamo-chrétien où il avait comme interlocuteurs les pères blancs arabisants Maurice Borrmanns et Michel Lelong qui sont restés ses amis.
Après l’installation de l’Algérie dans la guerre, Mérad se rend à Paris où il est reçu premier à l’agrégation d’arabe en 1956, en même temps que Mohamed Arkoun (reçu 11°), Djamaleddine Bencheikh, Nada Tomiche, Tapiéro,…Il est nommé au lycée franco-musulman de Ben Aknoun, puis assistant à l’institut d’études supérieures islamiques de l’université d’Alger. Il participe aux Conférences Internationales de Genève où il fait la connaissance de Nedjmeddine Bammate (1922-1985). Cet ancien ambassadeur de l’Afghanistan à l’ONU devenu sous-directeur à l’UNESCO était un brillant conférencier qui fascinait par sa maîtrise des langues de l’Islam et celles de l’islamologie. Il est né à Paris où son père Haïdar, ancien président de la République du Caucase du Nord, s’était réfugié après la fin de sa résistance à l’Armée rouge. Mérad connaissait déjà le livre de Haïdar Bammate, « Visages de l’Islam »(Payot, 1946), qui avait enthousiasmé les jeunes algériens francophones et savait que Nedjmeddine était le rédacteur du chapitre sur l’Art musulman. N. Bammate attirait vers lui les intellectuels musulmans voulant assumer leur sensibilité religieuse et désireux de résister à la vogue marxiste.
Durant cette période troublée par la montée des mouvements activistes qui formeront l’OAS, le jeune assistant ne perd pas de vue les droits de la recherche. On lui doit des articles remarqués publiés dans des revues spécialisées : le séjour du cheikh Mohamed Abdou à Alger en 1903 ; le genre Rihla chez les auteurs maghrébins, sans doute inspiré par sa propre rihla (périple) de 1953 en Egypte ; la presse musulmane en Algérie ; un compte-rendu aux critiques parfois sévères du livre du général Pierre Rondot « l’Islam et les musulmans d’aujourd’hui » (Revue Africaine 1960, n° 104). Le chercheur enthousiaste voulait dialoguer d’égal à égal avec les orientalistes, dont il reconnaît les mérites et souligne les limites. « Si l’objectivité pure et simple (si difficile à atteindre !) peut prendre, à l’égard des Musulmans, « un aspect blessant », le manque d’objectivité peut avoir le même inconvénient ». Il reproche au général de se contenter d’une documentation de seconde main. « Nous nous garderons bien, par conséquent de nous appesantir sur cette partie de l’ouvrage, qui n’est guère destinée à remplacer les études de spécialistes en la matière. »
Au moment des contacts secrets entre émissaires de De Gaulle et diplomates du GPRA, suivis des pré-négociations qui aboutiront aux pourparlers d’Evian (mai 1961), Mérad est pressenti pour participer au projet de séparation du Sahara du reste de l’Algérie. Ce projet tenait à cœur à Michel Debré qui comptait sur des notables, comme Hamza Boubakeur ou le colonel Ahmed Mérad un cousin éloigné d’Ali devenu sénateur. Le jeune enseignant-chercheur décline l’offre qui contrariait ses sympathies pour ses amis indépendantistes, de la mouvance des Oulama ou passés dans les ministères du GPRA via l’UGEMA (Union Générale des Etudiants Algériens).
Cela n’empêche pas le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale de l’Algérie indépendante d’affecter le maître-assistant au…collège de…Bou-Saada ! Cette surenchère nationaliste de cet ancien de la Fédération de France du FLN, qui reprochait à Mérad de n’avoir pas respecté la grève ordonnée en 1956 par l’UGEMA servait surtout à régler des comptes personnels.
« J’ai mis mes livres dans le coffre de ma 4 CV pour gagner la France, par le Maroc et l’Espagne », m’a dit Mérad lors d’une conversation dans la salle des catalogues des sous-sols de l’ancienne Bibliothèque nationale. Il s’inscrit avec Charles Pellat pour une thèse sur « le réformisme musulman en Algérie ».
Ce travail répondait à une attente des historiens du nationalisme algérien qui sentaient que l’action de l’association des Oulama mérite une étude à part. L’un d’eux, C. R. Ageron, estimait que « l’un des phénomènes majeurs de l’entre-deux-guerres fut le développement de l’Islah. Ce mouvement de réforme religieuse d’inspiration orientale… visait à obtenir par cette rénovation la libération des peuples musulmans asservis… Son influence dans la genèse et dans l’extension du nationalisme algérien paraît avoir été essentielle…. ».
Ageron, qui travaillait sur les archives du Gouvernement Général depuis 1947 salua la thèse soutenue par Mérad, avec un arabisant philologue désireux de s’ouvrir à l’histoire…
Ce travail a été publié sous le titre : « réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940. Essai d’histoire religieuse et sociale »(Mouton, 1967).
La deuxième thèse sera publiée en 1971 chez Geuthner sous le titre :« Ibn Badis, commentateur du Coran ».
Mérad était le mieux placé pour rédiger l’article « Islah » pour la réédition de l’Encyclopédie de l’Islam, pour laquelle il écrivit aussi l’article « Laghouat ».
La qualité de son enseignement à l’université Lyon II et sa sensibilité religieuse assumée l’ont amené à siéger dans la Commission Nationale des Français Musulmans, créée par le gouvernement Raymond Barre en 1977, sous la présidence de jacques Dominati, secrétaire d’Etat aux Rapatriés.
Avec d’autres membres éminents, comme Abdelkader Barakrok, ancien secrétaire d’Etat à l’Algérie, puis à la Santé, en 1957-1958, les anciens préfets Moqdad et Ourabah et l’islamologue Madjid Turki, il propose la régularisation de la situation du culte musulman, qui était à l’ordre du jour depuis que l’islam est devenu la deuxième religion de France. Il rédige un rapport constatant avec sévérité les carences de la mosquée de Paris et proposant la réforme de la « Société des habous » ainsi que la relance des activités de « l’Institut musulman ». A la fin de son constat, il écrit en mai 1980:
« A la lumière de ce qui précède, et après un large échange de vues entre ses Membres, la Commission Nationale pour les Affaires Musulmanes demande au Gouvernement :
De séparer nettement le destin de l’Institut Musulman de Paris de celui de la Grande Mosquée.
La Commission Nationale souligne que si ces deux institutions demeurent assez proches par leurs attributions, il n’en reste pas moins qu’elles ont chacune sa vocation particulière au regard de la législation française.
De régulariser la situation de l’Institut Musulman en vue d’une rapide et efficace relance de ses activités spécifiquement culturelles. »
Mérad était pressenti pour prendre la tête de l’Institut Musulman, réanimé après sa séparation de la Mosquée. Mais l’option diplomatico-sécuritaire de la gauche au pouvoir accordait très peu de place à l’éducatif. L’Elysée consultera néanmoins Mérad après les manifestations hostiles au financement public de la traduction des « versets sataniques » de Salmane Rushdie, en février 1989.
Il propose l’ouverture d’un établissement d’études supérieures de l’Islam. L’Elysée opte pour une Faculté de théologie musulmane à Strasbourg où le droit concordataire permet le financement public de l’enseignement religieux. Mais le projet bute sur l’opposition du ministère de l’Intérieur. Les chroniqueurs religieux firent croire à des difficultés d’ordre juridique. Mais on sait maintenant que ce sabotage avait pour origine de mauvaises relations, au sujet de l’Islam, entre l’Elysée et la place Beauvau, après le refus de la présidence de soutenir le ministre de l’Intérieur dans sa tentative de refuser la nomination unilatérale par l’Algérie de Tedjini Haddam comme successeur du cheikh El Abbas à la mosquée de Paris. Ce désaccord au sommet de l’Etat a été maintenu secret. Cela permet à des « organisateurs » de l’Islam de France de justifier leur maigre bilan en invoquant « les divisions des musulmans ». Celles -ci sont indéniables, mais moins étonnantes que les sérieuses divergences entre un président et son ministre d’Etat, que l’on tait pour servir à l’opinion un discours pointant du doigt les seuls musulmans.
Mérad continuait à être sollicité sur l’Islam en général et les musulmans en France en particulier. C’est ainsi qu’il s’est rendu à Creil en plein psychodrame médiatiques au sujet des trois collégiennes voilées. Il propose de dédramatiser et de dépassionner :
« Il faut que les musulmans qui vivent en état de minorité sachent qu’ils ont, au regard de Dieu, une égale grandeur que ceux qui ont vécu l’islam dans la plénitude de sa souveraineté »; «je ne suis pas venu en prêcheur, encore moins en détenteur de vérités. Nous sommes réunis aujourd’hui dans le but exclusif de chercher à engager le dialogue afin de se connaître, de se reconnaître et de réagir ensemble à une actualité qui nous interpelle tous…Les problèmes posés peuvent être traités sans passion, ni surenchère. Il suffirait de dialoguer, tout simplement…Au nom même de la parole coranique, nous musulmans sommes ouverts au dialogue. Une injonction du Livre saint nous y invite et nous le recommande. Venons-en donc à une parole égale, qui parte du besoin de donner et de recevoir. »
L’année suivante, il est à nouveau « consulté », par le ministre de l’Intérieur qui s’est avisé de créer, en mars 1990, un « Conseil de Réflexion sur l’Islam en France » (CORIF) quand Mitterrand a déploré l’absence des musulmans à la cérémonie des « vœux pieux », où les autorités religieuses viennent souhaiter la bonne année au président. Mérad met en garde contre « l’intégrisme, une lame de fond qui touchera tôt ou tard la rance qui a la plus nombreuse communauté musulmane d’Europe ». C’était pour plaider à nouveau en faveur de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche sur l’Islam qui doivent accompagner l’application du principe d’égalité à cette religion. Mais le conseiller aux cultes fit venir le médiatique ambassadeur de la Ligue arabe à Paris qui expliqua finement au ministre que « l’intégrisme concerne seulement les pays non arabes (Afghanistan, Iran, Pakistan, Bengladesh,…). Les pays arabes et les immigrés en France sont protégés contre ce phénomène par le nationalisme arabe ! »
Le ministère a préféré les paroles provisoirement rassurantes d’un communicant loquace aux prévisions d’un spécialiste versé les études islamiques depuis trente ans. Aux yeux de l’administration conservatrice par nature, et du conseiller aux cultes préférant nettement les officiels arabes, et les percepteurs de taxe halal aux intellectuels musulmans de France, ce choix avait pour « avantage » de faire durer un immobilisme dont on a découvert les dangers, au plus tard le 7 janvier 2015.
Au milieu des années 90, des « décideurs » algériens songèrent sérieusement à nommer Mérad à la mosquée de Paris. Mais il déclina l’offre, par fidélité à son refus des dirigismes religieux, que ce soit par des civils ou des militaires, par des Français ou des Algériens.
A la même période Mérad juge sévèrement le projet de thèse que voulait soutenir Tarek Ramadan pour éviter d’apporter une caution scientifique à un discours médiatique approximatif sur l’Islam. Pour avoir le titre de « docteur », l’éloquent prédicateur a dû aller en Suisse s’inscrire dans une université privée catholique où l’on est moins exigeant, surtout sur l’Islam.
Toujours disponible, Mérad fut sollicité à nouveau en 1998 quand l’entourage de Chevènement préparait le projet d’Ecole des Hautes sur l’islam que le grand islamologue avait proposé comme troisième option dans son rapport à l’Elysée de 1989, et que relançait Arkoun à chaque occasion (manquée). Le conseiller spécial du ministre l’invite dans un grand restaurant parisien où après avoir commandé les plats, Mérad demande :
« Qui sera associé à ce projet ? »
Le conseiller cite le nom d’un islamo-politiste sur-médiatisé dont chacune des interventions télévisées avait le don d’indisposer au plus haut point Mérad, lequel réagit aussitôt :
-« Vous venez de me couper l’appétit ! »
Le professeur lyonnais se lève, appelle le serveur pour décommander et rentre pour de bon dans sa province.
Le volontarisme de Chevènement butera sur la complaisance de Jospin et d’Allègre qui ont toléré des copinages peu républicains pour laisser détourner cet ambitieux projet qui aurait peut-être empêché les frères Kouachi d’aller étudier l’Islam au Yémen.
Sans cet incident, Chevènement aurait pu vérifier que les musulmans de France ne sont pas tous des illettrés, et éviter les propos blessants tenus quand il a justifié sa nomination à la tête de la nouvelle fondation en laissant croire qu’ « il n’a pas de musulmans compétents »(sic).
Quand on recensera toutes les conséquences des rejets à répétition des projets d’institut sur l’Islam, il faudra bien tenir compte des établissements pompe-à-fric dont l’opacité financière n’a d’égale que la médiocrité des enseignements. Leur prolifération a un lien direct avec le vide maintenu par ces sabotages, alors que la demande de connaissances de l’Islam n’arrêtait pas d’augmenter.
Mérad essaiera de mettre en place une « Conférence musulmane de France » dont il exposera les objectifs dans un article remarqué paru dans le Monde. Il avait pris de nombreux contacts avec les personnalités, sélectionnées avec un discernement qui manquera aux promoteurs de la récente « Fondation de l’Islam ». Il entendait proposer une solution de rechange à « l’organisation » de l’Islam par le haut, qui rappelait de mauvais souvenirs à l’ancien éditorialiste du « Jeune Musulman » dont les chroniques côtoyaient les protestations véhémentes des cheikhs Larbi Tébessi et Toufik al Madani contre les « graves ingérences de l’administration dans les affaires du culte musulman » et les obstructions de la direction des « affaires musulmanes » à l’application de la loi de 1905 à l’Islam.
Il savait que, comme l’Orient jadis, « l’Islam de France » est en train de devenir « une carrière ». C’est sans doute à cause de cela que l’on constate le manque d’empressement à mettre fin aux interventionnismes qui retardent l’application de la loi de séparation à cette religion que les musulmans réclament depuis 1905. D’où la décision de Mérad de rester à l’écart durant ces quinze dernières années, pour éviter d’apporter une caution savante à la nouvelle islamologie administrative encore marquée par le tout-sécuritaire.
Durant la dernière période, il s’est occupé de la réédition de sa pénétrante étude sur « l’Islam contemporain » parue aux PUF, à la collection « que sais-je ». Mérad y rappelle les conséquences des « traumatismes » causées par les guerres du Golfe, le nettoyage ethnique en Bosnie, la dure répression en Tchétchénie et, surtout, la négation des droits du peuple palestinien dont on sait qu’elle est à l’origine de la radicalisation d’une partie des courants islamistes . Il n’admet pas les études des mouvements fondamentalistes qui passent allègrement sous silence ces traumatismes. Comme il déplore les discours médiatiques centrés sur « l’islamisme » (« religion du prophète Mahomet », selon le Littré) pour mieux faire oublier l’ancienneté de l’affaire palestinienne.
Il a publié deux autres « que sais-je » sur « l’exégèse coranique » et « la tradition musulmane » (sur le hadith). Plus récemment, il a publié un ouvrage sur l’histoire du Califat (Desclée de Brower), et les conséquences néfastes de son abolition en 1924.
Nul doute que l’œuvre d’Ali Mérad intéressera ceux qui accordent plus d’importance à la qualité de la réflexion plutôt qu’au taux d’occupation de l’espace médiatique. Bourdieu a déclaré un jour qu’il juge de la valeur d’un chercheur selon sa capacité à décliner les invitations des médias. Cela s’applique merveilleusement à Mérad qui n’aura jamais mis les pieds à l’émission dite islamique de France 2, créée il ya 34 ans, et ouverte pourtant à tous les vents. Cela n’est pas à l’honneur des anciens de Mosaïques qui, après avoir contribué à la folklorisation de l’Islam, n’hésitent pas à révéler leurs liens avec des généraux putschistes algériens de janvier 1992. Le legs intellectuel de Mérad est désormais incontournable si l’on veut promouvoir une éducation musulmane conséquente servant à prévenir les radicalisations et à éviter de charger n’importe qui de « déradicalisation ». Une telle éducation s’articule autour de l’enseignement de l’éthique pour sortir du cadre étroit des ritualismes et de la casuistique. Les écrits d’Abou Djamil Taha constituent une bonne introduction au manuel d’éthique musulmane dont ont besoin les jeunes musulmans de France.
Une éducation musulmane devrait aussi enseigner la longue histoire intellectuelle de l’Islam en France. Là aussi la pensée de ce véritable moudjtahid (partisan de l’Idjtihad, qui dérive de la même racine que djihad) intéressera ceux qui considèrent que le renouvellement de la pensée réformatrice est la meilleure alternative aux idéologies sous-jacentes aux radicalisations, surtout après la découverte des inconvénients de la saturation néo-maraboutique. Elle intéresse tous ceux renoncent à agiter l’épouvantail fondamentaliste pour s’occuper sérieusement de l’intelligence de la foi et de l’encadrement des jeunes.
Quant aux « organisateurs » de l’Islam en France qui auront une réelle volonté d’appliquer la loi de 1905 à cette religion, ils finiront par reconnaître la pertinence des conseils que Mérad a donnés aux politiques qui voulurent bien le solliciter. Il l’a fait inlassablement par civisme « laïque », mais aussi par devoir islamique de Nassiha (bon conseil).