Les commissions d’historiens et de chercheurs sur le passé colonial et postcolonial de la France se succèdent depuis plus d’une décennie, sur un rythme de plus en plus rapide : commission sur la mémoire des expositions ethnographiques et coloniales (2011), sur les « événements » en Martinique en 1959, en Guyane en 1962 et en Guadeloupe en 1967 (2015), sur le Rwanda et le génocide des Tutsi (2019), sur les relations France-Algérie entre 1830 et 1962 (synthèse en janvier 2021) et la guerre d’Algérie (lancement janvier 2023) et enfin sur la guerre au Cameroun (lancement mars 2023).
Les ouvrages savants et les travaux collectifs trouvent leur public et occupent désormais les rayons des libraires ou des festivals (comme la semaine prochaine aux Rendez-vous de l’histoire de Blois) à l’image des ouvrages Histoire globale de la France coloniale (Éditions Philippe Rey), Colonisation, notre histoire (Seuil), Histoire de l’Algérie à la période coloniale, 1830-1962 (La Découverte), L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique (Seuil) ou encore Décolonisations françaises. La chute d’un empire (Éditions de La Martinière).
Les bandes dessinées, les romans (avec leurs prix littéraires prestigieux de Leïla Slimani à Alexis Jenni en passant par Alain Mabanckou, David Diop, Eric Vuillard, Christophe Boltanski et beaucoup d’autres), les documentaires trouvent leur public (de « Décolonisations, du sang et des larmes » (2020) sur France 2 à « Décolonisations » (2020) sur Arte), les fictions cinématographiques telles Tirailleurs (2022) s’emparent du sujet et les podcasts en radio sont des succès indéniables, comme l’excellente série de Pierre Haski sur France Inter depuis deux étés, intitulée « Les décolonisations africaines » en 2022 et 2023.
Partout, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et dans des conférences en ligne le passé colonial et ses héritages sont questionnés et génèrent des dialogues, parfois houleux.
Ces dernières années, des expositions, encore rares, participent de ce processus de dévoilement, à l’image d’« Exhibitions, l’invention du sauvage » (2012) ou « Peintures des lointains » (2018) au Musée du quai Branly, en passant par « Le modèle noir, de Géricault à Matisse » (2018) au Musée d’Orsay ou « Décadrage colonial » (2022) au Centre Pompidou.
Parallèlement, la France a entrepris de commencer à rendre des biens culturels pillés au temps de la colonisation. Dans cette dynamique, une loi va bientôt s’attacher aux « restes humains » provenant des ex-espaces colonisés et conservés dans des institutions publiques (musées, hôpitaux, laboratoires) pour pouvoir rendre ceux-ci aux pays ou régions ultramarines et apaiser les mémoires.
Les manuels scolaires ne sont plus ceux du temps de François Mitterrand – pas le Mitterrand ministre des colonies de 1950-1951, mais celui président de la République de 1981-1988 : si l’étendue des parties des programmes d’histoire consacrées à ces questions continue à faire débat, la place de l’histoire coloniale a été incontestablement renforcée et les enseignants disposent désormais d’outils pédagogiques avancés (les expositions pédagogiques se comptent par dizaines et les plates-formes Lumni.fr et eduscol.education.fr sont bien dotées) pour aborder le passé colonial.
Le passé colonial, objet de débat
Les débats sur le passé colonial dans l’espace public sont cependant particulièrement clivés : les tenants du décolonialisme les plus radicaux s’opposent aux animateurs de l’Observatoire du décolonialisme faisant la chasse à la « repentance », les nostalgiques du « bon temps des colonies » aux indigénistes et aux pourfendeurs de la Françafrique. Si l’on peut regretter une telle polarisation des débats publics – que nous avions identifiée dans l’ouvrage La fracture coloniale (2005) –, contrastant avec les travaux des historiens, on peut en revanche se réjouir de la visibilisation de l’histoire coloniale.
En effet, l’amnésie coloniale, institutionnalisée, a longtemps dominé malgré les efforts et les travaux des historiens : inaugurée sous le général de Gaulle, entretenue sous Georges Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing, vitrifiée par un François Mitterrand mu par son désir d’ériger un musée nostalgique à Marseille (dont Maurice Benassayag était l’inspirateur) et dont héritera Jacques Chirac, avant de transmettre le relai à Nicolas Sarkozy, ce dernier faisant de l’anti-repentance l’une de ses thématiques favorites et jusqu’à François Hollande, s’affirmant comme l’héritier légitime d’un parti socialiste incapable de faire retour sur ses engagements coloniaux historiques et proposant systématiquement un « regard lucide » sur ce passé mais guère plus.
Nous avons pensé à l’instar de beaucoup d’historiens – que l’on soit en phase ou en désaccord avec cette déclaration – que les choses allaient changer en 2017 lors de la campagne présidentielle : Emmanuel Macron, en Algérie, déclare ainsi le 16 février 2017 à propos de la colonisation : « C’est un crime. C’est un crime contre l’humanité, c’est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. »
François Fillon, candidat LR à l’élection présidentielle, n’y voit que la « détestation de notre Histoire, cette repentance permanente » ; Florian Philippot, alors vice-président du Front national, ajoute qu’il n’y a pas « pire insulte contre la France ».
Cette date est pourtant un tournant. Avec de nombreux pays – à l’image des Pays-Bas, de la Belgique, de l’Allemagne et, à un moindre niveau, du Danemark, du Portugal, de la Grande-Bretagne ou de la Suisse –, la France va engager sur plusieurs fronts un changement de posture institutionnelle. Outre les commissions d’historiens, on note la volonté de repenser la place des Français issus de l’immigration (dont une partie non négligeable provient de l’ex-Empire) dans l’espace public, avec la mission « Portraits de France » proposant des noms pouvant être utilisés pour nommer rues et bâtiments publics ; l’ouverture de la question du retour des biens culturels à l’occasion du discours d’Emmanuel Macron à Ouagadougou (novembre 2017) ; les annonces réitérées de la fin de la Françafrique ; la programmation Africa2020 et la Fondation de l’innovation pour la démocratie confiée à Achille Mbembe (2022) ; les engagements en faveur des anciens combattants des colonies… tout paraissait en place pour un « grand tournant » mémoriel.
Machine arrière…
Et puis, la dynamique s’est étiolée. Alors que nous étions nombreux à imaginer que cette politique qui avait tous les atours de la nouveauté allait trouver sa cohérence par une redéfinition des relations avec l’Afrique mais aussi de la francophonie, par une écoute nouvelle de la relation avec les outre-mer, par un travail approfondi sur les programmes scolaires et, surtout, par la mise en place d’un grand projet muséal qui fait défaut en France (et que nos voisins allemands et belges viennent de mettre en place), cet élan s’est brisé et très peu a été entrepris.
À la place d’un musée d’histoire coloniale a été préférée une Cité de la langue française à Villers-Cotterêts installée dans le château de François Ier avec « 1 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires ouvertes au public, un auditorium de 250 places, douze ateliers de résidence pour des artistes… » Ce choix de sanctuariser la francophonie, avec un budget important (plus de 200 millions d’investissements, soit le deuxième plus gros chantier patrimonial de France après Notre-Dame de Paris !), avec une attente ambitieuse de 200 000 visiteurs annuels et l’accueil du prochain sommet de la francophonie, montre que de grands projets sont possibles.
La francophonie est certes politiquement moins inflammable que l’histoire coloniale et, dans le contexte de la déstabilisation de l’influence française en Afrique de l’Ouest, on peut concevoir que la francophonie peut être conçue comme un ciment culturel à même, sinon de préserver cette influence, sans doute de freiner son effacement. Mais ne nous y trompons pas : ce projet range pour la durée du second mandat d’Emmanuel Macron celui d’un musée de l’histoire coloniale aux oubliettes, avec uniquement à Montpellier l’annonce de la création d’un Institut de la France et de l’Algérie qui ne s’attachera (sous une forme encore à définir) qu’à une partie de l’histoire coloniale (ce projet reprend un ancien projet, sur la base de collections aujourd’hui conservées au Mucem, à Marseille).
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Cette configuration rappelle de vielles querelles – elles remontent à 20 ans –, lorsque Jacques Chirac imagina son musée des « arts premiers » (actuel Musée du quai Branly) et pris conscience que le Musée des arts africains et océaniens (MAAO, situé Porte dorée) allait être vidé de ses collections. Le risque existait que certains réclament que ce lieu devienne un musée d’histoire coloniale, d’autant plus qu’il avait été érigé pour l’immense exposition coloniale internationale de 1931.
À l’époque, Jacques Chirac et Jean-Claude Gaudin, comme une grande partie de la droite aux côtés du mouvement « rapatrié », ont une autre idée en tête avec le projet de mémorial de la France d’outre-mer à Marseille pour rendre « hommage » à une certaine vision de l’histoire (on est à deux ans des célèbres articles de loi sur la « colonisation positive » de 2005) et veulent éviter une polémique face à ce lieu désormais « vide ». C’est ainsi que sera imaginée la Cité de l’immigration, qui occupe désormais cet espace (Musée national de l’histoire de l’immigration).
À quoi pourrait servir un musée d’histoire coloniale ?
Vingt ans après, le projet d’un musée d’histoire colonial est au point mort. À se demander à quoi il pourrait bien servir. Peut-être à faire que toutes les trajectoires, tous les récits, toutes les mémoires, tous les acteurs de ce passé et leurs descendants y trouvent place. À concevoir un espace ouvert sur le monde, sur les comparaisons avec les autres Empires, les sociétés colonisées avant et pendant la colonisation, la société française pendant et après la colonisation. À organiser de vastes expositions autour des grandes questions sur la colonisation ouvertes au grand public, aux scolaires et aussi aux touristes qui visitent notre pays et qui viennent aussi de ces « ailleurs ». À regrouper les patrimoines épars et riches qui dorment ou sommeillent dans les archives d’Aix-en-Provence, au musée du Quai Branly, dans les réserves du Mucem, du Musée des Confluences à Lyon ou au sein du musée de l’Armée aux Invalides… et dans moult institutions et collections publiques et privées.
À engager, aussi, une réflexion commune avec la quarantaine de pays ex-colonies ou ex-protectorats sur la manière de tourner ensemble la page coloniale. À dynamiser une réflexion sur la « décolonisation » de nos imaginaires afin d’irriguer des projets d’expositions en France, en Europe, en Afrique et ailleurs. À accompagner le processus de « retour » des biens culturels pillés en les contextualisant. À mettre en exergue les récits de l’histoire des immigrations postcoloniales, comme la Marche pour l’égalité et contre le racisme (1983) qui commémore cette année son 40e anniversaire ou la Marche du 23 mai 1998 qui commémore son 25e anniversaire et aboutira à la loi Taubira (2001).
À repenser, aussi, notre relation avec l’Afrique au moment même où la France est en rupture avec le continent. À sortir des fantasmes et nostalgies qui continuent à irriguer les extrêmes et leur discours de rejet de l’autre, à accepter la complexification d’un « récit national », à éviter que d’autres radicalités s’emparent de ces enjeux, bricolent leurs « mémoires », inventent des récits fictionnels qui les éloignent de leur propre pays. À proposer des conférences, des débats, des colloques, des bourses de recherches, des politiques d’éditions et d’initiatives entre le monde des arts, la recherche académique et les structures associatives.
Read more: Exhiber l’exhibition ? Quand les historiens font débat : retour sur « Sexe, race et colonies »
À faire, comme s’y emploie le Musée national de l’histoire de l’immigration, le Musée du quai Branly, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME), le Mémorial de la Shoah, le MémoialACTe (en Guadeloupe), un travail de transmission des savoirs.
Certes, la Cité de la langue française est sans doute un beau projet, sans doute est-il nécessaire, mais il met en lumière, aussi, ce qui n’a pas été fait et qui était tout autant nécessaire.
Nous serons bientôt dans le peloton de queue des pays européens pour ce type d’institutions sur le passé colonial, alors que vivent dans l’hexagone les plus importantes présences en Europe des diasporas antillaises, maghrébines et subsahariennes, et d’importantes communautés issues de l’océan Indien, du Moyen-Orient, du Pacifique et de l’Asie du Sud-Est.
Cette page d’histoire se révèle aujourd’hui à la lumière de l’effondrement du « pré carré » africain. Les causes en sont nombreuses, et au premier chef les relations toxiques et quasi incestueuses mises en place après les indépendances entre une gouvernance française privatisée par les présidents de la République et leurs conseillers « Afrique » et des gouvernements africains le plus souvent autoritaires. Les nombreuses interventions militaires françaises, la présence de bases militaires, la permanence du franc CFA indexé sur le franc puis l’Euro ont décuplé le sentiment en Afrique, dans les nouvelles générations, que la décolonisation n’était pas achevée et qu’il fallait tourner la page. C’est une caractéristique forte de la crise de confiance qui se manifeste aujourd’hui. Mais pour tourner des pages, du côté français comme du côté africain, il faut aussi des livres et des musées.
Un carrefour de notre relation au passé
Nous sommes à un carrefour de l’histoire de notre relation au passé. Alors que se manifestent des mouvements pour déboulonner les statues issues de l’histoire coloniale et esclavagiste, que des noms de rues ou de bâtiments scolaires sont changés, la réflexion sur la création d’un musée colonial n’est pas une lubie portée par quelques spécialistes en quête d’un temple pour valoriser les connaissances accumulées. C’est aussi un lieu essentiel précisément pour « tourner la page » et faire pièce à ce point aveugle de notre histoire, surtout dans un pays où la notion « d’excuses » est récusée à priori, à la différence de l’Allemagne avec la Namibie, de la Belgique avec ses anciennes colonies et notamment le Congo, des Pays-Bas avec l’Indonésie…
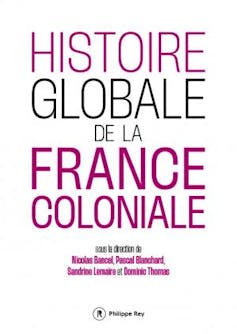
Dans un pays qui se targue d’être le « pays des musées », où l’histoire est au cœur de nos enjeux de citoyenneté, où près d’un tiers des personnes qui y vivent – entre l’hexagone et les régions ultramarines – sont liés de manière intime ou en termes d’héritages intrafamiliaux à l’histoire coloniale et qui souffre d’une relation toxique avec les quartiers populaires et les outre-mer, un musée d’histoire coloniale ne résoudra pas évidemment tous les problèmes, mais peu y contribuer.
Cette histoire remonte à près de cinq siècles, à l’année 1534, lors de la « prise de possession » par le royaume de France du Canada. Faudra-t-il attendre 2034 pour qu’enfin un tel projet devienne une évidence en France ? Ne pourrait-on imaginer une mission de préfiguration pour engager cette réflexion avec toutes les parties prenantes ? Cela ferait sens, cela serait utile, c’est désormais urgent. Sinon, la date du 16 février 2017 restera dans les manuels scolaires du XXIe siècle comme un rendez-vous manqué avec l’histoire.
Nicolas Bancel et Pascal Blanchard ont participé aux Rendez-vous de l’histoire de Blois les 6, 7 et 8 octobre autour de leur ouvrage « Histoire globale de la France coloniale » (Philippe Rey).
































