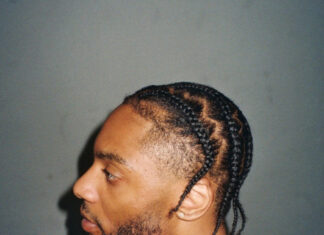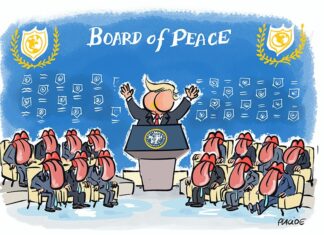Maître Herman Yaméogo à la tête l’Union Nationale pour la Démocratie et le Développement, un parti d’opposition burkinabè a signé, le 21 juillet dernier, une analyse particulièrement intéressante, audacieuse, presque lumineuse, de la situation politique et sécuritaire burkinabè. A la suite de cette publication sur les réseaux sociaux, le septuagénaire a été interpellé par les autorités puis relâché après 36 heures de détention.
Dans ce texte qui a eu l’heur de fortement déplaire à Ia junte burkinabè, il appelle à un sursaut national, insiste sur l’urgence de renouer un dialogue interne apaisé et de restaurer l’Etat de droit et la confiance entre Burkinabè. Mais l’un des points central de ce texte concerne le risque majeur d’une mutation du conflit. Il met en garde : la guerre contre le terrorisme pourrait sous la pression des frustrations populaires, basculer en guerre de libération nationale si l’Etat persiste à ignorer les revendications de démocratie, de justice sociale et de réconciliation. Pour lui, le danger serait que les groupes armés s’approprient ces causes et apparaissent comme des porte-voix des aspirations sociales et des libérateurs. Prudent Maître Yaméogo, parle de risque mais en réalité c’est presque déjà chose faite au vu des dernières déclarations du principal groupe armé djihadiste qui sévit dans les pays de l’AES (JNIM).
La rédaction de Mondafrique
Voici le texte d’Herman Yaméogo
ATTENTION AU RISQUE DE MUTATION DE LA GUERRE TERRORISTE EN GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE
Une analyse objective, lucide et courageuse de la situation nationale ne peut que conclure que (plus qu’à la croisée des chemins ) notre pays se trouve, pour la première fois de son histoire contemporaine, suspendu au-dessus du vide. Il marche, sans filet ni boussole, sur une véritable corde raide. Tous les indicateurs le confirment, qu’ils soient politiques, économiques, sociaux et, plus encore, militaires.
Il n’est donc plus admissible, à l’heure où nous sommes au bord du gouffre, de persister dans une voie dont l’inefficacité tragique a été démontrée par les faits. L’obstination à maintenir un cap manifestement erroné devient non seulement une faute politique, mais aussi une faute morale, car elle engage durablement la vie et l’avenir d’un peuple déjà durement éprouvé.
L’incapacité à reconnaître ses erreurs, à faire amende honorable, ou même à consentir à une simple pause réévaluatrice, contribue à enraciner dans les esprits un sentiment de fatalisme aussi dangereux que stérile. Il favorise l’idée d’une impasse inévitable, d’un destin scellé, ce qui constitue un terrain fertile pour toutes les formes de radicalisation et d’adhésion à des discours extrêmes.
Dans ce contexte, certains choix et comportements deviennent particulièrement inquiétants, notamment celui qui prend corps dans l’opinion publique : une possible reprise des négociations avec les groupes armés terroristes, après une première tentative restée sans suite.
Il convient de le rappeler avec force : si le dialogue est au cœur de nos traditions (dialogue fondé sur l’écoute, la réconciliation et la palabre féconde ) encore faut-il qu’il s’exerce dans un climat national pacifié, apaisé et légitime. Dans notre histoire, ce dialogue n’a jamais été cédé sous contrainte ou sous menace, encore moins dans un climat de terreur ou de déstructuration sociale. Il naissait d’un besoin de restauration de l’harmonie entre frères, dans le respect des coutumes et des institutions.
Or aujourd’hui, nous assistons à un renversement saisissant de cette logique : ce ne sont plus les autorités nationales, ni même les forces morales du pays, qui posent les conditions du dialogue, mais les groupes armés eux-mêmes. Ce sont eux désormais qui fixent les préalables : libération des détenus politiques, résolution de certains dossiers judiciaires sensibles, retour des exilés, réhabilitation de la vie démocratique, et pacification nationale.
Ce faisant, ils s’approprient les revendications légitimes de pans entiers de la population, revendications qui, lorsqu’elles émanaient de citoyens ou d’organisations civiles, ont été ignorées, voire méprimées. C’est là que réside le danger majeur : en apparaissant comme les nouveaux porteurs des aspirations populaires à la justice, à la vérité, à la réconciliation, et à la légitimation démocratique ces groupes armés sont en train de brouiller les lignes, de fondre le combat terroriste dans un discours de lutte pour la noble libération nationale.
L’histoire, y compris la plus récente, nous enseigne que de nombreuses guerres dites « terroristes » ont muté en conflits de type « guerres de libération », lorsque les causes populaires et les frustrations collectives ont été récupérées et instrumentalisées par des groupes violents, devenus ( dans l’imaginaire de certains ) les derniers recours face à un État perçu comme fermé, injuste ou autoritaire.
Écarter systématiquement les demandes de justice sociale, de grâce, d’amnistie, de réparation, de réconciliation, de vérité et de réhabilitation, c’est nourrir le glissement de la guerre terroriste vers une guerre de libération nationale, avec tout ce que cela comporte comme complexification du conflit, prolongation de la crise, et radicalisation des postures.
Il est donc impératif, pour éviter cette dangereuse mutation, de reprendre en main l’agenda du dialogue national , non pas sous la pression des armes, mais à la lumière de l’intérêt supérieur de la Nation. Il faut rouvrir les espaces de discussion entre Burkinabè, réconcilier les fils du pays entre eux, et donner des gages clairs d’un retour à une gouvernance fondée sur le droit, la justice et l’inclusion.
À défaut, nous risquons d’assister à un basculement aux conséquences incalculables, où les lignes entre terrorisme, insurrection et lutte de libération se confondront, précipitant la Nation dans une nouvelle phase de désagrégation.