La coopération militaire occidentale avec la Syrie d’Ahmed el-Charaa révèle une souveraineté profondément contrainte. Derrière la lutte contre Daech, se dessinent des fractures internes, l’affaiblissement des Kurdes, une recomposition régionale favorable à Ankara et les limites structurelles de l’efficacité militaire. Un entretien avec Roula Merhej, née à Hama et exilée en France sous le régime d’Hafez el-Assad, spécialiste des dynamiques géopolitiques du Moyen-Orient.
Le fait qu’Ahmed el-Charaa autorise des frappes étrangères sur son territoire consacre-t-il un nouveau modèle de souveraineté dite « consentie » ?
Lors de sa dernière visite à Washington, Ahmed el-Charaa a signé un accord officialisant l’entrée de la Syrie dans la coalition mondiale contre Daech. Rappelons que c’était l’une des conditions sine qua non pour la levée des sanctions économiques sur la Syrie. Partant de cette logique, on est face à une souveraineté extrêmement contrainte. Dans une Syrie en pleine reconstruction et en proie à des conflits internes, parler de « souveraineté consentie » serait presque excessif.
Ahmed el-Charaa ne choisit pas réellement : il accepte. Il accepte parce que son régime est encore fragile, en proie à des conflits intérieurs et économiquement exsangue après quatorze ans de guerre civile et cinquante années de dictature.
Dans ce cadre, l’autorisation donnée aux frappes occidentales ne relève pas d’un acte souverain classique, mais d’une collaboration sous contrainte stratégique. C’est aussi une façon de démontrer de la crédibilité sur la scène politique internationale.
C’est moins une souveraineté « consentie » qu’une souveraineté administrée, dans laquelle l’État syrien délègue une partie de sa sécurité pour survivre politiquement.
Où s’arrête réellement la coopération antiterroriste ?
Elle s’arrête là où commence la réalité des rapports de force.
Ahmed el-Charaa n’a pas la capacité politique ni militaire de désigner seul des cibles ou de redéfinir le périmètre de la lutte antiterroriste.
Toute extension de cette coopération est, de fait, conditionnée par un double aval : celui de la Turquie, qui contrôle une large partie de l’espace opérationnel au nord de la Syrie, et celui des États-Unis, qui restent l’architecte central du dispositif sécuritaire régional.
La lutte antiterroriste n’est donc pas pilotée depuis Damas, mais arbitrée à l’extérieur.
El-Charaa est davantage un exécutant qu’un prescripteur. Son rôle consiste à s’inscrire dans un cadre déjà défini, non à l’élargir — du moins pour les trois à cinq prochaines années à venir.
La limite réelle de la coopération est avant tout géopolitique.
Elle s’arrête là où les intérêts turcs commencent, notamment sur la question kurde, et surtout lorsque les priorités américaines changent.
II – L’AMBIGUÏTÉ DU RÉGIME SYRIEN
Comment crédibiliser une guerre contre Daech quand certains combattants visés sont d’anciens compagnons de combat du président syrien actuel ?
C’est avant tout un exercice de realpolitik et de communication stratégique.
Contrairement à une lecture simpliste, Ahmed el-Charaa et les réseaux djihadistes qu’il combat aujourd’hui ne sont pas des ennemis idéologiques originels. Il a fait le choix stratégique de se séparer d’al-Qaida pour recentrer son combat sur un objectif qu’il jugeait prioritaire : la libération de Damas du régime Assad, soutenu et financé par l’Iran.
Cette rupture ne marque pas un abandon de l’islam politique, mais le rejet du djihad global et du projet d’islamisation du monde porté par al-Qaida.
Dans ce cadre, el-Charaa a réussi à rallier à sa cause une partie d’anciens djihadistes autour d’un projet national syrien.
Cette capacité de recomposition lui donne une force politique à court terme, mais elle fragilise la crédibilité d’une rupture idéologique profonde, en l’absence de réformes sécuritaires et institutionnelles tangibles.
III – RISQUES INTERNES
Ces frappes peuvent-elles aggraver les fractures locales et nourrir une radicalisation souterraine ?
Oui, et le calendrier est loin d’être une simple coïncidence. La proximité entre les frappes franco-britanniques du 3 janvier dernier et la reprise violente des combats à Alep entre les forces kurdes et les forces gouvernementales ne doit pas être perçue comme un hasard sur le terrain.
En coordonnant leurs opérations avec un pouvoir syrien réhabilité diplomatiquement par Washington, les Occidentaux valident de facto la mission d’Ahmed el-Charaa : reprendre le contrôle du nord du pays, tout en s’alignant sur les priorités sécuritaires turques.
Ce signal est un recul clair du soutien occidental aux Kurdes au profit de Damas.
En lâchant les alliés d’hier et en intervenant aux côtés d’un pouvoir dominé par une majorité sunnite conservatrice, la France et le Royaume-Uni apparaissent comme les soutiens d’une recomposition politique excluante.
Les minorités — Kurdes, Alaouites, Druzes et chrétiennes — peuvent y voir la confirmation qu’elles ne font plus partie de l’équation sécuritaire, ce qui pourrait renforcer des logiques de repli, voire des appels à des formes de protection extérieure, notamment du côté druze.
Enfin, subsiste l’effet de trahison au sein des franges sunnites les plus radicalisées, autrefois proches idéologiquement d’Ahmed el-Charaa.
Pour ces groupes, la coopération avec l’aviation occidentale valide le narratif de la collaboration.
L’idéologie ne disparaît pas sous les frappes : elle se déplace, se durcit et s’enracine dans la clandestinité, nourrissant une radicalisation plus diffuse et plus difficile à contenir.
Qui contrôle réellement le terrain après les frappes ?
Les frappes nettoient, mais elles ne tiennent pas le terrain.
Les forces d’Ahmed el-Charaa sont fragmentées et mobilisées sur plusieurs fronts, notamment face aux forces kurdes à Alep.
Sans présence sécuritaire durable, les zones frappées risquent de devenir des espaces vacants. On assiste alors à une logique de dispersion : Daech se dissout, se reconfigure ailleurs et attend.
Le risque n’est pas le retour d’un État fort, mais une fragmentation territoriale chronique favorable au terrorisme et, par conséquent, à l’impossibilité de la création de l’unité nationale.
IV – EFFICACITÉ MILITAIRE
Les frappes aériennes peuvent-elles éradiquer Daech durablement ?
Non. L’histoire militaire contemporaine montre que les frappes aériennes peuvent contenir une menace, mais rarement l’éliminer. Elles détruisent des capacités matérielles, pas des structures idéologiques.
La chute du « califat » territorial entre 2014 et 2019 a certes affaibli Daech, mais ne l’a pas éliminé.
Sans réforme profonde de l’appareil sécuritaire syrien, cette stratégie peut-elle réussir ?
Non. Sans forces de sécurité unifiées, professionnelles et contrôlées politiquement, toute victoire restera temporaire et illusoire.
La stabilisation passe par la gouvernance, la justice et l’administration locale, pas uniquement par la puissance aérienne.
V – LECTURE RÉGIONALE
Comment ces frappes sont-elles perçues par les acteurs régionaux ?
Elles sont perçues comme un signal politique structurant, bien au-delà de la lutte contre Daech.
En menant ces frappes en coordination avec Damas et sans contrepartie visible en faveur des Kurdes, la coalition occidentale contribue de facto à leur affaiblissement politique et militaire.
Ce faisant, elle valide la lecture turque du dossier syrien : celle qui fait des forces kurdes non plus des partenaires tactiques, mais une variable d’ajustement acceptable. Ankara est ainsi rassurée sur ses priorités sécuritaires.
Dans le monde arabe sunnite, ces frappes sont lues comme une normalisation accélérée du nouveau pouvoir syrien, dans un contexte régional de plus en plus défavorable à l’Iran.
À Téhéran, elles confirment une marginalisation qui s’accélère vertigineusement, d’autant plus qu’avec les révoltes grandissantes le régime paraît être en fin de vie.
Israël, enfin, les analyse sous un prisme strictement sécuritaire : tout affaiblissement des acteurs non étatiques qui ne bénéficie pas à l’Iran est perçu positivement.
Quel est le rôle réel de la France dans ce nouvel ordre régional ?
La France dispose aujourd’hui d’une marge de manœuvre limitée, reflet d’un affaiblissement plus large de l’Europe au Moyen-Orient. Paris continue d’intervenir militairement et diplomatiquement, mais ne façonne plus l’architecture sécuritaire de la région.
Les priorités stratégiques et le tempo sont largement définis par les États-Unis, tandis que certaines lignes rouges, notamment israéliennes, s’imposent sans véritable capacité européenne à les infléchir.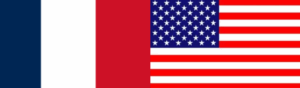
Dans ce cadre, la France apparaît davantage comme un partenaire opérationnel fiable que comme un acteur décisionnel central. Cette position réduit sa capacité à peser sur la recomposition politique de long terme et alimente l’idée d’une Europe présente mais marginalisée, active mais sans véritable levier stratégique.
Il est enfin essentiel de souligner que, tandis que l’attention internationale reste largement focalisée sur le Moyen-Orient, la menace djihadiste poursuit sa progression en Afrique — en République démocratique du Congo, au Nigeria, au Tchad ou encore en Somalie — dans un relatif angle mort stratégique occidental.






































