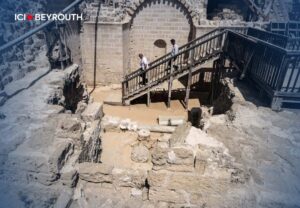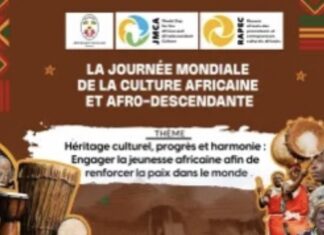Nabil Cheikhi, Enseignant-Chercheur à l’Université Ibn Tofaïl (Maroc), et auteur d’articles d’opinion, a siégé à la Chambredes Conseillers du Parlement marocain de 2016 à 2021 en tant que représentant du Parti de la Justice et du Développement (islamiste), dont il a présidé le groupe parlementaire durant son mandat. Il a égalementété membre à l’echel international de l’Union interparlementaire. Il a également été vice‑président du Conseil régional de Rabat‑Salé‑Kénitra.Au sein du parti, il a exercé les fonctions de membre du Secrétariat général entre 2017 et 2021, et il est actuellement membre du Conseil national.
Nous publions volontiers la vigoureuse et salutaire libre opinion de Nabil Cheikhi où, à limage d’une grande partie des Marocains, il estime que la reconnaissance de l’État palestinien ne doit pas enfermer enfermer ce dernier dans « des arrangements sécuritaires et économiques qui prolongent la dépendance ».: « la Palestine n’a pas besoin d’une coquille étatique sous tutelle, poursuit-il, elle a besoin d’une souveraineté pleine et entière ».

« La reconnaissance de la Palestine survient au moment même où les territoires se réduisent, la colonisation s’accélère »
Depuis quelques mois, une série de capitales occidentales, latino-américaines et africaines ont officialisé leur reconnaissance de l’État de Palestine. L’événement pourrait sembler historique : pour la première fois, des pays du Nord rejoignent une dynamique portée depuis longtemps par le Sud global et par le droit international. Pourtant, derrière cet élan symbolique, un doute persistant s’installe : s’agit-il d’un pas vers la souveraineté palestinienne ou d’une reconnaissance vidée de son contenu réel, conçue comme un outil de gestion plutôt qu’un instrument de libération ?
La Déclaration de New York, devenue cadre de référence de ces reconnaissances, illustre cette ambiguïté. Le texte proclame un objectif ambitieux : « mettre fin à l’occupation et établir un État palestinien indépendant et viable sur les lignes de 1967 ». Mais il enchaîne aussitôt avec des conditions qui dessinent cet État sous un prisme contraignant : désarmé, surveillé, encadré économiquement, placé sous tutelle internationale. Autrement dit, un État sur le papier, mais sans les attributs fondamentaux de la souveraineté.
Une reconnaissance sous conditions

L’histoire des luttes de libération est riche d’exemples où la reconnaissance internationale s’est heurtée à la réalité du pouvoir colonial ou impérial. En Palestine, la contradiction est encore plus flagrante : la reconnaissance survient au moment même où les territoires se réduisent, la colonisation s’accélère et la population subit guerres, blocus et expulsions. On pourrait croire à un paradoxe. En réalité, il s’agit d’un mécanisme politique bien rodé : proclamer un État comme horizon, mais l’enfermer dans des arrangements sécuritaires et économiques qui prolongent la dépendance. C’est une reconnaissance sous conditions, destinée à stabiliser une situation intenable plutôt qu’à la transformer.
La première dimension de cette souveraineté amputée concerne la sécurité. La future entité palestinienne est envisagée comme désarmée, dépendante de missions de surveillance multinationales et placée sous la responsabilité de garants extérieurs. Or, aucun État n’a jamais pu construire sa sécurité en se voyant retirer le droit à l’autodéfense. L’expérience historique le prouve : c’est la capacité à dissuader, non la tutelle étrangère, qui assure la stabilité à long terme. Un « État sous protection » est un État vulnérable, réduit à gérer son territoire sans jamais garantir la sécurité de son peuple.
La deuxième dimension est économique. La Déclaration insiste sur la « bonne gouvernance », la « transparence », la « soutenabilité budgétaire ». Derrière ces mots se profile un agenda néolibéral qui conditionne toute indépendance économique à des réformes encadrées par les bailleurs. La monnaie, les douanes, les frontières resteraient sous contrôle externe. La Palestine deviendrait ainsi un « État géré par l’aide », dépendant de transferts financiers et vulnérable au chantage budgétaire, plutôt qu’un acteur économique souverain. Promesses de développement, intégration régionale, corridors d’infrastructures : autant de projets séduisants en apparence, mais qui contournent la question centrale du contrôle souverain.
Or une économie sans politique monétaire autonome , sans douanes autonomes, sans maîtrise de ses frontières, n’est pas une économie indépendante. Ce modèle risque de reproduire les fragilités actuelles : chômage élevé, dépendance aux importations, faible valeur ajoutée locale. Pire encore, l’aide internationale est souvent orientée non vers la production, mais vers la sécurité et la coordination avec l’occupant. L’État à venir serait donc moins un acteur économique qu’un gestionnaire de frontières au service de la stabilité régionale. On retrouve ici un schéma déjà observé ailleurs : des économies placées sous tutelle extérieure, contraintes de suivre des recettes libérales standardisées, incapables de développer un modèle propre. La promesse de « compétitivité » se traduit en dépendance structurelle.
Troisième dimension : la question des réfugiés. Le droit au retour, pilier du droit international, est repoussé à plus tard. L’UNRWA, institution qui maintenait ce droit dans le cadre onusien, est menacée de démantèlement au profit de structures palestiniennes intégrées à l’agenda international. Le risque est de transformer un droit politique en simple dossier de services sociaux et d’indemnisation. Cette translation technocratique aurait des conséquences profondes : elle viderait de sa substance une revendication fondatrice et réduirait une question de justice et de mémoire à un problème administratif. Là encore, la souveraineté se dissout dans des dispositifs gestionnaires.
Une logique d’exclusion
À ces amputations s’ajoute une logique politique d’exclusion. La Déclaration évoque la nécessité d’écarter « les acteurs perturbant le processus de paix ». Derrière cette formule se cache une volonté de marginaliser les forces de résistance palestiniennes, accusées de « violence » alors même que leur action a contribué à imposer la question palestinienne sur la scène internationale. L’histoire offre ici encore des comparaisons éclairantes :personne n’a demandé à De Gaulle de disparaître après la Libération, ni aux composantes du mouvement national marocain, qui avaient chassé le colonisateur français et espagnol, de se retirer après l’indépendance, ni au FLN algérien de s’effacer en 1962, ni à Mandela et à l’ANC de quitter la scène à l’indépendance. La légitimité de ces mouvements venait précisément de leur rôle dans la lutte. Exiger aujourd’hui l’exclusion de ceux qui ont rendu l’occupation coûteuse revient à transformer la reconnaissance en instrument de neutralisation politique.
Faut-il pour autant rejeter la reconnaissance ? Non. Elle conserve une valeur symbolique et diplomatique réelle : elle contribue à isoler l’occupation, à réaffirmer le droit des Palestiniens à l’autodétermination et à rappeler l’illégalité de la colonisation. Mais il serait illusoire d’y voir une solution en soi. La vraie bataille commence après : transformer ce symbole en levier contraignant, faire en sorte que l’État reconnu corresponde à un État réel, avec des frontières, une défense, une économie et des droits garantis.
Cinq conditions pour une vraie reconnaissance
Une reconnaissance digne de ce nom devrait remplir au moins cinq conditions : souveraineté pleine sur le territoire et les frontières ; droit à l’autodéfense garanti ; indépendance économique réelle par le contrôle des douanes, de la monnaie et des impôts ; garantie effective du droit au retour, non réduit à une indemnisation ; mécanismes de responsabilité imposant des sanctions contre la colonisation. Sans cela, l’État promis n’est qu’un État sous tutelle, incapable de protéger sa population ni de définir son avenir.
La question dépasse le seul cas palestinien. Elle met à l’épreuve l’ordre international lui-même. Peut-on continuer à proclamer des principes universels — droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la force — et les vider de leur substance dès qu’il s’agit de la Palestine ? Chaque reconnaissance partielle, chaque compromis qui sacrifie la souveraineté à la stabilité, élargit le fossé entre discours et réalité. À terme, c’est la crédibilité même du système international qui est en jeu. L’érosion du droit universel au profit d’arrangements circonstanciels fragilise l’ensemble du cadre multilatéral et installe l’idée que certaines causes, certains peuples, seraient voués à des solutions inachevées.
La vague de reconnaissances actuelles ne doit donc pas être rejetée : elle représente un pas symbolique important, un outil diplomatique utile. Mais elle ne saurait suffire. L’essentiel est de s’assurer qu’elle ne se réduise pas à une gestion de crise, qu’elle ne transforme pas la cause palestinienne en simple dossier de gouvernance. La Palestine n’a pas besoin d’une coquille étatique sous tutelle. Elle a besoin d’une souveraineté pleine et entière. C’est à cette condition seulement que la reconnaissance cessera d’être un substitut pour devenir une étape fondatrice.
Nabil Cheikhi
Ex Parlementaire PJD, Maroc