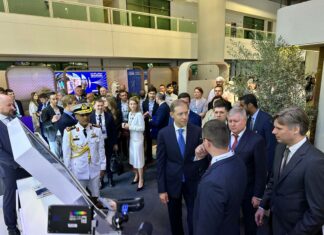Au Liban, un garagiste d’Akkar (province marginalisée du nord du pays) s’est fait passer pour un prince saoudien et a réussi à influencer des députés jusqu’à la désignation du Premier ministre fin 2025. Chronique d’une farce politique qui révèle un mal bien plus profond.
Il s’appelait « Abu Omar ». Il parlait avec l’accent saoudien, citait Riyad avec l’assurance d’un diplomate, évoquait des « instructions de la cour royale » comme on lit un bulletin météo. Il ne rencontrait personne, ne signait rien, n’apparaissait nulle part. Il téléphonait. Et cela suffisait.
En réalité, derrière la voix se cachait Moustafa al-Hasian, quadragénaire, garagiste dans la province d’Akkar. Une région marginalisée du nord du Liban, plus connue pour ses routes cabossées que pour ses intrigues d’État. Pourtant, pendant plusieurs années, cet homme aurait réussi à monnayer de prétendues connexions saoudiennes contre des faveurs économiques et politiques auprès de parlementaires libanais. Jusqu’à peser, selon plusieurs témoignages, sur l’élection du Premier ministre fin 2025.
Le scénario paraît invraisemblable. Il ne l’est pas. Il est, au contraire, d’une cohérence implacable.
Car « Abu Omar » n’a pas seulement exploité la crédulité de quelques élus. Il a exploité une structure. Un système politique fondé sur l’équilibre confessionnel, la recherche permanente de parrainages extérieurs et l’obsession des signaux venus d’ailleurs.
Selon les révélations du Financial Times, c’est une parfaite maîtrise de l’accent saoudien et une connaissance fine des positions diplomatiques de Riyad qui auraient permis au faux prince de convaincre. Dans un pays où l’appui de l’Arabie saoudite peut redessiner des alliances internes, la voix compte parfois davantage que la preuve.
Un cheikh sunnite influent d’Akkar, Khaldoun Oraymet, aurait servi d’intermédiaire. Son réseau, s’étendant des hommes d’affaires du Golfe aux membres du gouvernement, aurait ouvert des portes. Le garagiste devenait alors une passerelle supposée vers Riyad. Et chacun voulait traverser.
Les politiciens rivalisaient d’attention. On offrait une voiture au fils du cheikh. On sollicitait l’aide d’« Abu Omar » pour obtenir des médailles équestres en Arabie saoudite. On demandait des appuis, des bénédictions, des signes.
Le détail le plus révélateur ? Personne ne rencontrait jamais le fameux prince. Tous les échanges se faisaient par téléphone. Un indicatif britannique, une voix assurée, et le tour était joué.
L’affaire aurait atteint son apogée lors de la course à la présidence du Conseil en 2025. Prétextant des « instructions de la cour royale saoudienne », Abu Omar aurait demandé à un groupe de députés de ne pas voter pour le Premier ministre sortant, Najib Mikati.
Selon le député Ahmed Kheir, plusieurs participants auraient alors changé leur vote en faveur de Nawaf Salam, finalement désigné le 13 janvier 2025.
Influence réelle ou exagération a posteriori ? La justice devra trancher. Mais le simple fait que des parlementaires admettent avoir été sensibles à des consignes téléphoniques d’un émissaire jamais vu dit déjà beaucoup.
Le 20 janvier, la juge d’instruction de Beyrouth, Roula Osman, a émis un mandat d’arrêt contre Moustafa al-Hasian et Khaldoun Oraymet. Les deux hommes sont poursuivis pour fraude, chantage, usurpation d’identité, influence sur des décisions de vote et atteinte aux relations entre le Liban et l’Arabie saoudite.
La farce s’est transformée en dossier pénal.
Une comédie révélatrice
On pourrait rire. Un garagiste devenu prince. Des députés fascinés par un accent. Des décisions politiques influencées par un numéro britannique.
Mais l’ironie masque mal une réalité plus inquiétante.
Comme l’a souligné au Financial Times Sami Atallah, directeur du think tank The Policy Initiative à Beyrouth, l’affaire illustre « à quel point l’élite politique s’est soumise aux décisions des puissances étrangères ». La phrase est sévère. Elle n’est pas nouvelle.
Le système libanais repose depuis des décennies sur des équilibres externes : Arabie saoudite pour une partie du camp sunnite, Iran pour le camp chiite, appuis occidentaux pour d’autres forces. Les leaders se targuent de soutiens internationaux pour asseoir leur légitimité interne.
Dans ce contexte, l’idée qu’un émissaire de Riyad puisse appeler et donner une « consigne » n’a rien d’absurde. Elle s’inscrit dans une pratique politique familière : attendre le signal.
Abu Omar n’a donc pas inventé le mécanisme. Il s’y est glissé.
Ce scandale révèle aussi une autre faille : la confusion entre symbolique et réel. Dans un système saturé de rumeurs, d’émissaires officieux, de médiations discrètes, la frontière entre le vrai et le vraisemblable s’estompe.
Il suffit d’une voix crédible. D’un discours cohérent. D’une promesse de soutien.
La politique devient alors un théâtre où l’apparence de l’appui vaut presque autant que l’appui lui-même.
Que des responsables publics aient pu se laisser convaincre par un interlocuteur jamais rencontré en personne interroge la solidité des procédures, mais aussi la culture politique. La vérification semble avoir cédé la place à la projection : on voulait croire à l’existence d’un prince influent. On a donc cru.
Depuis la révélation de l’affaire en décembre, la question circule : combien d’« Abu Omar » y a-t-il au pays du Cèdre ?
La formule, reprise par plusieurs médias, dont notre confrère Ici Beyrouth – lien menant à l’article en fin de page -, dépasse le cas d’espèce. Elle renvoie à une inquiétude plus large : si un garagiste peut influencer des choix politiques majeurs, qu’en est-il des véritables réseaux d’influence ? Des intermédiaires discrets, des conseillers officieux, des bailleurs invisibles ?dépasse le cas d’espèce. Elle renvoie à une inquiétude plus large : si un garagiste peut influencer des choix politiques majeurs, qu’en est-il des véritables réseaux d’influence ? Des intermédiaires discrets, des conseillers officieux, des bailleurs invisibles ?
Abu Omar n’est peut-être que la version caricaturale d’une pratique plus diffuse.
L’ironie de l’histoire tient à ceci : il n’a pas eu besoin d’argent colossal, ni d’appareil sophistiqué, ni de protection diplomatique. Il a eu besoin d’un accent et d’un système prêt à l’écouter.
Dans une démocratie fragilisée, où la souveraineté est souvent négociée, symboliquement ou réellement, l’autorité se mesure parfois à la proximité supposée avec l’étranger.
Le faux prince a prospéré sur cette obsession.
Son arrestation clôt un chapitre judiciaire. Elle n’efface pas la question politique.
Car le scandale ne révèle pas seulement l’audace d’un individu. Il met en lumière une vulnérabilité structurelle : celle d’élites qui cherchent à l’extérieur la validation qu’elles peinent à trouver à l’intérieur.
Abu Omar n’était peut-être qu’un mirage. Mais s’il a pu exister si longtemps, c’est que le désert était déjà là.