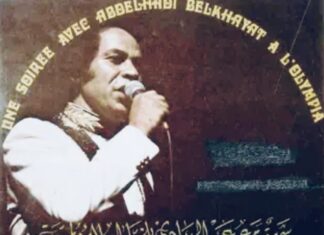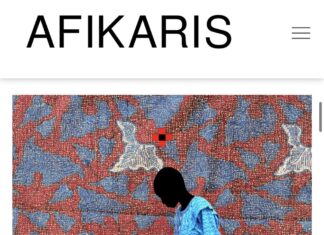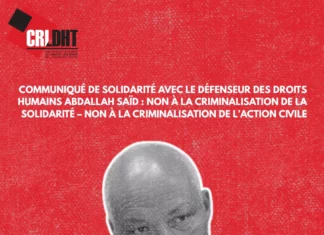Lors de l’attaque israélienne à Doha, les dirigeants ont survécu (notamment Khalil al‑Hayya, selon les sources actuelles) mais le fils de ce dernier et un officier qatari sont morts. Le Hamas a démenti les affirmations selon lesquelles certains cadres auraient été tués.
Installés à Doha depuis plus d’une décennie, les chefs du Hamas poursuivent leurs opérations politiques depuis l’étranger, tandis que la population de Gaza endure les bombardements, la famine et la destruction. Le contraste entre exil doré et souffrance sur le terrain révèle un abîme moral et politique.
Depuis 2012, le Qatar héberge le bureau politique du Hamas, une structure destinée à la gestion diplomatique, à la médiation et à la représentation internationale du mouvement. Cette présence s’est consolidée notamment après l’expulsion des dirigeants de Syrie, dont Khaled Mechaal, qui y séjourne depuis cette époque. Des hauts responsables comme Khalil al‑Hayya, Mousa Abu Marzouk ou encore Muhammad Ismail Darwish vivent dorénavant à Doha.
Le choix du Qatar n’est pas un hasard : le petit émirat, riche, stratège, médie les conflits, dispose d’institutions internationales influentes, et a entretenu des relations de communication directe avec le Hamas à la demande des États‑Unis. En accueillant le bureau politique, Doha s’est vu assigner le rôle d’intermédiaire clé dans les pourparlers de cessez‑le‑feu, d’échange de prisonniers et de livraison d’aide humanitaire.
Cela dit, l’exil ne permet pas un contrôle direct du territoire. Ainsi, quand Israël mène des frappes ciblées, comme celle de Doha le 9 septembre 2025, visant des membres du Hamas dans leur résidence qatarie, le message est clair : même hors de Gaza, les dirigeants ne sont pas à l’abri. Trois points clés ressortent de ce modèle de « direction à distance » :
- Démultiplication des communications mais affaiblissement militaire : les ordres, les décisions stratégiques, les alliances, s’organisent depuis l’étranger. Cela donne une liberté certaine à ceux qui ne sont pas exposés aux assauts directs. Mais cela crée un découplage avec la réalité du terrain, parfois des retards, des incompréhensions, un leadership moins visible.
- Symbole politique puissant vs légitimité du terrain réduite : habiter à Doha ou dans d’autres capitales arabes permet de siéger dans des conférences, d’apparaître dans les médias internationaux, de négocier. Mais la population de Gaza voit quotidiennement ses dirigeants comme loin, parfois détachés, peu exposés aux souffrances qu’elle traverse.
- Sécurité et confort matériel vs sacrifice et risque pour la population : alors que les bombardements, les déplacements forcés, la famine, le manque d’eau ou d’électricité affectent les victimes à Gaza, les exilés disposent de sécurité diplomatique, d’un certain confort (logement, accès aux infrastructures internationales), d’une visibilité politique. Le contraste peut paraître cynique, et nourrit le ressentiment.
Pourquoi le Qatar les reçoit?
Plusieurs raisons expliquent pourquoi Doha a permis et continue de permettre que le Hamas y maintienne une présence officielle.
- Un rôle de médiateur. Le Qatar veut être perçu comme un acteur de paix, un pont entre l’Occident, Israël, l’Iran, les États arabes et les mouvements palestiniens. Avoir un canal direct avec le Hamas lui donne un rôle stratégique dans les négociations.
- Les pressions américaines. Selon certaines déclarations, la décision d’accueillir le bureau politique du Hamas remonterait à une demande des États‑Unis, pour maintenir un canal de communication avec le Hamas, en particulier dans le cadre de missions de médiation.
- Un positionnement régional. Le Qatar entretient une diplomatie basée sur le prestige, les aides humanitaires, les médias puissants (Al Jazeera), le sponsoring, les accords culturels. Soutenir le Hamas permet aussi de renforcer son image auprès des populations arabes et musulmanes, où la cause palestinienne reste fortement symbolique. Le Qatar est aussi soumis à des contraintes diplomatiques. Il doit maintenir de bonnes relations avec les États‑Unis, avec l’Occident, tout en affirmant sa souveraineté régionale. Recevoir le Hamas lui permet de jouer sur tous les tableaux.
Malgré ces bénéfices, la situation est instable. L’attaque de Doha illustre que cette tolérance a un prix : menaces d’atteintes à la souveraineté, mise en cause de la neutralité du médiateur, pression internationale pour expulser ou déplacer les leaders. Le Qatar a même évoqué revoir son rôle de médiateur, compte tenu des abus ou des risques politiques liés.
Le prix payé par la population à Gaza
Ce que fait la gouvernance du Hamas depuis son exil maintient qu’il y ait un décalage entre leadership et population, mais aussi que ce leadership, malgré sa dimension politique, dessert parfois indirectement les intérêts des Palestiniens.
- Le décalage entre promesses et réalités. Quand les dirigeants exilés parlent de « résistance », négocient à l’étranger, reçoivent aide humanitaire, manquent de médiation, la population sur le terrain endure des bombardements, le manque d’eau, d’électricité, d’infrastructures, le chômage, la faim. Ce contraste alimente colère et désillusion.
- Une compétence limitée sur les services essentiels. Le Hamas, qui contrôle Gaza, est accusé de gérer mal les secteurs clés : santé, éducation, distribution d’aides, réhabilitation après les attaques. Le leadership en exil ne subit pas directement ces défaillances mais en est politiquement responsable.
- Une utilisation opaque des ressources. Certaines aides destinées au peuple palestinien passent par les circuits du Hamas. Quand le Hamas fait de la politique à Doha, il dispose de fonds, d’alliés diplomatiques, souvent mieux protégés que les civils. La perception qu’un leadership mène une vie plus sûre et privilégiée est très présente dans les témoignages et reportages.
- La Résistance palestinienne fracturée. Voir ses dirigeants vivre hors de danger alimente un sentiment de trahison. Beaucoup à Gaza perçoivent que les décisions sont prises ailleurs, dans des hôtels diplomatiques, tandis que le prix du conflit reste payé par la population civile.
Les dirigeants du Hamas exilés au Qatar incarnent un paradoxe douloureux : ils sont à la fois visibles sur la scène internationale, négociateurs, diplomates, mais aussi symboles d’une distance — physique, morale, symbolique — entre le lieu du pouvoir et le lieu de la souffrance. Pendant que Gaza brûle, il y a urgence à ce que ses dirigeants soient davantage qu’une voix publique lointaine.
Le soutien des États arabes reste souvent verbal, modéré, ponctuel. Leurs gouvernements, pris dans des équilibres complexes, peinent à agir au-delà des mots, protégeant leurs propres intérêts sécuritaires, économiques, diplomatiques et politiques. Mais à mesure que les images de destruction s’accumulent, que le nombre des victimes civils grimpe, que la fatigue morale gagne les opinions publiques, la demande de sincérité grandit.
Ce moment dramatique, avec le bombardement de Doha, pourrait être un tournant. Soit les dirigeants du Hamas renoueront un lien plus profond avec la souffrance de leur peuple, soit ils s’exposeront à être perçus comme des marionnettes diplomatiques installées loin du sang. Et soit les États arabes choisiront de cesser de ménager Israël et de faire face à des choix plus clairs, quitte à risquer leurs conforts diplomatiques.