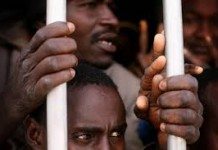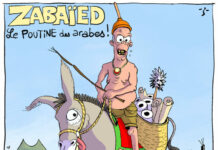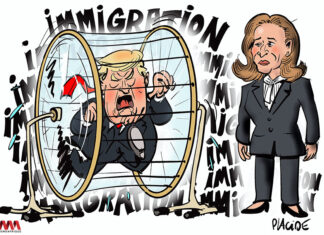Peu d’alliances politiques dans le monde musulman suscitent autant d’interrogations que celle qui unit, dans l’ombre, les Frères musulmans à la République islamique d’Iran. Si ces deux entités semblent a priori opposées — l’une sunnite, l’autre chiite —, leur coopération depuis la Révolution iranienne de 1979 et surtout depuis les massacres terroristes du 7 octobre 2023 contre les civils israéliens révèle une convergence d’intérêts dont les répercussions régionales pourraient être décisives.
Badih Karhani à Tripoli (Liban)

Les Frères musulmans sont nés en 1928 en Egypte, à Ismaïlia, au nord-est du Caire, sur les rives du canal de Suez. Fondée par le cheikh Hassan Al-Banna, l’organisation sunnite et réformiste se fixe deux objectifs précis : libérer le pays du joug britannique, et prendre le pouvoir d’une Egypte à nouveau imprégnée des valeurs de l’islam.
La confrérie se forge une popularité par l’organisation d’activités caritatives et sociales, destinées à séduire les couches populaires comme les classes moyennes. Ce programme fait la part belle à la religion, grâce à un mouvement d’éducation populaire, pensé pour assurer la régénération de l’islam. Un investissement clé aux yeux de Hassan Al-Banna, instituteur de formation.
Le rapprochement idéologique de la célèbre confrérie égyptienne avec l’Iran se produit dès la Révolution islamique de 1979. Lorsque l’Ayatollah Khomeiny prend le pouvoir en Iran, il reçoit un accueil enthousiaste de la part de nombreux mouvements islamistes sunnites, dont les Frères musulmans, séduits par la portée « islamique » de la révolution. Bien que de confession chiite, le régime iranien prône une lutte contre « l’impérialisme » et « l’arrogance occidentale » qui trouve un écho fort chez les Frères.
Ce rapprochement n’était pas qu’idéologique : des œuvres de Sayyid Qutb, penseur radical des Frères musulmans, ont été traduites en persan sous l’égide directe de l’ayatollah Ali Khamenei, signe d’une volonté de bâtir un socle doctrinal commun autour du rejet des régimes laïcs et de la souveraineté populaire.
La Syrie, point de rupture historique
Ce front uni trouve cependant une ligne de fracture majeure en Syrie. Dès les années 1980, les Frères musulmans syriens entrent en rébellion armée contre le régime de Hafez al-Assad, farouche allié de l’Iran. Les massacres qui sous le rêgne du clan Assad coûtèrent la vie à des dizaines de milliers de sunnites éloignèrent radicalement « les Frèrots » du pouvoir syrien et du coup de leur allié, le régime de Téhéran.
Le responsable du département de formation des Frères musulmans en Syrie, Samir Abou Al-Laban (voir son portrait ci dessus) , expliquait dans un entretien avec Mondafrique alors que le clan Assad était encore au pouvoir: « Nous sommes encore présents sur la scène syrienne comme n’importe quel autre parti ». Du moins, avait-il ajouté, « autant que les circonstances le permettent ». Permettons nous de noter que cette présentation est un peu optimiste. Depuis le massacre de milliers de militants dans la ville de Hama par le régime alaouite en 1982 dans une atroce « Saint Barthélémy » anti sunnite, les Frères Musulmans syriens n’avaient plus relevé la tête.
Cette relégation de la confrérie touche-t-elle à sa fin avec l’écroulement du régime syrien? Lors d’une ne récente rencontre en décembre à Damas dont Mondafrique publie la photo ci dessus, on découvre au centre le chef de HTC et nouveau maitre de Damas, Ahmed Al Charâ, alias Al Joulani, avec à sa droite un des leaders des frères musulmans égyptiens, Mahmoud Fethi, qui réside en Turquie et sur sa gauche, le conseiller des relations extérieures du parti du président Erdogan. Cette photo de famille dénote en tout cas une proximité entre les trois leaders syrien, turc et égyptien avec la mouvance Frères Musulmans. D’autant que par ailleurs le nouveau pouvoir syrien a donné peu de signes d’ouverture aux mouvements d’opposition et n’a pas amorcé de véritable rencontre avec les représentants des principales minorités vivant en Syrie. D’où un possible retour au Moyen Orient de la confrérie, soubassement de l’Islam politique arabe honni par les monarchies pétrolières, mais qui pourrait nouer avec Téhéran des alliances de circonstance.
Hamas, le bon élève
Les chiites au pouvoir en Iran ont su dans le passé passer une solide alliance avec la branche palestinienne des Frères musulmans, bien que sunnite. Le Hamas affiche une proximité assumée avec l’Iran, notamment sur le plan militaire et financier.
Malgré des tensions passagères au moment de la brutale répression d’Assad contre le courant fondamentaliste dans son pays, l’alliance s’est renforcée ces dernières années entre le Hamas et l’« axe de la résistance » aux côtés du Hezbollah et de l’Iran, les alliés pourtant du régime syrien.
Le double jeu de la Jamaa Islamiya libanaise
Contrairement à la Syrie où le régime du clan Assad, père et fils, a massacré toutes les rébellions sunnites, les Frères musulmans ont réussi à se fondre dans le paysage politique libanais démocratique. À quelques centaines de kilomètres de Damas, la Jamaa Islamiya (« le Groupe Islamique ») dispose ainsi de nombreux relais à Tripoli, seconde ville du Liban et capitale du sunnisme. Mais c’est à Beyrouth où les « Frères » possèdent de superbes locaux, qu’ils ont créé une radio et un journal qui leur donnent une vraie présence médiatique.
Au sein ce ce mouvement frériste, coexistent une force armée, les « Fajr » (1), et des représentants politiques, comme leur seul élu au Parlement, Imad al-Hout, un médecin formé en France devenu le député du Beyrouth ouest sunnite(2). Un peu à la façon du Hezbollah, un pied au Parlement et un autre dans une milice armée redoutable. Dans les années 1990, la Jamaa Islamiya refusait de participer au Parlement libanais qu’il considérait comme non islamique. Souvent le Frère Musulman varie!
On les découvre collaborant désormais avec le Hezbollah chiite, pour qui ils constituent une caution sunnite inespérée. Sur fond d’un soutien financier de l’Iran chiite qu’ils ont toujours ménagé, de personnalités koweitiennes et d’ONG islamiques. Ce trésor de guerre qui leur permet une influence non négligeable dans un Liban miné par la crise économique.
La Jordanie dans la ligne de mire
La découverte récente d’une cellule affiliée aux Frères musulmans en Jordanie, accusée d’avoir reçu un entraînement militaire au Liban, jette une lumière nouvelle sur les ambitions régionales de l’Iran. Pour Téhéran, la Jordanie représente un maillon clé pour l’expansion de son influence, à l’image de ce qui a été réalisé au Liban, en Irak, au Yémen et à Gaza.
La crainte exprimée par les autorités jordaniennes est claire : la constitution de milices pro-iraniennes camouflées sous des slogans de soutien à la Palestine, mais œuvrant à la déstabilisation interne. Une stratégie déjà bien rodée ailleurs dans la région.
Ainsi, malgré leurs différences confessionnelles, l’Iran et certains courants des Frères musulmans semblent partager une ambition commune : remodeler l’ordre régional au détriment des régimes en place. Une convergence qui soulève de nombreuses interrogations sur l’autonomie réelle de ces groupes et sur leur rôle dans les conflits en cours.
Si cette dynamique se confirme, les conséquences pourraient être majeures, non seulement pour la Jordanie, mais pour l’ensemble du Moyen-Orient.