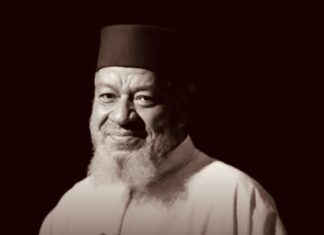Dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, le président Donald Trump a annoncé la conclusion d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et l’Iran, mettant un terme à ce qu’il a qualifié de « Guerre des Douze Jours ». Toutefois, cet accord demeure aujourd’hui précaire (1). En deux semaines de conflit, la guerre Israël-Iran ne s’est pas limitée à une confrontation bilatérale entre les deux puissances. Elle a, en réalité, fait peser une menace sur l’ensemble de la région.
La rédaction de Mondafrique
La région du Golfe se trouve aujourd’hui confrontée à trois risques majeurs : d’une part, la menace de représailles iraniennes contre les intérêts militaires américains ; d’autre part, le risque d’incident radiologique en cas de frappes sur les installations nucléaires iraniennes ; enfin, la possibilité d’une crise énergétique et économique mondiale en cas de fermeture du détroit d’Ormuz.
Dans ce contexte, les monarchies du Golfe cherchent à jouer un rôle de tampon diplomatique. Toutefois, leur marge de manœuvre demeure étroite, exposées à l’Iran par leurs relations avec les États-Unis. Le cessez-le-feu récemment annoncé reste précaire, et la crainte d’une nouvelle escalade est omniprésente.
La stabilité du Golfe est devenue un enjeu stratégique, non seulement régional, mais également mondial, engageant la responsabilité et la vigilance de la communauté internationale dans son ensemble. Les récentes frappes directes menées par le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) contre la base militaire américaine d’Al Udeid au Qatar illustrent la vulnérabilité croissante de la péninsule arabique, qui pourrait être instrumentalisée comme théâtre d’affrontements indirects contre les intérêts américains dans la région.
Le Golfe, allié historique des États-Unis
Les relations entre les États-Unis et les monarchies du Golfe remontent à la Seconde Guerre mondiale et la signature du pacte de Quincy en février 1945 entre le président américain Franklin D. Roosevelt et le roi Ibn Saoud, fondateur du royaume d’Arabie saoudite. Cet accord prévoyait la garantie d’une protection militaire américaine en échange d’un accès privilégié au pétrole saoudien. Trois ans plus tard, en 1948, les États-Unis renforcent leur présence régionale par l’établissement d’une base navale à Bahreïn, occupée aujourd’hui par la 5e flotte américaine.
Au cours des décennies 1970 et 1980, cette présence militaire s’est progressivement étendue, pour se consolider à la suite de la première guerre du Golfe avec la création de nouvelles bases militaires au Koweït et au Qatar. À l’heure actuelle, la région du Golfe accueille une présence militaire américaine massive, estimée entre 40 000 et 50 000 soldats répartis sur une dizaine de bases majeures, dont trois bases au Koweït, la base navale au Bahreïn, ainsi que la base aérienne d’Al-Udeid au Qatar, située à moins de 300 kilomètres des côtes iraniennes. Cette dernière pourrait être visée par l’Iran, comme en témoigne la frappe qu’elle a subie le 23 juin, en représailles à l’attaque américaine sur les infrastructures nucléaires iraniennes deux jours auparavant.
Les liens stratégiques et historiques entre les États-Unis et les monarchies du Golfe, tout comme la concentration des infrastructures militaires américaines dans la région, en font une cible privilégiée pour l’Iran. Malgré le retrait préventif de plusieurs escadrons d’Al-Udeid par Washington, et le fait que l’attaque du 21 juin ait été lancée depuis une base située dans le Missouri et non du Golfe – avec seulement un appui limité depuis la Jordanie – les installations américaines dans le Golfe demeurent vulnérables. En Irak, les bases américaines ont également été la cible d’attaques le 24 juin, menées par des milices chiites pro-iraniennes à l’aide de missiles.
Ainsi, dans le cas d’une reprise des hostilités, les bases américaines situées au Koweït, au Bahreïn, au Qatar, en Arabie saoudite, en Jordanie, en Syrie, voire en Irak, pourraient constituer les cibles principales des représailles iraniennes et de celles de ses alliés. Il s’agirait pour Téhéran d’une manière de frapper les intérêts américains, tout en évitant une confrontation armée sur le territoire américain.
Les monarchies du Golfe, des acteurs diplomatiques
Depuis les attaques du 7 octobre, les monarchies du Golfe – en particulier l’Arabie saoudite, le Qatar, le sultanat d’Oman et les Émirats arabes unis – se sont affirmées comme des acteurs diplomatiques de premier plan dans la gestion des conflits au Moyen-Orient. Liés aux États-Unis depuis des décennies, ces États conservent également des liens avec Israël, malgré l’absence de normalisation officielle des relations avec l’Arabie saoudite, le Qatar et Oman. Parallèlement, les monarchies maintiennent des relations avec l’Iran et la Russie. Ces canaux de communication avec toutes les parties du conflit leur confèrent une position de médiateurs dans un environnement géopolitique fragmenté.
Face à la montée des tensions entre Israël et l’Iran, ces monarchies s’emploient donc à limiter l’escalade en participant aux démarches diplomatiques. Le Qatar, en particulier, a joué un rôle central dans les négociations entre le Hamas et Israël, tandis qu’Oman a accueilli les pourparlers indirects entre les États-Unis et l’Iran lors des cinq derniers cycles de discussions. Cette diplomatie régionale vise à préserver la stabilité économique et sécuritaire du Golfe, tout en évitant une implication directe dans un conflit de grande ampleur.
Néanmoins, cette posture d’équilibre est mise à l’épreuve par la confrontation directe entre Israël et l’Iran, qui marque une rupture avec le modus operandi habituel de Téhéran, traditionnellement fondé sur l’utilisation d’acteurs non étatiques comme le Hezbollah. Ce changement de paradigme pourrait limiter la capacité des États du Golfe à maintenir leur neutralité. Bien qu’ils soient perçus comme des médiateurs, leur proximité avec les États-Unis les expose à des attaques indirectes, comme l’a illustré le tir de missiles sur la base américaine d’Al-Udeid, située au Qatar.
(1) Moins de quelques heures après son annonce, Tel-Aviv a été la cible de tirs de missiles iraniens, tandis que le ministre israélien Bezalel Smotrich menaçait de faire trembler Téhéran en guise de représailles. Depuis lors, le président Trump s’efforce d’apaiser les tensions entre les deux parties, appelant au respect du cessez-le-feu et à la suspension des frappes aériennes en cours.