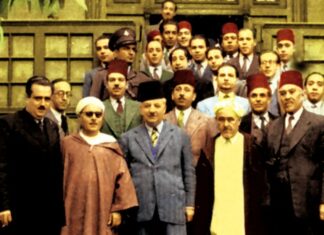La Syrie, portée par la réhabilitation de son nouveau président Ahmad el-Chareh, s’affiche à Washington dans une volte-face aussi spectaculaire que fragile. Cette mutation géopolitique interroge : quels lendemains pour la région, et jusqu’où ira le retour de l’ingérence syrienne au Liban ?
On aurait pu croire le destin syrien condamné à l’enfermement, marqué à jamais par la dictature, la guerre et la relégation dans les marges du monde civilisé. Pourtant, en ce mois de novembre, un frisson inattendu parcourt la scène internationale. Ahmad el-Chareh, figure controversée, mais désormais centrale, foule le tapis discret de la Maison-Blanche. Pas de protocole solennel, nul drapeau, à peine quelques flashs : la scène est feutrée, presque clandestine, à l’image du cheminement sinueux d’un pays qui cherche sa place, entre le chaos d’hier et l’énigme de demain.
Il y a dans cette visite, loin du faste réservé aux chefs d’État, une gravité et une ambiguïté qui disent tout du nouveau visage syrien : celui d’un régime en quête de respectabilité, mais lesté d’un passé encombrant et d’alliances réversibles. L’histoire retiendra peut-être que c’est sans tambours ni trompettes qu’Ahmad el-Chareh, naguère sur la liste noire américaine, s’est vu offrir une consécration tacite. Le chef d’un État brisé par la guerre, jadis incarnation même de la dissidence radicale, devenu l’interlocuteur du moment pour un Donald Trump plus pragmatique que jamais, soucieux de solder le dossier syrien sans autre considération que l’efficacité contre l’ennemi djihadiste.
Le divorce consommé avec l’État islamique
La scène pourrait prêter à l’ironie si elle n’était pas si tragiquement révélatrice des flux et reflux de la realpolitik. Il y a un an à peine, le nom d’Ahmad el-Chareh – plus connu sous l’alias d’Abou Mohammad al-Jolani – était synonyme de radicalité, de lutte armée, d’insoumission aux dogmes de l’ordre occidental. Reconverti, « réhabilité », il s’érige aujourd’hui en rempart contre l’hydre djihadiste qu’il a lui-même contribué à façonner, puis à combattre.
L’ironie de l’histoire, c’est qu’en traçant sa propre rupture avec l’État islamique (EI), el-Chareh n’a fait que prolonger la trajectoire tourmentée de la Syrie, où chaque allégeance est toujours provisoire, chaque ennemi d’hier un partenaire possible. La recomposition s’est jouée dans la clandestinité, puis dans la lumière crue de la guerre civile : Jabhat al-Nosra, matrice syrienne d’al-Qaïda, a vu son étoile pâlir, laminée par la surenchère de violence de l’EI. Dès lors, il a fallu choisir – la fidélité à la cause globale, ou le pragmatisme local.
La création de Hayat Tahrir al-Cham (HTC), regroupement de factions longtemps rivales, marque la volonté de « syrianiser » la lutte : en finir avec le salafisme globalisé pour embrasser la realpolitik locale. Jolani, devenu el-Chareh, change de peau et de discours. Il liquidera sans états d’âme les affidés de Daech, promettra aux Occidentaux la stabilité, négociera à voix basse avec les Turcs, puis, ultime volte-face, entamera ce dialogue avec Washington qui, naguère, aurait semblé impensable.
Une réhabilitation orchestrée, mais précaire
Le symbole est d’autant plus fort que l’effacement de l’ancien paria n’a rien d’un acte isolé. En quelques semaines, la Syrie se débarrasse de ses attributs d’État-voyou : sortie de la liste noire américaine, levée des sanctions de l’ONU à l’initiative de Washington, et promesse de coopération dans la lutte anti-djihadiste. Le ballet diplomatique, méthodique, s’orchestre dans le silence des cabinets, loin des tribunes, mais avec une efficacité implacable.
Ce nouveau chapitre s’ouvre dans un climat de prudence extrême. À Washington, le ministre syrien des Affaires étrangères assure que cette visite « illustre le réchauffement des relations » avec l’Amérique. Mais tout est pesé, codifié. Ahmad el-Chareh n’est pas accueilli à la porte principale, les journalistes sont tenus à l’écart, le communiqué final expédié dans la pénombre. Ce n’est pas un triomphe, c’est un sursis. Une mise à l’épreuve.
Le président Trump, dans un style qui lui est propre, salue le « très bon travail » du chef syrien, se félicite de cette conversion tactique : « C’est un gars dur », dit-il, « je me suis très bien entendu avec lui ». La phrase résonne comme une épitaphe à la cohérence : le Moyen-Orient n’est plus le terrain de la morale, mais celui de la géométrie variable, de l’alliance du moment, du marchandage diplomatique. Les sources consultées par Reuters et The Washington Institute abondent dans ce sens : la coopération Syrie–États-Unis, naguère inconcevable, se fait désormais sur le dos des vieux dogmes. Le souci n’est plus l’origine des acteurs, mais leur capacité à juguler la menace immédiate.
Les métamorphoses de la loyauté
Ce qui se joue ici, c’est la capacité d’un régime à réinventer ses fidélités, à vendre la paix qu’il n’a su ni imposer ni conserver. En Syrie, tout est affaire de survie, de glissements successifs. Il n’y a plus de place pour les certitudes ; seul compte le maintien du pouvoir, fût-ce au prix de toutes les conversions idéologiques. Ahmad el-Chareh, qui a traversé la guerre sous toutes ses bannières, en est la figure parfaite – tour à tour djihadiste, chef de guerre, puis partenaire de l’Occident.
En se désolidarisant de l’EI, en neutralisant les cellules radicales sur son territoire (61 raids, 71 arrestations selon al-Ikhbariya), en fermant les bureaux du Hamas et du Jihad islamique, en acceptant l’aide humanitaire onusienne, le nouveau président façonne la figure de l’homme de la transition. Un Janus aux deux visages, rassurant pour les chancelleries, mais porteur d’un passé qui ne s’efface pas d’un trait.
La recomposition n’est pas sans zones d’ombre. Si l’on en croit Navar Şaban, chercheur au Harmoon Center, « il est clair qu’Ahmad el-Chareh n’incarne plus la ligne dure jihadiste qu’il avait adoptée dans ses jeunes années ». Mais la rupture est-elle réelle, ou s’agit-il d’un habillage ? Le doute persiste, entretenu par la plasticité même des alliances et la volatilité des engagements dans cette région où la mémoire courte n’est jamais un défaut diplomatique.
Du côté américain, la logique est toute d’opportunisme. L’administration Trump, fatiguée des équations insolubles du Proche-Orient, cherche à solder la page syrienne en s’assurant que le nouveau régime ne servira plus de base arrière au djihad global. Les gages fournis par Damas sont suffisants, pour l’instant, pour entériner le rapprochement. Les entretiens ont lieu loin des caméras, les sanctions sont levées avec parcimonie, et l’exigence principale demeure : que la Syrie tienne la promesse de sécurité sur son territoire.
On se rassure à Washington : « La rencontre est aussi le vrai nouveau chapitre dans la politique régionale de la Syrie », observe Tim Lise, analyste au New York Times Institute for National Security. Mais nul n’ignore que les lignes restent mouvantes. En Orient, la paix est toujours conditionnelle, jamais définitive.
La tentation du retour au Liban
À mesure que la Syrie se réinsère dans le jeu international, un autre front s’ouvre à l’ombre du Levant : celui du Liban, éternel miroir des ambitions syriennes. Ici, la mémoire est moins courte. L’histoire des années d’occupation, des manipulations politiques, des alliances changeantes, hante encore les rues de Beyrouth et les couloirs du pouvoir.
Les rumeurs d’un retour de l’ingérence syrienne n’ont jamais vraiment cessé. Depuis la normalisation progressive de Damas, elles s’intensifient. Plusieurs diplomates occidentaux s’en inquiètent. Selon un diplomate cité par L’Orient-Le Jour, le nouveau régime syrien pourrait reprendre en main certaines affaires internes libanaises : sécurité, contrôle des armes, orientation des grandes décisions de guerre et de paix.
Le Liban, exténué par la crise, affaibli par les divisions, ne semble plus en mesure de s’opposer efficacement à une telle mainmise. Les gouvernements occidentaux, eux, oscillent entre la lassitude stratégique et l’attente d’un réveil local. La France, en particulier, s’accroche à l’idée d’une souveraineté libanaise qui, pour l’heure, semble plus théorique que réelle.
On le voit : l’attention du monde, longtemps braquée sur la tragédie syrienne, se détourne peu à peu. Ni Trump ni Macron n’en attendent plus de bénéfices politiques immédiats. Suivre le Liban, c’est aujourd’hui se confronter à une routine épuisante, faite de paroles sans lendemain, de réformes différées, de promesses toujours recommencées.
La dynamique nouvelle qui s’esquisse pourrait bien voir la Syrie revenir, sinon par la force, du moins par la pression diplomatique, économique et sécuritaire. L’histoire n’est pas avare d’ironie : le régime d’Ahmad el-Chareh, qui se rêve en pivot du nouvel ordre régional, retrouve dans le Liban la tentation d’une influence jamais vraiment éteinte. Un « deal » se prépare peut-être, à l’ombre de la Maison-Blanche : retour de la stabilité contre résignation à une ingérence syrienne revisitée.
Au bout de cette traversée, il reste un sentiment d’étrange fatalité. La Syrie change de masque, mais l’essence du pouvoir demeure. La réhabilitation d’Ahmad el-Chareh signe l’adaptation d’un régime à la loi mouvante du plus fort, l’amnistie offerte à condition de renoncer à l’utopie révolutionnaire. La paix, comme toujours, n’est qu’un sursis. Et sur les rives du Liban, l’histoire continue de se chercher entre l’ombre portée de Damas et le rêve obstiné d’indépendance.