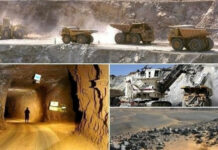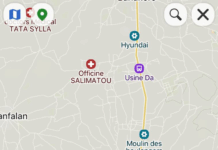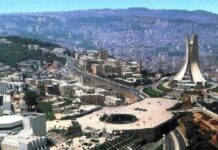Le programme connu sous le nom de Gospel (Habsora) traitait des images satellites, des flux de drones et des données de renseignement pour générer des listes de frappes. Un autre système, Lavender, exploitait les métadonnées téléphoniques et les réseaux sociaux afin de classifier des dizaines de milliers d’hommes palestiniens comme combattants présumés, malgré des taux d’erreur élevés reconnus.
Plus significatif encore, Israël utilisait des outils de surveillance téléphonique et de reconnaissance d’images capables d’estimer en temps réel le nombre de personnes présentes dans un bâtiment — réparties entre hommes, femmes et enfants — avant d’autoriser une frappe. Ces outils fournissaient aux commandants militaires un inventaire précis des civils à chaque étape. Ce n’était pas une situation marquée par l’incertitude ; la présence civile était évaluée par des algorithmes et archivée dans des bases de données.
Ces systèmes ne fonctionnaient pas de manière autonome. Des enquêtes menées en 2024–2025 ont révélé que l’infrastructure cloud Azure de Microsoft hébergeait une grande partie des données de surveillance et des processus analytiques qui alimentaient le système de ciblage israélien. L’unité 8200, l’agence israélienne d’élite en matière de renseignement électromagnétique, utilisait Azure pour stocker et traiter des communications palestiniennes interceptées ainsi que des images servant de base aux systèmes Gospel et Lavender. Microsoft n’a pas fourni d’armes, mais l’entreprise a offert l’infrastructure informatique permettant au système de surveillance et de ciblage de fonctionner à grande échelle.
Face aux critiques croissantes, Microsoft a discrètement limité certains de ses prestation aux services de renseignement israéliens, reconnaissant ainsi implicitement les risques juridiques et réputationnels encourus. Selon le droit international, les entreprises peuvent être tenues responsables de complicité de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité si elles fournissent sciemment une assistance facilitant la commission de ces actes.
Des précédents historiques, allant des procès du Zyklon B aux affaires contemporaines liées aux technologies de surveillance, montrent que les fournisseurs d’infrastructures ne sont pas à l’abri d’un examen judiciaire lorsque leurs services contribuent à des crimes internationaux.