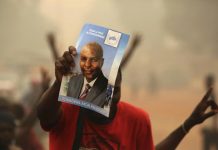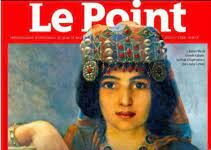Donald Trump a créé la surprise en annonçant des discussions « directes » samedi avec l’Iran sur son programme nucléaire, après avoir menacé le pays de bombardement. D’abord réticent, Téhéran s’est résolu à des pourparlers mais via un intermédiaire.
Ahmad PARHIZI et Sébastien RICCI de l’AFP
La priorité pour Téhéran est d’obtenir une levée des sanctions qui étranglent son économie. Après 20 mois d’âpres négociations, l’Iran avait conclu en 2015 un accord avec les grandes puissances dont les États-Unis pour encadrer ses activités nucléaires. Le texte prévoyait en contrepartie le retour en Iran des investissements occidentaux. Il avait nourri chez les Iraniens un immense espoir de voir leur pays sortir de l’isolement et d’importantes perspectives pour l’économie.
Mais en 2018, Donald Trump a retiré son pays de l’accord et rétabli de lourdes sanctions, dont l’économie iranienne ne s’est jamais remise. Selon le taux de change informel, la valeur du rial face au dollar a depuis été divisée par sept, alimentant une hyperinflation et du chômage qui paupérisent la population.
« Si l’Iran parvient à briser les chaînes des sanctions, il pourra atteindre une croissance économique considérable », l’universitaire Fayyaz Zahed, un expert des relations internationales.
Outre ses réserves d’hydrocarbures parmi les plus importantes au monde, l’Iran est un immense marché en devenir de 86 millions d’habitants, avec une population jeune (âge moyen de 32 ans) et éduquée.
L’axe chiite mis à mal
L’Iran apparaît fragilisé depuis l’attaque du 7-Octobre du Hamas contre Israël. Au Liban, le Hezbollah, soutenu militairement par Téhéran, est sorti très affaibli d’une guerre contre Israël en soutien aux Palestiniens.
En Syrie, le pouvoir de son allié Bachar el-Assad a été renversé, tandis qu’au Yémen les rebelles Houthis ont subi des bombardements américains récemment. « L’Iran ne dispose (plus) d’aucune carte efficace et subit les conséquences » des bouleversements dans la région, estime Fayyaz Zahed, en référence à « l’axe de la résistance ».
Cette alliance informelle de groupes armés qui s’opposent à Israël a longtemps été considérée par le pouvoir iranien comme un bouclier.Des frappes israéliennes contre l’Iran au mois d’octobre, en représailles à des tirs de missiles, ont montré les limites de cette stratégie.
En quète d’une stratégie
« L’Iran est prêt à accepter les mêmes conditions techniques » que l’accord de 2015, estime M. Zahed.Téhéran défend un droit au nucléaire à des fins civiles, en particulier pour l’énergie afin de diversifier ses sources d’approvisionnement. Les Occidentaux soupçonnent l’Iran de développer le nucléaire pour se doter de la bombe, ce que Téhéran conteste vigoureusement. « En revanche, le pays ne fera preuve d’aucune flexibilité pour ses missiles », prévient l’expert.
En 2018, le retrait de Donald Trump de l’accord avait notamment été motivé par l’absence de mesures contre le programme balistique, perçu comme une menace par Washington et son allié israélien.
En février, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a appelé à « ne pas négocier » avec l’administration Trump, justifiant sa position par « l’expérience », selon lui, d’accords passés avec des dirigeants américains mais non tenus.
La carotte et le baton
En mars, Donald Trump a appelé dans une lettre les dirigeants iraniens à des pourparlers. Mais il a aussi menacé de bombarder leur pays en cas d’échec de la diplomatie.Téhéran a assuré qu’il ne négocierait pas sous la pression. L’annonce par le président américain de pourparlers samedi à Oman a semblé prendre de court la diplomatie iranienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a dû confirmer en pleine nuit sur X la tenue d’un tel entretien.
Selon le site d’information américain Axios, Donald Trump a donné deux mois à l’Iran pour aboutir à un nouveau « deal ».
Donald Trump « a rompu une fois » l’accord sur le nucléaire, souligne le réformiste Hossein Nouraninejad dans le quotidien gouvernemental Iran, et « il existe de nombreux différends historiques entre les deux pays », qui n’ont plus de relations diplomatiques depuis 1980.
Des discussions directes prochaines entre MM. Trump et Khamenei semblent toutefois « plus probables qu’une guerre », juge dans les colonnes du journal Etemad Ali Shakourirad, un homme politique proche du président iranien Massoud Pezeshkian.
P