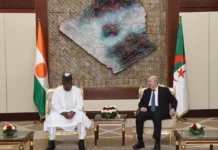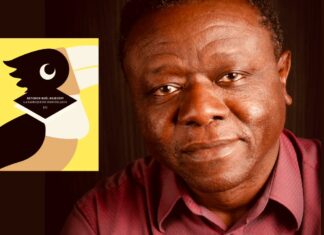Les frappes ciblées menées par Israël au Liban le vendredi 28 mars, notamment l’élimination d’un haut cadre du Hezbollah, relancent le spectre d’une guerre ouverte. Tandis que les tensions internes s’exacerbent, la perspective d’une désescalade s’éloigne dangereusement.
Vendredi 28 mars 2025, l’armée israélienne a mené une frappe aérienne sur la banlieue sud de Beyrouth, quelques heures seulement après avoir averti les habitants de la zone ciblée. Cette opération, bien que précédée d’une communication inhabituelle visant à limiter les pertes civiles, marque un tournant dans la stratégie israélienne. En rendant publique son intention de frapper, Israël cherchait moins à surprendre qu’à adresser un message politique et militaire clair au Hezbollah: l’impunité de la trêve tacite a atteint ses limites.
« Nous ne permettrons plus que notre territoire soit attaqué sans riposte. Chaque provocation aura une conséquence », avait déclaré un haut responsable israélien peu avant les frappes. Cette démonstration de force, aussi calibrée soit-elle, a cependant fragilisé le fragile statu quo qui prévalait depuis le cessez-le-feu de novembre dernier. Si les frappes ont ciblé des entrepôts d’armement selon Israël, pour le Hezbollah, il s’agit d’un acte de guerre, que ni les avertissements préalables ni le contexte sécuritaire tendu ne justifient.
Cette opération survient dans un moment de grande fébrilité, où les tirs de roquettes non revendiqués se sont multipliés depuis le sud du Liban vers le nord d’Israël, jetant le trouble sur les intentions réelles des parties. Ces actes de provocation non signés pourraient signaler l’existence de groupes dissidents, ou plus vraisemblablement une stratégie du Hezbollah consistant à maintenir la pression sans s’impliquer officiellement. Ce flou tactique, qu’Israël lit comme une duplicité, explique en partie le durcissement de sa posture militaire.
Hezbollah, l’élimination ciblée
La frappe du 1er avril n’a laissé aucun doute sur ses intentions. Menée à 4h30 du matin sans avertissement préalable, elle visait une cible unique et stratégique : Hassan Bdeir, responsable du dossier palestinien au sein du Hezbollah. Ce dernier, selon les renseignements israéliens, coordonnait des opérations avec le Hamas depuis le début de la guerre à Gaza, et était soupçonné d’avoir planifié des attaques conjointes contre des civils israéliens.
En ciblant une figure aussi centrale, Israël franchit un nouveau seuil. L’élimination de Bdeir n’est pas seulement une opération de « décapitation » militaire. Elle frappe au cœur de la coopération tactique entre le Hezbollah et les factions palestiniennes armées. « Ce n’est pas une frappe de représailles, c’est une liquidation stratégique », résume un analyste militaire. L’effet dissuasif recherché est manifeste : affaiblir le maillage opérationnel entre le Liban et Gaza, et faire payer au Hezbollah son implication, même indirecte, dans le conflit.
Pour le Hezbollah, cette frappe constitue une déclaration de guerre. Officiellement, le parti chiite n’a pas encore répondu militairement, mais les déclarations de ses responsables trahissent un changement de ton. « Le sang de nos martyrs ne sera pas versé en vain », a déclaré l’un des députés du Hezbollah, ajoutant que « l’ennemi devra s’attendre à une réponse au moment et à l’endroit que nous choisirons ». Le silence tactique de l’organisation pourrait annoncer une riposte différée mais déterminée.
Crise interne au Liban
Alors que les tensions régionales s’intensifient, le Liban vacille. La pression monte sur le gouvernement et l’armée libanaise, accusés par le Hezbollah de ne rien faire pour empêcher les frappes israéliennes. Le président Aoun a publiquement condamné les incursions israéliennes, les qualifiant de « violations intolérables de la souveraineté nationale ». Mais au-delà des mots, l’État libanais apparaît impuissant. Il ne contrôle ni les décisions du Hezbollah ni le territoire où celui-ci opère. Ce déséquilibre institutionnel accentue les divisions internes.
Le Hezbollah, quant à lui, semble de plus en plus contraint par la logique du rapport de force. Conserver son arsenal, maintenir sa stature régionale, défendre sa base électorale : ces objectifs passent désormais avant tout. Un retour à la guerre serait certes destructeur pour le Liban, mais moins coûteux pour le Hezbollah qu’un désarmement perçu comme une capitulation.
Cette dynamique rappelle ce qui se joue à Gaza, où une frange grandissante de la population exprime sa colère contre le Hamas, accusé d’avoir précipité la guerre sans stratégie de sortie. Un renversement d’opinion similaire serait souhaitable au Liban si les hostilités s’intensifient, mais il reste pour l’heure illusoire tant le Hezbollah demeure solidement implanté. Les appels à la désescalade lancés par la société civile libanaise peinent à trouver un écho dans un paysage politique verrouillé.
La possibilité d’une guerre totale entre Israël et le Hezbollah n’est plus théorique. Chaque attaque, chaque riposte, repousse un peu plus les lignes rouges autrefois tacitement respectées. Israël semble désormais déterminé à briser l’équilibre ambivalent dans lequel le Hezbollah prospérait : un pied dans la résistance armée, un autre dans la politique nationale.
Dans ce contexte explosif, les décisions militaires se doublent d’une guerre des discours. Tandis qu’Israël martèle que « la sécurité de ses citoyens prime sur toute autre considération », les responsables du Hezbollah insistent sur leur « droit légitime à la résistance face à l’agression ». Deux logiques irréconciliables qui nourrissent un engrenage de plus en plus incontrôlable.
Trêve avec le Hamas, guerre avec le Hezbollah ?
Paradoxalement, alors que la tension monte à la frontière nord d’Israël, des signes de désescalade apparaissent à Gaza. Israël a récemment proposé une trêve longue en échange de la libération d’une partie des otages détenus par le Hamas. Selon les termes de cette offre, Israël suspendrait ses opérations pendant 40 à 50 jours contre la remise de douze otages vivants et la restitution des corps de dix-huit autres. Le Hamas libérerait également plusieurs otages présumés morts, en échange de centaines de prisonniers palestiniens.
Le Hamas a accueilli cette offre avec prudence, acceptant le principe d’une trêve, mais refusant toute remise en cause de son arsenal militaire. « Notre capacité de défense n’est pas négociable », a déclaré l’un de ses porte-parole. Cette réponse souligne la priorité du Hamas : survivre politiquement et militairement, même au prix d’un compromis temporaire.
Cette dissociation entre les fronts sud et nord d’Israël soulève une inquiétude stratégique majeure : un apaisement à Gaza pourrait paradoxalement libérer les moyens israéliens pour intensifier les opérations contre le Hezbollah. Le scénario d’un transfert du cœur du conflit de Gaza vers le Liban devient de plus en plus probable.
Pour le Hezbollah, une telle évolution serait périlleuse. S’il engage une guerre à grande échelle avec Israël, il met en péril non seulement ses infrastructures militaires, mais aussi sa légitimité politique au Liban. En même temps, ne pas réagir serait perçu comme une faiblesse. C’est ce dilemme stratégique qui rend la situation actuelle si explosive : les marges de manœuvre se réduisent, les options diplomatiques s’épuisent, et les logiques de survie l’emportent sur celles de la négociation.
L’élimination de Hassan Bdeir, précédée d’une frappe annoncée puis suivie d’un silence stratégique du Hezbollah, semble constituer le point de bascule d’une guerre rampante. Derrière les démonstrations de force et les discours martiaux, c’est l’équilibre fragile d’un Liban exsangue qui vacille. Le Hezbollah se trouve acculé à une décision cruciale : la guerre, ou la perte progressive de son influence stratégique. Israël, de son côté, semble prêt à en finir avec la menace du front nord, quitte à ouvrir un nouveau chapitre sanglant. Dans ce contexte, les appels à la désescalade apparaissent dérisoires.