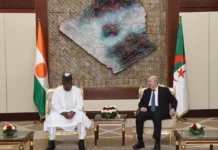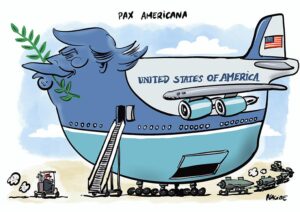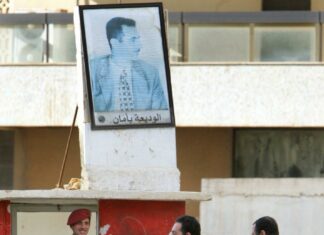L’ascension de Donald Trump est souvent décrite comme une aberration, une perturbation survenue au sein d’un système jusque-là stable. Mais la réalité profonde est plus structurelle : Trump est apparu à la fois comme le symptôme et l’accélérateur d’un malaise qui couvait depuis longtemps, nourri par des fractures entremêlées qui ont remodelé la société américaine au cours des deux dernières décennies.
Une chronique de Malek Baroudji (Beyrouth)
Les États-Unis ne traversent pas une crise politique unique mais une série de guerres civiles froides parallèles — genrées, économiques, générationnelles, idéologiques, ethniques et informationnelles — qui se renforcent mutuellement. Le centre ne parvient plus à médiatiser ces contradictions ; il ne fait que les refléter.
Trump se situe au croisement de ces forces. Son succès n’a pas créé la fragmentation du Parti républicain ni l’érosion de la coalition démocrate ; il les a révélées. Sa politique a instrumentalisé les inégalités, l’anxiété et le ressentiment. Sa rhétorique n’a pas causé la polarisation ; elle lui a donné un langage. À ce titre, le trumpisme est à la fois le produit de ces fissures et le véhicule par lequel elles se sont élargies.
Le genre, la première fracture
La fracture la plus déstabilisante est peut-être celle du genre. La société américaine connaît un profond rééquilibrage des rôles : les femmes dépassent lentement les hommes dans l’enseignement supérieur, l’avancement professionnel et la visibilité culturelle, tandis que les hommes font face à une baisse des salaires, à la contraction de leurs rôles économiques et à un sentiment diffus de déclassement. Ce qui avait commencé comme une évolution inégale des opportunités s’est transformé en clivage politique. L’essor de l’autonomie féminine — en particulier sur la reproduction et la structure familiale — a déclenché une réaction masculine marquée par un conservatisme transitoire, une religiosité accrue et une quête d’identités d’ancrage. Ce retour des hommes vers la religion, en particulier parmi ceux qui se sentent économiquement ou culturellement marginalisés, constitue un courant sous-jacent rarement reconnu mais politiquement déterminant. Les attaques ciblées de Trump contre des journalistes ou adversaires politiques féminines relèvent de cette dynamique : non pas seulement de la misogynie, mais une démonstration de réassurance patriarcale destinée à une base masculine déstabilisée par un ordre social en mutation.
En 2016, nombre de ces hommes restaient silencieux face à leurs partenaires et aux sondeurs — ces mêmes sondeurs qui se sont trompés en ne détectant pas la dissimulation masculine. En 2024, le silence s’est brisé ; la fracture est devenue visible.
Parallèlement au conflit de genre se déploie la fracture des inégalités. Les États-Unis fonctionnent aujourd’hui selon trois réalités économiques superposées : la concentration de richesse à la Piketty ; une classe moyenne en contraction glissant vers les « démunis » ; et un fossé croissant entre le travail productif et les gains financiarisés. L’inégalité est à la fois l’origine du malaise, le fondement du populisme et l’accélérateur de chaque conflit culturel. Elle engendre un ressentiment vers le haut, une méfiance horizontale et une anxiété économique constante vers le bas.
Une guerre de génération
L’effondrement du consensus économique libéral après les guerres quasi-ruineuses en Irak, en Afghanistan et en Syrie — ainsi que la crise financière de 2008 — a détruit le récit d’une prospérité partagée. Le système s’est révélé extractif, et les citoyens interprètent désormais chaque événement politique — y compris l’ascension de Trump — à travers ce prisme.
La fracture économique s’étend à une guerre générationelle. Les jeunes Américains rejettent non seulement l’ordre économique, mais aussi les prémisses morales et stratégiques héritées de la guerre froide. La Génération Z se montre sceptique face au rôle policier mondial des États-Unis, désillusionnée par la captation du système par les groupes d’intérêts, et lassée de guerres interminables — des sentiments amplifiés par le débat sur Gaza. Les Américains plus âgés, en revanche, continuent de voir l’engagement international selon la grammaire de la primauté, de la stabilité et de la dissuasion. Ce qui relevait autrefois d’un débat interne est devenu la confrontation de deux récits nationaux incompatibles.
Ces fractures convergent dans le « fer à cheval » idéologique qui rapproche désormais l’extrême gauche et la droite populiste. L’une comme l’autre partage une méfiance envers les guerres étrangères, les élites financiarisées et un establishment perçu comme irresponsable. L’épuisement du centre libéral — incapable de convaincre, réformer ou même articuler un projet cohérent — pousse de nombreux Américains vers les marges, où le discours anti-élite devient un langage commun. Ce n’est pas une clarification idéologique mais une convergence par désillusion.
La coalition républicaine elle-même est fracturée entre le populisme MAGA et le conservatisme évangélique traditionnel — une alliance fragile aggravée par la posture transactionnelle de Trump vis-à-vis d’Israël. L’impulsion nationaliste de MAGA entre de plus en plus en collision avec le courant MIGA (« Make Israel Great Again »), qui n’accepte aucun écart par rapport à un alignement total sur les priorités israéliennes ou les engagements prolongés en Ukraine. Deux économies morales s’affrontent au sein même de la droite : l’une ancrée dans les griefs domestiques, l’autre dans des fidélités théologiques ou géopolitiques. Ce conflit porte sur l’identité, le pouvoir et l’autorité doctrinale
L’effondrement idéologique des démocrates.
La coalition démocrate n’est pas moins divisée. La fracture interne oppose des mouvements moralistes — anti-impérialistes, anticoloniaux, inspirés par Mamdani — à un establishment vieillissant associé au libéralisme gestionnaire, aux réseaux de donateurs et aux avantages d’initiés. La lassitude à l’égard de la génération Pelosi-Schumer n’est pas uniquement générationnelle : elle traduit une perception largement répandue selon laquelle la direction du parti a profité d’un système qu’elle n’a pas su réformer, sacrifiant sa crédibilité pour une stabilité qui a fini par s’effondrer. Il en ressort un effondrement de la cohérence idéologique : le parti ne parvient plus à concilier son moralisme militant avec sa prudence institutionnelle.
À ces fractures politiques s’ajoutent des fractures sociales : anxiétés entre Blancs et non-Blancs ; isolement entre urbains et ruraux ; conflit entre élites technologiques et classe ouvrière fragilisée par l’automatisation et l’échec du rapatriement industriel ; régions ravagées par les opioïdes face à d’autres relativement épargnées ; et États bleus envisageant des formes de « sécession douce » vis-à-vis des obligations fédérales tout en continuant de subventionner les États rouges par des contributions fiscales disproportionnées. Il ne s’agit pas de tensions rhétoriques mais d’asymétries structurelles transformant les États en cultures politiques quasi distinctes.
L’immigration, autrefois moteur de dynamisme, est devenue un autre champ de bataille. La xénophobie voit désormais dans les immigrés un symbole de déclin plutôt qu’un vecteur de renouveau, confondant les symptômes avec les causes. Les deux partis se sont rapprochés du restrictionnisme, non parce que les données l’imposent, mais parce que la politique le récompense. Ce faisant, les États-Unis risquent d’étouffer ce qui a fait leur réussite : l’ouverture.
Une fracture identitaire systémique
Enfin, le pays est divisé par une guerre civile informationnelle. Le monopole de l’information s’est effondré ; les réseaux sociaux amplifient le ressentiment, accélèrent l’anxiété et dissolvent la réalité partagée. Certains membres de l’establishment estiment que des plateformes comme TikTok auraient dû être absorbées plus tôt, convaincus qu’un régime de contrôle plus strict aurait évité la fragmentation sociale.
Cela alimente un conflit plus profond entre liberté d’expression et censure, et entre classes éduquées capables de naviguer dans l’abondance informationnelle et celles submergées par elle — avec démocrates sous Biden et républicains sous Trump testant, étirant ou violant à répétition les limites constitutionnelles.
Pris ensemble, ces phénomènes relèvent moins d’une crise que d’une fracture identitaire systémique. Les États-Unis vivent une guerre civile froide multidimensionnelle. Trump n’a pas généré ces tensions, mais il les a révélées avec une clarté saisissante, avant de les exploiter. L’avenir dépend moins de la résolution d’une fracture particulière que de la compréhension du poids cumulatif de toutes. Le malaise est structurel, stratifié, profondément enraciné — et toute éventuelle reconstruction exigera une réflexion intellectuelle que la politique américaine n’a pas encore entreprise.