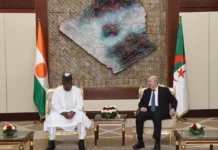La loi libanaise sur le boycott d’Israël, héritée de 1955, s’enorgueillit d’être l’une des plus inflexibles du monde arabe. Elle interdit, en bloc, toute relation – directe ou indirecte – entre Libanais et quiconque vivant en Israël ou travaillant pour ses intérêts.
Il n’existe pas de décompte public unique et officiel recouvrant toutes les condamnations prononcées au titre de l’interdiction de tout contact avec Israël (la situation judiciaire est en partie traitée par les tribunaux militaires et les communiqués de sécurité, souvent fragmentaires).
Des sources fiables indiquent 185 arrestations depuis 2019, dont 165 poursuivies (prosecutions) et 25 condamnées (données rapportées en décembre 2022). Ces chiffres proviennent d’un reportage AFP largement repris par la presse régionale et internationale.
Nicolas Beau
Prétendument conçue pour préserver la solidarité arabe, la loi s’immisce dans tous les domaines : commerce, finance, services, jusqu’au moindre échange de mails. Sa portée extraterritoriale est telle qu’un simple courrier à une société israélienne via un intermédiaire suffit à tomber sous le coup de la loi.
Le code pénal, lui, s’empresse de renforcer cette logique paranoïaque : collaboration, assistance ou transmission d’informations à « l’ennemi » sont traquées par des articles fourre-tout (278 et 285) qui servent de prétexte à toutes les poursuites, même les plus absurdes. Les peines sont lourdes, les interdictions nombreuses : il est même illégal pour un Libanais de se rendre en Israël sans le tampon d’une administration toujours prompte à soupçonner. Et pourtant, derrière la façade, la justice se révèle hésitante : preuve, intention, matérialité des faits… autan de brèches qui laissent passer l’arbitraire et l’incertitude.
Le politique, lui, ne s’embarrasse pas de ces subtilités : il s’agit d’empêcher toute « normalisation », de conjurer l’espionnage, l’infiltration, la manipulation. Derrière la sévérité, il y a surtout la mémoire d’une guerre non digérée, de contentieux sans fin, de frontières jamais apaisées.
Entre fantasme de pureté nationale, frontières mouvantes et réalité d’un monde où tout circule (sauf l’hypocrisie), la loi libanaise sur les contacts avec Israël se rêve en rempart. Mais à force de vouloir tout interdire, elle se prend dans ses propres contradictions, laissant place à un théâtre d’interdits officiels, de tolérances tacites et de contournements bien rodés. Au Liban, chacun jongle avec l’ennemi désigné : l’État brandit le texte, la société l’adapte, et la vie, elle, trouve toujours un passage.
Qu’il s’agisse d’un accord commercial, d’une discussion en ligne, d’un mariage ou d’un simple cliché partagé, chaque interaction avec « l’autre rive » révèle l’ambivalence d’un système juridique écartelé entre l’absolu de l’interdit et la ruse du réel.
Frontières poreuses, œillères d’État
Côté économie, la loi libanaise rêve de pureté : toute affaire, de l’importation à la sous-traitance, est bannie. Les douanes montent la garde, listes noires à l’appui, prêtes à épingler tout ce qui porte une trace d’Israël. Les sanctions ? Interdiction d’exercer, saisies, poursuites, fermetures : tout l’arsenal y passe.
Mais à l’ère des circuits mondiaux et des marchés dématérialisés, ce zèle n’est souvent qu’un vœu pieux. Les produits israéliens franchissent les frontières sous de fausses étiquettes, les logiciels circulent sous licence tierce, les fraudes prospèrent. Seuls les cas flagrants – saisis à l’importation – finissent par une condamnation ; le reste file entre les mailles d’une loi conçue pour un autre siècle.
La jurisprudence, elle aussi, déborde d’acrobaties : en 2000, la cour de cassation blanchit un trafiquant de tabac, estimant que la marchandise venait d’un territoire occupé par Israël, pas d’Israël : il fallait oser. Plus récemment, des multinationales sont exclues d’appels d’offres publics pour cause de filiales en Israël, mais d’autres secteurs – métaux précieux, pétrole, services numériques – échappent à toute vigilance. On frôle parfois l’absurdité : comment, dans la jungle des sociétés-écrans et des flux financiers opaques, empêcher le moindre profit de « tomber dans l’escarcelle de l’ennemi » ? La réponse officielle : contrôle renforcé dans les secteurs sensibles… mais le doute demeure, et la modernité dépasse chaque jour la vieille obsession du contrôle.
Intimité surveillée, humanité niée
Même la sphère privée, censée être le refuge ultime, n’échappe pas à la surveillance. Le moindre geste pouvant servir l’ennemi – héberger, renseigner, aider, parfois même parler – peut valoir des ennuis judiciaires. Mais la machine judiciaire, embourbée dans la nécessité de prouver l’intention de nuire, relaxe souvent les suspects : le boulanger qui vend son pain à un soldat israélien n’est pas un traître, décrète la cour, s’il ne s’agit pas d’espionnage. Le berger qui discute avec des soldats israéliens ne tombe pas sous le coup de la loi, tant que ses propos restent triviaux.
Le mariage entre Libanais et Israéliens, officiellement non interdit, vire au casse-tête politique dès qu’il s’agit d’enregistrement administratif. Rares, mais éloquents, ces cas montrent un appareil d’État obligé de reconnaître, parfois à contrecœur, la complexité humaine derrière la rigidité de l’interdit.
La monnaie n’est pas en reste : posséder des shekels n’est pas un crime, sauf preuve d’une transaction illicite. Même la mer, théâtre de drames et de sauvetages, impose ses exceptions : un navire libanais accostant en Israël pour fuir un naufrage n’est pas puni, la solidarité internationale l’emporte sur la logique du boycott.
Sport, musique, universités : là encore, l’hypocrisie domine. Des sportifs libanais accusés de trahison pour avoir croisé des Israéliens lors de compétitions internationales ne sont jamais condamnés : la société s’indigne, la justice absout.
Libertés piégées, opinion traquée
Dans un pays où tout peut devenir politique, l’espace numérique n’offre qu’une illusion de protection. La loi du boycott, écrite pour une autre époque, ne dit rien des réseaux sociaux ou des images virales. Tant que la communication reste privée et apolitique, la sanction pénale s’éloigne… mais la société, elle, veille : un commentaire, une photo, peuvent déclencher enquête, exclusion, lynchage médiatique.
L’affaire Ziad Doueiri est devenue l’exemple parfait de cette fragilité. Cinéaste reconnu, il est arrêté à Beyrouth pour avoir tourné en Israël : son procès finit en non-lieu, mais la polémique révèle à quel point le monde artistique et intellectuel doit marcher sur des œufs.
Quant au tribunal de l’opinion, il tranche sans appel : une Miss Liban photographiée avec Miss Israël ? C’est la meute, la mise à l’écart, la menace, même si la lettre de la loi ne condamne rien. La société exige la pureté, la loi joue les équilibristes.
Musique, sport, art : tous connaissent la même logique. La justice hésite, mais l’opprobre publique, elle, ne rate jamais sa cible. L’ère numérique a démultiplié cette dynamique : chaque image peut devenir, en quelques heures, l’étendard d’un faux procès ou d’une chasse aux sorcières.
Face à la porosité des frontières virtuelles, chacun – artiste, citoyen, internaute – doit composer, dans la solitude, avec l’ombre de l’interdit. Entre la lettre d’un droit daté, l’esprit d’un boycott devenu réflexe, et le poids d’un regard social impitoyable, la marge d’erreur se rétrécit chaque jour.
Le droit libanais, imprégné de la mémoire du conflit, dessine autour de l’ennemi une frontière invisible, redoutée ou contournée selon l’époque, mais toujours fragile. Si la loi s’obstine à construire des murs, la vie, elle, s’acharne à inventer des passerelles – par nécessité, par hasard ou par simple envie de dialogue.
Dans cette zone grise, les risques sont là : sanctions pour les contacts jugés dangereux, exclusion pour des gestes mal compris. Mais la réalité, plus fluide, plus mobile, s’impose peu à peu. Les nouvelles générations, connectées et lassées des vieux tabous, osent poser la question : dans un monde ouvert, qui croit encore possible de tout contrôle ?