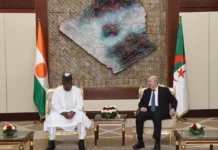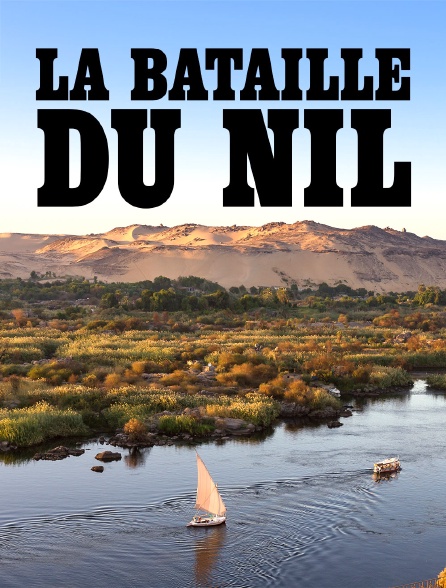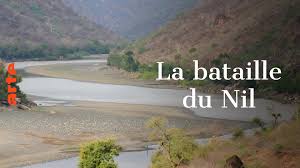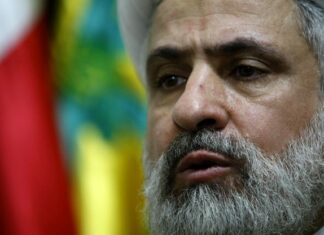« La bataille du Nil » est un documentaire au suspense haletant, signé par Sara Creta, qui entraîne le téléspectateur dans une minutieuse investigation socio-historique depuis la source du Nil jusqu’à son Delta.
Source de vie pour plus de 300 millions de personnes, le Nil est depuis toujours l’objet d’intenses luttes de pouvoir. Lorsque Nasser, au XXe siècle, fait construire le barrage d’Assouan, il s’assure un développement économique à l’Égypte au détriment de l’Éthiopie et du Soudan. Mais depuis 2013, la construction par Addis-Abeba du « barrage de la Renaissance », la plus grande digue jamais dressée sur le continent africain, empoisonne à nouveau les rapports entre les trois voisins. Une chronique de Sandra Joxe
Un documentaire de Sara Creta ,52 mn, visible sur Arte Repaly, Jusqu’au 8 / 08 / 2025

La documentariste Sara Creta récidive ! Déjà remarquée pour son beau film sur les femmes soudanaises puis, en 2021 pour son bouleversant documentaire « Libye, les centres de la honte » (sur les conditions de détention inhumaines des migrants) la journaliste propose aujourd’hui une investigation passionnante… au fil du Nil.
En conjuguant habilement des interviews pris sur le vif et sur le terrain (femmes, paysans, hommes de la rue en Ethiopie) face aux discours bien huilés de hauts responsables politiques, scientifiques ou militaires, elle offre un panorama passionnant des enjeux que soulèvent la construction du « plus grand barrage de l’Afrique » entamée depuis 2013… et toujours en rade.
Un documentaire-choc
Si le film se dévore comme un thriller bien ficelé, c’est avant tout grâce à son scénario construit avec soin… Le suspense s’accroit au fur et à mesure des découvertes : un directeur du barrage bizarrement « suicidé », des chefs rebelles qui retournent leurs vestes, des menaces militaires plus ou moins voilées, l’ingérence des émiratis de plus en plus ostensibles. Mais c’est aussi grâce à la qualité de la documentation : la réalisatrice n’a pas hésité à planter sa caméra tout au long de la vallée du Nil (depuis sa source, le Lac Danna aux confins de l’Ethiopie, terre de pauvreté et de guerres intestines – jusqu‘au très fertile delta égyptien.
On y découvre l’ampleur des enjeux sociaux-économiques, écologiques, politiques et toute les enjeux symboliques qui se nouent depuis des siècles autour de la maitrise des eaux du fleuve.
En juxtaposant ces différents points de vue : ceux des Ethiopiens, opposés à ceux des Egyptiens sans oublier les Soudanais pris en sandwich, Sara Creta offre aux spectateurs une multiplicité de points de vue qui évite tout didactisme.
Un enjeu de fierté pour l’Éthiopie

Pour l’Éthiopie, l’enjeu est économique mais aussi symbolique. Pays déshérité à peine sorti de la guerre, rongé par les luttes fratricides, parent pauvre de la vallée du Nil, le « barrage de la Renaissance » a l’ambition de bien porter son nom.
En témoigne l’engouement de la population qui voit dans ces travaux une réapropriation de leur fleuve.C’est peut-être le seul sujet qui fasse consensus au niveau national, tout le pays voit le barrage comme un symbole de résistance et le gouvernement utilise aussi cette bataille pour détourner l’attention envers d’autres questions brûlantes.
Pour les villageois éthiopiens l’intérêt des travaux peut résider dans l’accès au confort moderne : encore 65 % de la population vit sans électricité et le barrage est censé résoudre le problème – même si pour l’instant l’électricité produite depuis 2022 est vendue par le gouvernement aux pays limitrophes… pour obtenir des devises ! .
Mais c’est avant tout les grandes multinationales qui convoitent le marché : c’est ce que dévoile enfinle documentaire.
Une guerre larvée
Car le film ne s’enlise pas dans les berges du Nil : il sait prendre de la hauteur. La deuxième partie révèle les arcanes d’une guerre larvée. Tous les pays de la Corne de l’Afrique ont les yeux rivés sur le devenir de ce barrage et de la maitrise de l’eau du Nil, qui suscite plus que jamais les appétits les plus féroces.
En suivant un progression chronologique – depuis la campagne de financement pour boucler une partie du budget (6 milliards d’euros), les actions des lobbies, et les difficultés d’un chantier loin d’être achevé, en passant par les morts suspectes (celle d’un haut responsable soi-disant « suicidé » dans sa voiture à Addis-Abeba) ce documentaire palpitant poursuit son investigation bien au-delà des 3 pays directement concernés.. La guerre de l’eau se joue aussi au sein des institutions internationales (ONU, Banque mondiale…) appelées à soutenir les inquiétudes du Caire : car l’Egypte n’est pas du tout disposée à abandonner son hégémonie sur le Nil.
Une domination bien installée, qui date de la construction du barrage d’Assouan et du lac Nasser.
Derrière les antagonismes nationaux ce sont des intérêts financiers parfois occultes qui semble régir l’évolution de ce projet pharaonique – qui piétine, démarre, s’interrompt, redémarre, alimentant au passage tout un tas de réseaux de corruption locaux ou nationaux voire internationaux : et c’est le mérite de ce film que de dévoiler comment finalement, tout se joue dans la cour du capitalisme mondialisé, une fois de plus.
Pour reprendre l’adage héraclitéen : « on ne se baigne jamais dans le même fleuve ». La coexistence est impossible entre une femme de pêcheur éthiopienne (sur)vivant sans électricité, un petit paysan soudanais, un agriculteur égyptien au service d’une multinationale ou… un émirati en quête d’investissement juteux !
Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique