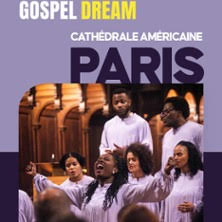Le vendredi 23 mai 2025, à 14h45, le Festival de Cannes a connu un moment d’émotion rare. Dans le cadre de la sélection Cannes Classics, la version restaurée de Chronique des années de braise (1975) y était projetée, cinquante ans jour pour jour après sa Palme d’or – la seule décernée à un cinéaste algérien, et la seule pour tout le continent africain.
Mouloud Améziane, Sociologue
Le film de Mohamed Lakhdar-Hamina retrouvait sa lumière salle Buñuel au palais des festivals de Cannes en présence son fils Malik, qui y joue l’enfant silencieux et témoin, aux côtés du rappeur et acteur Sofiane Zermani (Fianso), autre passeur de mémoire contemporaine.
Ce que personne ne savait encore, pas même Thierry Frémaux, délégué général du Festival qui a introduit le film, c’est que Mohamed Lakhdar-Hamina, âgé de 95 ans, allait s’éteindre moins d’une heure après la projection, à Alger.
Une coïncidence déchirante. Comme si le film, dans sa renaissance publique, avait rappelé à lui son créateur. Et que ce dernier, voyant son œuvre ressuscitée, transmise, saluée, pouvait enfin se retirer.
Une œuvre-monde, un film-témoin
Chronique des années de braise n’est pas un simple film historique. C’est un cri. Un poème en actes. Une fresque tragique où l’histoire d’un peuple colonisé prend chair à travers l’errance, la résistance et l’éveil. La narration se déploie en six chapitres, comme une épopée où se croisent des figures archétypales : le père martyr, l’enfant lucide, la foule aveugle, le fou-voyant – incarné par Lakhdar-Hamina lui-même – porteur d’une parole de feu.
La musique entêtante de Philippe Arthuys accompagne l’ascension tragique vers la conscience. L’image – dure, belle, minérale – capte la lumière des Hauts Plateaux autant que les ombres de l’occupation. Le film, oublié, parfois attaqué, n’a jamais été vaincu.
Sa restauration n’est pas un simple geste patrimonial : elle est une réparation, une reconnaissance politique et esthétique.
Une vie d’engagement
Né en 1930 à M’Sila, dans les Hauts Plateaux algériens, Mohamed Lakhdar-Hamina a été façonné par la violence coloniale. Son père, enlevé, torturé et tué par l’armée française pendant la guerre d’indépendance, demeure la figure souterraine de toute son œuvre. Il rejoint jeune le Gouvernement provisoire de la République algérienne à Tunis, puis est envoyé étudier à la FAMU de Prague, l’un des foyers du cinéma engagé de l’époque.
À l’indépendance, il fonde l’Office des actualités algériennes, avant de diriger l’ONCIC (Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique). Il est à la fois cinéaste, producteur, pédagogue et militant de l’image. Après Le Vent des Aurès (1966), prix de la première œuvre à Cannes, c’est Chronique des années de braise qui l’impose comme l’un des plus grands cinéastes du Tiers-Monde. Il réalisera ensuite Décembre, Vent de sable, La Dernière Image… Tous portés par la même exigence : faire du cinéma un acte de vérité.
La reconnaissance d’un maître
Si Chronique des années de braise a connu les honneurs, il a aussi subi les silences. Trop politique pour les uns, trop radical pour les autres. Il a été longtemps absent des écrans. Pourtant, son souffle ne s’est jamais éteint. Le revoir en 2025, dans une copie restaurée, devant un public bouleversé, c’est retrouver une œuvre prophétique, brûlante, toujours actuelle.
Dans la salle, ce jour-là, il n’était pas seulement question de cinéma. Mais de mémoire. D’héritage. D’un passé qui palpite dans le présent. De transmission entre les générations. Car Mohamed Lakhdar-Hamina ne filmait pas pour plaire.
Il filmait pour dire. Pour que nul n’oublie que derrière chaque liberté conquise, il y a des blessures, des silences, des morts.
Une disparition symbolique, une résurrection vivante
Que Mohamed Lakhdar-Hamina meure le jour même où son chef-d’œuvre retrouve la lumière n’est pas un hasard. C’est un signe. Le signe que certaines œuvres survivent à leur auteur, et que certains auteurs deviennent eux-mêmes des récits, des symboles, des repères.
Il n’est plus. Mais son film, lui, marche encore. Dans les pas de l’enfant orphelin, dans le regard des jeunes générations, dans les cris des peuples encore en lutte pour leur dignité.
Encadré : Biographie express
- 1930 : Naissance à M’Sila, Algérie.
- 1958 : Rejoint le GPRA à Tunis.
- 1963-1974 : Directeur de l’Office des actualités algériennes.
- 1967 : Prix de la première œuvre à Cannes pour Le Vent des Aurès.
- 1975 : Palme d’or pour Chronique des années de braise.
- 1981-1984 : Directeur de l’ONCIC.
- 2025 : Décès à Alger, le 23 mai, jour de la restauration de son film à Cannes.