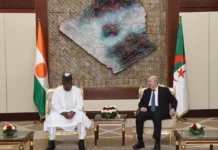La gorge d’Aube porte la cicatrice indélébile d’un massacre islamiste, symbole du silence imposé par l’Algérie sur sa propre tragédie. Kamel Daoud, dans un récit poignant et brutal, offre à travers le destin d’Aube, une voix aux victimes de la « décennie noire », englouties dans l’oubli officiel. Entre pèlerinage introspectif et réquisitoire politique, Houris déchire le voile sur la violence d’une histoire refoulée, exhumant la mémoire d’un passé qui hante encore le présent.
Une chronique de Jean Jacques Bedu
Lien à suivre
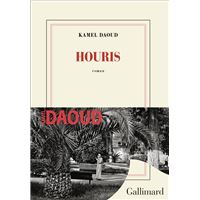
L’Algérie de la « décennie noire », période sanglante marquée par les affrontements entre groupes islamistes et armée nationale, sert de toile de fond au roman Houris de Kamel Daoud. Ce passé, enfoui sous un épais voile de silence par le pouvoir politique, ressurgit avec violence à travers le destin tragique d’Aube, enceinte, qui raconte au fœtus dont elle souhaite se débarrasser, les horreurs de cette guerre et l’impossibilité – pour une femme – de s’épanouir dans la société patriarcale algérienne. Seule et miraculeuse survivante d’un massacre islamiste à l’âge de cinq ans, Aube est privée de sa voix, condamnée à porter une canule, et marquée à jamais par une immense cicatrice sur la gorge (un « sourire » qui s’étire d’une oreille à l’autre), métaphore de la parole confisquée. Devenue coiffeuse, la jeune fille porte en elle le poids d’une mémoire collective bâillonnée, et d’une culpabilité lancinante. Elle entame alors un ultime voyage vers son village martyr, Had Chekala, le lieu où elle est morte avant de renaître, afin de confronter le passé et d’apaiser ses propres démons. En parallèle, Kamel Daoud donne voix à Aïssa Guerdi, un ancien libraire obsédé par sa propre expérience de l’horreur islamiste, qui arpente les routes en ressassant les atrocités de cette période, en cherchant désespérément à faire entendre la vérité.
Houris explore aussi la condition féminine en Algérie, mettant en lumière la violence et la misogynie infligées aux femmes, réduites au silence et privées de leurs droits. À travers la rencontre d’Aube et d’Aïssa, le roman met en lumière les blessures d’une société algérienne traumatisée, forcée de taire ses souffrances sous peine d’être accusée « d’instrumentaliser la tragédie nationale », comme le stipule la Charte pour la paix et la réconciliation nationale de 2005. Le romancier algérien dénonce cette loi d’amnistie comme un instrument d’un régime autoritaire visant à étouffer toute forme de dissidence et de vérité historique.
Troisième personnage Khadija, mère adoptive d’Aube – qui l’a recueilli après le massacre de ses parents et de sa sœur –, est une figure de résilience et de courage. Avocate de profession, elle-même abandonnée à la naissance devant une mosquée en 1962, elle consacre sa vie à Aube, faisant tout son possible pour l’aider à surmonter son traumatisme et retrouver sa voix, dut-elle se rendre en Belgique à la rencontre du plus grand spécialiste et vendre sa maison dans l’espoir d’une opération. Pour Khadija, il ne s’agit pas seulement d’aider Aube à parler à nouveau, mais aussi de lui redonner la capacité de se réapproprier son histoire et son corps. Ce combat est celui d’une mère, mais aussi d’une femme qui refuse de laisser la violence avoir le dernier mot. Elle illustre une forme de sacrifice maternel : Khadija se bat contre une société qui marginalise les vulnérables et contre les limites de la médecine, déterminée à offrir à Aube une nouvelle chance de vie. Houris, s’apparente ainsi à une joute contre l’oubli, une tentative littéraire pour exorciser les fantômes d’une guerre civile passée sous silence et empêcher qu’elle ne se reproduise.
Un récit de l’ineffable
Quel personnage incroyable nous a inventé Kamel Daoud ! Cette jeune fille algérienne de vingt-cinq ans, condamnée à être privée à la fois de voix et de bonheur, puise dans son silence et ses sacrifices la force de protéger, d’aimer, et de laisser – dès les premières pages – une empreinte indélébile sur le lecteur. Elle est porteuse d’un enfant conçu dans une union clandestine et sans lendemain, et ce fabuleux et tragique roman s’articule auteur d’un monologue entre intérieur entre Aube avec son fœtus, expliquant les raisons qui la poussent vers une décision terrible mais, à ses yeux, nécessaire. Cette introspection mêle un amour ambigu à une lucidité implacable, révélant ses craintes quant à l’avenir de son enfant, dans un pays où le poids de la honte l’entravera dès la naissance. En décrivant la société algérienne comme celle « qui n’oubliera jamais que tu es née sans père« , Aube entrevoit pour ce qu’elle imagine être sa fille (elle l’appelle « ma Houri »), un destin d’oppression et de jugement, une existence de souffrances similaires aux siennes, marquée par l’indignité et l’abandon.
Philosophiquement, ce monologue rappelle le concept de « l’amour fataliste » tel que décrit par Friedrich Nietzsche, où l’amour véritable prend conscience de ses propres limitations et se manifeste par des choix douloureux pour préserver l’autre de la souffrance. Aube incarne cette pensée en désirant ardemment protéger son enfant, même si cela signifie lui refuser la vie. Ce choix, loin d’être anodin, révèle une profondeur de sacrifice, où Aube souhaite libérer son enfant de la douleur qu’elle-même endure : « Car ici, ce n’est pas un endroit pour toi, c’est un couloir d’épines que de vivre pour une femme dans ce pays. Je te tuerai par amour et te ferai disparaître en direction du paradis et de ses arbres gigantesques ».
Cette confrontation intime avec son fœtus constitue pour Aube une ultime tentative de rédemption, une manière de mettre fin à la chaîne de souffrances qui l’a marquée. Ses réflexions oscillent entre tendresse et résignation, et elle s’accroche ainsi à une idée d’amour absolu, teinté d’une tristesse philosophique où la libération devient, paradoxalement, synonyme de non-existence.
Un miroir de l’Algérie contemporaine
Dans ce roman, l’Algérie contemporaine est dépeinte comme un espace où l’islam et le patriarcat exercent une emprise écrasante sur la vie des femmes, façonnant leurs destins à travers des normes religieuses et sociales impitoyables. Aube et d’autres personnages féminins subissent la violence d’un système qui les prive de toute autonomie, les emprisonnant dans des rôles déterminés par des hommes et par la société. Ainsi, les femmes doivent, par exemple, « enfermer leurs rêves et désirs » derrière un voile imposé par les traditions, comme l’indique Aube lorsqu’elle décrit sa mère et sa propre vie « sous le joug des interdictions des hommes« . Le poids du patriarcat est incarné dans des pratiques culturelles et religieuses strictes qui encadrent chaque aspect de la vie quotidienne. Par exemple, les rituels religieux imposent aux femmes une soumission silencieuse, voire invisible, et l’on est saisi par l’épisode où Aube décrit son expérience avec le gynécologue qui refuse de voir directement ses patientes, opérant derrière un rideau tout en ordonnant à sa femme d’effectuer les examens physiques, une mise en scène où la femme est réduite à « une ombre, un équipement de plus dans la pièce« .
Le sacrifice d’Abraham, commémoré par l’Aïd, hante également Houris d’une ombre sanglante. L’offrande animale, autrefois symbole de foi, se mue en sinistre reflet de la violence infligée aux femmes, victimes sacrifiées sur l’autel d’un patriarcat exacerbé par le fanatisme. De l’animal à l’humain, Kamel Daoud détourne le rituel de l’Aïd afin de dénoncer la barbarie d’une société où le sang versé, vidé de tout sens sacré, ne sert qu’à asseoir une domination absolue. Le cri silencieux des femmes se mêle au bêlement des agneaux sacrifiés, dans une plainte qui monte vers un ciel indifférent.
On souffre donc de voir ces femmes piégées dans cette culture où la religion légitime des comportements qui étouffent toute possibilité d’émancipation personnelle. Aube exprime ce sentiment en évoquant les prêches enflammés des imams, qui dressent un portrait idéalisé de l’Éden où les femmes, les « houris célestes », sont figées dans une éternelle docilité et soumission, tandis que les femmes « terrestres », condamnées à une vie de souffrance en Algérie, aspirent secrètement à cette forme d’évasion mythique. Ce discours religieux contribue à entretenir une jalousie masculine qui alimente les violences faites aux femmes, une jalousie que l’on retrouve dans « la rancune des mâles, les meurtres, le voile, les crachats » auxquels les femmes doivent faire face quotidiennement.
Lorsque la foi devenait terreur
Sous la plume de l’auteur, la « décennie noire » (1992-2002) prend des contours aussi implacables qu’inimaginables, dépeinte avec une violence frontale qui semble dépasser les limites du réel. Dans ce roman, les récits des survivants du massacre de Had Chekala dressent le portrait d’une nuit interminable où chaque seconde était marquée par la terreur. Les islamistes, armés de machettes, de couteaux et d’armes improvisées, passaient de maison en maison, s’introduisant dans l’intimité des familles pour les réduire en cendres. Les voisins qui tentaient de se cacher dans les caves ou de fuir par les toits étaient traqués sans pitié ; aucune cachette n’échappait à leur regard scrutateur. Dans certains foyers, les femmes furent jetées au sol, leurs corps devenant l’objet de tortures et de viols d’une brutalité sans nom. Les plus jeunes filles furent enlevées, promises à devenir les « épouses » des combattants, et disparurent sans jamais laisser de traces, effacées à jamais de la mémoire des vivants.
Les survivants de ce massacre se souviennent de cette nuit où le silence devint le cri le plus assourdissant après les dernières détonations, lorsque les tueurs quittèrent enfin le village, laissant derrière eux un paysage dévasté de corps inanimés et de maisons éventrées. Les rues étaient transformées en rivières de sang, une scène où même les plus endurcis n’auraient pu détourner le regard sans frémir. Certains survivants relatent des moments insoutenables, comme celui où des parents durent choisir lequel de leurs enfants pouvait espérer se cacher et échapper à la mort, tandis que d’autres tentaient, en vain, de protéger leurs proches de leurs propres corps.
Dans ce monde où la religion devenait une arme pour légitimer l’horreur, les femmes et les enfants étaient souvent réduits à des boucliers humains, leurs vies sacrifiées pour imposer la loi des terroristes. La foi se métamorphosait en une justification dévoyée pour la violence pure, illustrant la transformation de l’islam en une idéologie de terreur. Ceux qui survécurent à cette nuit se réveillèrent dans un village fantôme, les ruines de leurs vies éparpillées autour d’eux comme les restes d’une histoire méprisée, occultée par les autorités qui, par un silence complice, contribueront à rendre ce cauchemar indicible.
Le roman s’enfonce alors dans cette obscurité, décrivant la « décennie noire » non seulement comme une guerre civile, mais comme une époque de déshumanisation profonde. Chaque mot, chaque image, rappelle au lecteur la monstruosité des actes, tout en soulignant l’irréparable impact de ces horreurs sur les consciences. Pour les survivants, et notamment pour des êtres comme Aube et surtout Aïssa, il n’est pas question d’oublier. La mémoire de ces massacres, de ces nuits interminables, devient une forme de résistance silencieuse, une manière de faire vivre les disparus malgré les tentatives de la société d’effacer leurs traces. Dans cette œuvre, l’horreur devient un témoignage, un appel à la mémoire dans un pays qui lutte encore pour se réconcilier avec son passé. Il est impératif de distinguer l’islamisme radical de cette période, qui a engendré tant de violence, de l’islam en tant que foi et pratique spirituelle, respectueuse et pacifique, portée par des millions de croyants à travers le monde. Nonobstant, si l’œuvre dépeint avec force la violence islamiste, le lecteur doit se garder de confondre la barbarie de quelques-uns avec le message universel de l’Islam, au risque de nourrir une incompréhension profane.
Dans les derniers instants, alors qu’Aube sent le fantôme de sa sœur se fondre dans l’obscurité, une vérité poignante s’impose : survivre, c’est aussi porter les morts, les souvenirs d’un passé indélébile, et les choix inachevés. Le silence du spectre est une réponse en soi, une invitation à décider seule, à briser la chaîne des tragédies. Aube ne sait plus si elle doit fuir ce spectre ou lui céder, tout comme elle hésite entre préserver la vie de son enfant ou la libérer. Peut-être que la réponse viendra au dernier moment, dans un battement de cœur, un frémissement imperceptible. Mais pour l’instant, tout reste suspendu, entre vie et mort, entre souvenir et oubli.
Houris, d’une puissance rare, déploie une écriture poétique et viscérale qui explore la mémoire, la résilience, et le poids des liens invisibles. Kamel Daoud, à l’instar de Jonathan Littell dans Les Bienveillantes, ne recule pas devant l’horreur, plongeant le lecteur au cœur des ténèbres algériennes. Mais Houris, au-delà du carnage, est aussi une œuvre d’espoir, un chant poignant pour la résilience. Chaque page résonne d’une force rare, confirmant le talent exceptionnel d’un auteur qui mérite, sans conteste, la plus grande reconnaissance littéraire.
Kamel Daoud, Houris, Gallimard, 15/08/2024, 411 pages, 23 €