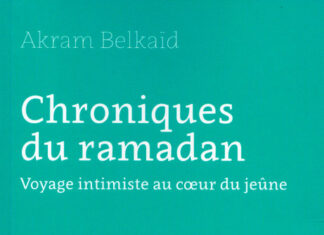Le samri[1] est l’un des arts performatifs les plus anciens et les plus importants du patrimoine saoudien, qui repose sur trois caractéristiques principales : la voix, le mouvement et l’apparat.
Victoria Kpotchie
Il est considéré comme l’une des formes d’expression poétique les plus variées, tant par ses rythmes que par les thèmes abordés dans les chants : amour, douleur de la séparation, nostalgie. Bien que les origines précises soient difficiles à dater, son enracinement historique est manifeste.
Cet art, répandu dans de nombreuses régions du Royaume, se décline en variantes locales, avec des appellations et des mélodies propres à chaque territoire[2]. Sa pratique s’accompagne de rituels codifiés : tenues spécifiques et gestes symboliques.
Le samri incarne l’unité du groupe, à travers l’union des voix, des gestes et des intentions.
Il ne s’agit pas de gestes désordonnés sans sens, mais d’un art à travers lequel la communauté met en scène sa vie intellectuelle et culturelle sous forme de représentations chorégraphiques, de veillées poétiques, et de spectacles évoquant ses coutumes et traditions.
Genèse et racines du samri
Comme tout art traditionnel, le samri est né d’un lent tissage culturel. Héritée des peuples non-sédentaires de la péninsule arabique, le samri est un véritable registre social et culturel, une poésie qui exprime les émotions collectives, retrace les événements marquants et préserve les récits transmis de génération en génération.
La poésie a nourri cet art jusqu’à ce qu’il prenne forme et maturité. Ensuite, le samri s’est approprié les rythmes poétiques : il les a modifiés, transformés, et a directement influencé la scène poétique en l’enrichissant.
Le samri serait originaire de la région du Najd et se serait diffusé dans les autres régions du Royaume.
La dynamique scénique du samri
Il s’agit d’une performance collective où deux rangées d’hommes se font face. L’une entame un vers poétique en haussant la voix, et l’autre lui répond en le répétant avec le même ton, rythme et mélodie, et ainsi de suite jusqu’au dernier vers du poème chanté :l’alignement des danseurs commence après l’appel du chef de troupe, qui entonne les premiers vers. S’ouvre alors le « wannin », phase d’introduction annonçant le début de la performance, marqué par un élan vocal initial, le “naz’a”. Plus le nazʿa est maîtrisé, plus la performance est réussie. Il doit être en harmonie avec le wannin. Dès l’ouverture du wannin, chaque participant prend place en rangée. Les percussionnistes ajustent leur tempo en fonction du chant initial. Le premier rang entonne le vers d’ouverture, que le second rang reprend en écho[3]. Par la suite, les mouvements corporels s’enchaînent. Dans tous les cas, les gestes, les balancements, les inclinaisons, les agenouillements, suivent rigoureusement le rythme musical.
Le samri d’Al-Jawf est généralement joué lors d’occasions spéciales ou de cérémonies de mariage. Deux rangées de participants se font face et tapent sur le tambourin à tour de rôle. Le poète récite les vers à voix haute et les deux rangées les répètent. Les coups de tambourin reprennent une fois que le poète a récité la seconde partie du poème, et ce schéma se poursuit jusqu’à la fin du poème.
Un art traditionnel emblématique
Présent dans de nombreux festivals culturels à travers le Royaume; du Festival national du patrimoine et de la culture Al-Jenadriyah aux concours de performances traditionnelles de Souq Okaz; le samri s’est imposé comme un emblème du patrimoine immatériel saoudien. Il incarne à la fois l’identité collective du pays et la vitalité de ses traditions vivantes.
La Fête nationale, tout comme d’autres célébrations officielles saoudiennes, accorde également au samri une place de choix, soulignant son importance dans le paysage culturel national.
Sources
Al-Badnah, L., & Al-Jumai’ah, J. (s.d.). The Samri tradition in Saudi Arabia. Al-Manwar Co. Ltd. https://www.almanwar.com/publications/the-samri-tradition-in-saudi-arabia
SaudiPedia. (2024, 2 juillet). Samri Dance. Saudipedia. https://saudipedia.com/en/article/482/culture/performing-arts/samri-dance
Baghfar, H. (1996). Les chansons populaires en Arabie saoudite. Jeddah : Dar al‑Qadisiyya.
Al-Hamdan, M. A. (1989). Le Diwan du Samri et du Hijini. Riyad : Dar Qais.
Al Abd al Mohsin, A. H. M. (1986). Le patrimoine de l’île de Tarout. Jubail, Arabie saoudite.
Sini, O. (2021, 12 mars). Entretien dans l’émission « Le Visage caché » [Émission télévisée]. Le Désert.
Ben Moghaynim, I. B. S. (s.d.). Entretien dans les émissions « La tente du désert » et « Nos archives » [Émis
[1] L’origine du terme « samri » dériverait de « samar », qui désigne les veillées au clair de lune, marquées par des échanges conviviaux et un divertissement collectif. Le chercheur Dr. Yaaqoub al-Ghunaym le définit comme un chant collectif, précisant qu’il tire son nom des veillées de groupe.
[2] le samri d’Unaizah, le samri d’al-Wadi, le samri d’al-Aarid et le samri de Haïl sont les variantes de samri les plus populaires.
[3] procédé appelé « mard ».