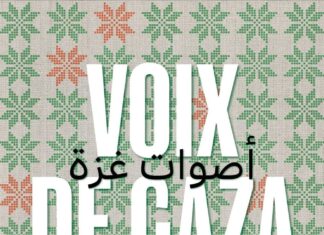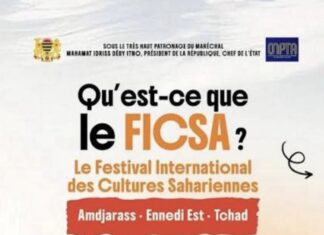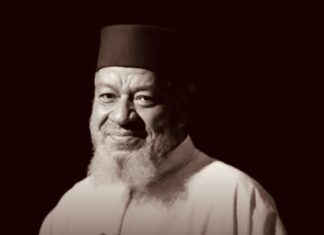Valentina Napolitano, dans son ouvrage D’une révolution à l’autre : le camp palestinien de Yarmouk en Syrie (1956-2019), dissèque ce lieu, l’ausculte, l’interroge, avec la rigueur de la chercheuse et l’empathie de celle qui a partagé le quotidien de ses habitants. Elle ne cherche pas à embellir, ni à condamner, mais à comprendre, à restituer la complexité d’une réalité qui échappe aux simplifications et aux clichés.
Jean Jacques Bedu

Yarmouk, camp de réfugiés palestiniens en Syrie, n’est pas un lieu, c’est une histoire. Une histoire faite de strates, d’accumulations, de sédimentations, où les tragédies individuelles se mêlent à la grande tragédie collective d’un peuple déraciné. Ce n’est pas simplement un espace géographique délimité par des barbelés et des check-points, mais un espace mental, un concentré de mémoire, un palimpseste où s’inscrivent les espoirs et les désillusions, les luttes et les renoncements de plusieurs générations de Palestiniens.
Ce n’est pas un récit héroïque, mais un récit humain, avec ses grandeurs et ses petitesses, ses contradictions et ses ambiguïtés. En filigrane de sa narration, l’échec d’une forme de résistance et l’émergence d’une autre, comme la promesse, vaine à ce jour, d’une nouvelle révolution. L’ouvrage de Valentina Napolitano interroge notre propre rapport à l’exil, à la mémoire, à l’engagement. Il nous tend un miroir, non pas pour nous y complaire, mais pour nous y confronter, pour nous obliger à regarder au-delà des apparences, à entendre les voix de ceux qui, trop souvent, sont réduits au silence.
De la Nakba à la Révolution
Le récit de Valentina Napolitano s’ouvre sur la Nakba de 1948, cet événement fondateur et traumatique qui a jeté sur les routes de l’exil des centaines de milliers de Palestiniens. L’auteure souligne avec justesse l’importance de cette « catastrophe », non seulement comme événement historique, mais aussi comme élément central de la mémoire collective et de l’identité palestinienne. Elle cite Constantin Zureik, intellectuel syrien, qui fut l’un des premiers à utiliser ce terme, « en référence à la création en 1948 de l’État d’Israël sur les territoires de la Palestine historique et à l’exode de près de 900 000 réfugiés dans les pays voisins. » Valentina Napolitano précise que ce terme fut ensuite réapproprié par les Palestiniens eux-mêmes. Il ne s’agit pas ici d’une question de terminologie, mais d’une lutte pour la reconnaissance d’une histoire, d’une souffrance, d’une injustice. La première génération de réfugiés, celle qui a connu la Palestine d’avant l’exil, est présentée non pas comme un groupe homogène, mais comme un ensemble d’individus aux parcours divers, confrontés à des choix difficiles et à des dilemmes moraux.
L’engagement dans les mouvements panarabes
L’ouvrage explore ensuite l’engagement de ces réfugiés dans les mouvements panarabes, qui, dans les années 1950 et 1960, représentaient un espoir de libération et d’unité. Nonobstant, l’auteure ne présente pas qu’une une vision idéalisée de cet engagement. Elle montre comment, progressivement, les Palestiniens ont pris conscience des limites et des contradictions du nationalisme arabe, et comment ils ont cherché à affirmer leur propre identité et leur propre projet politique. L’émergence de mouvements comme le Fatah, à la fin des années 1950, témoigne de cette volonté d’autodétermination. Valentina Napolitano souligne le rôle crucial joué par des figures comme Hamed, dont elle relate le parcours, qui crée en 1958 un groupe de fédayins, illustrant ainsi l’engagement précoce de certains réfugiés dans la lutte armée. L’auteur relate in extenso les propos de ce témoin clé, et notamment les conditions de l’arrestation de son groupe de fedayin : « En 1958, nous nous sommes réunis avec d’autres professeurs et nous avons créé une organisation de fédayins, l’une des premières […] ! Nous nous étions promis de mourir pour la Palestine, mais nous avons été dénoncés aux services de sécurité. » L’auteure met également en lumière la répression exercée par les autorités syriennes contre ces groupes, qui limitaient considérablement l’action de ces groupes naissants.
Parallèlement à cet engagement politique, souvent clandestin et risqué, se déploie une résistance du quotidien, une résilience culturelle qui prend des formes multiples. Une part importante de l’ouvrage est consacré à décrire cette organisation communautaire, ce tissu social dense qui fait la spécificité de Yarmouk. Les associations de femmes, les clubs sportifs, les centres culturels, les écoles de l’UNRWA, les mosquées, tous ces lieux de sociabilité contribuent à maintenir un sentiment d’appartenance, à préserver une identité palestinienne menacée par l’exil et la dispersion. L’auteure montre comment, malgré les difficultés matérielles, les restrictions imposées par les autorités syriennes, les habitants de Yarmouk ont su créer un espace de vie où l’on continue à célébrer les mariages, à commémorer les dates importantes de l’histoire palestinienne, à transmettre aux jeunes générations les valeurs et les traditions d’un peuple qui refuse de disparaître. C’est dans cette résistance du quotidien, dans cette capacité à préserver une identité collective malgré l’adversité, que réside peut-être l’une des clés de la survie des Palestiniens de Yarmouk.
La guerre de 1967 : un tournant
La guerre de 1967, ou Naksa, est analysée comme un moment de rupture qui a profondément affecté la conscience collective palestinienne et a conduit à une radicalisation de l’engagement militant. L’auteure souligne le rôle joué par le FPLP, qui émerge après la guerre, et l’attrait qu’il exerce sur une jeunesse désireuse de prendre les armes. Elle cite Omar, né en 1953, qui, tout en évoquant l’enthousiasme de l’époque : « Lorsque nous étions jeunes, nous appartenions à la cause, celle-ci était notre projet de vie, notre futur », souligne aussi la dimension presque inconsciente de cet engagement. Il ne s’agit pas d’en minimiser la sincérité, mais de montrer comment il s’inscrivait dans un contexte social et politique spécifique, où la lutte armée apparaissait comme la seule voie possible.
L’ouvrage de Valentina Napolitano aborde avec courage et lucidité la question complexe de l’implication des Palestiniens de Yarmouk dans la guerre civile syrienne. Elle montre comment le camp, initialement un espace relativement préservé, est devenu un enjeu stratégique pour les différents belligérants, entraînant sa destruction progressive et le déplacement forcé de ses habitants. La chronique insiste sur le dilemme des Palestiniens, partagés entre leur solidarité avec le peuple syrien et leur crainte d’être instrumentalisés. L’extrait de l’article de Majed Kayyali illustre bien cette tension : « La situation des Palestiniens en Syrie est aggravée par l’injustice, le déni et l’indifférence de la part de celle qui est censée être leur représentante politique, l’OLP. » L’auteure met en évidence les divisions internes au sein de la communauté palestinienne, entre ceux qui ont choisi de soutenir le régime, ceux qui ont rejoint l’opposition, et ceux qui ont tenté de maintenir une position de neutralité. Basela, enseignante, résume ainsi la situation : « Tout le monde avait peur que l’implication de Yarmouk soit problématique. »
Entre ruines et espoirs
Valentina Napolitano ne propose pas de conclusion triomphaliste ou misérabiliste. Elle constate la destruction de Yarmouk, la dispersion de ses habitants, mais elle souligne aussi la persistance d’une mémoire collective, d’un attachement à ce lieu qui fut bien plus qu’un simple camp de réfugiés. L’ouvrage met en lumière la capacité des Palestiniens à s’organiser, à résister, à inventer de nouvelles formes d’action, même dans les situations les plus extrêmes. La question de la transmission intergénérationnelle est abordée, avec ses défis et ses incertitudes. Les jeunes générations, nées après Oslo, sont confrontées à un contexte politique radicalement différent de celui de leurs aînés. Elles doivent composer avec la fragmentation du mouvement national palestinien, la montée de l’islam politique, la répression et l’absence de perspectives claires. « Le conflit syrien a bouleversé les différentes générations militantes qui, dans les années 2010, se côtoyaient au sein du camp de Yarmouk. », nous dit l’auteure, montrant bien l’ampleur du traumatisme. Il serait cependant erroné de conclure à un échec total et définitif de toute forme de résistance. Valentina Napolitano, à travers les parcours de vie qu’elle restitue, montre que l’engagement, s’il a pu être désorienté et fragmenté, n’a pas disparu. Il s’est transformé, réinventé, trouvant de nouvelles voies d’expression, notamment dans le domaine associatif et culturel. Les jeunes générations investissent des espaces d’action différents, privilégiant la défense des droits des réfugiés, l’éducation, la préservation de la mémoire, plutôt que la lutte armée stricto sensu. Cette « mise en sommeil » n’est pas synonyme de renoncement, mais plutôt d’adaptation à un contexte où les formes traditionnelles de mobilisation sont devenues inopérantes ou trop dangereuses.
D’une révolution à l’autre est un ouvrage essentiel pour comprendre l’histoire complexe et douloureuse des Palestiniens de Yarmouk. Valentina Napolitano, grâce à une approche rigoureuse et sensible, nous donne les clés pour saisir les enjeux politiques, sociaux et humains qui ont façonné ce lieu et les destins de ses habitants. Son livre est un appel à la mémoire, à la justice, et à la reconnaissance de la dignité d’un peuple qui, malgré les épreuves, continue de lutter pour ses droits et pour son avenir. Il est aussi une contribution majeure à l’étude des mouvements sociaux, des migrations forcées et des conflits contemporains.
La note du chroniqueur
L’effondrement du régime de Bachar al-Assad – qui n’était pas connu par Valentina Napolitano – ouvre un chapitre inédit pour le camp de Yarmouk. Les scénarios oscillent entre l’espoir d’une renaissance et la crainte d’un chaos prolongé. Dans le meilleur des cas, la fin de la dictature permettrait aux Palestiniens de Yarmouk de rentrer chez eux (mais où ?) en plus grand nombre, de reconstruire progressivement leur « paradis » perdu, et de retrouver une place légitime dans une Syrie apaisée. Ce scénario optimiste impliquerait une stabilité politique relative, le soutien d’acteurs internationaux, et la volonté du nouveau pouvoir de réparer les torts subis par ce camp martyre. Toutefois, de nombreuses incertitudes pèsent : la nature du régime qui succéderait à Assad, sa capacité à maintenir la sécurité, l’ampleur de l’aide internationale, ou encore les calculs géopolitiques des puissances régionales. Chacun de ces facteurs influencera directement la destinée de Yarmouk. Au-delà des spéculations, une chose demeure sûre : la résilience des habitants de Yarmouk. Ces derniers, qu’ils vivent encore parmi les gravats ou en exil, ont prouvé par le passé leur attachement indéfectible à ce lieu. Ils espèrent le meilleur quant à leur relation avec les futurs dirigeants de la Syrie et restent déterminés à revoir Yarmouk tel qu’il était autrefois, malgré toutes les épreuves. Le sort de Yarmouk sera ainsi un indicateur poignant de la capacité de la Syrie post-conflit à tourner la page de la guerre tout en incluant l’ensemble de ses communautés dans la reconstruction nationale, y compris les plus vulnérables.