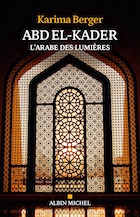Karima Berger qui nous livre son Abd el-Kader, l’Arabe des Lumières nous offre une traversée initiatique à rebours du temps, un cheminement labyrinthique au cœur d’une âme complexe et paradoxale. À travers les résistances héroïques, les prisons silencieuses, les illuminations mystiques et les extinctions progressives, l’auteure tisse une narration dense, subtilement orchestrée, alternant le récit biographique proprement dit avec des analyses approfondies qui viennent éclairer, telle une lanterne magique, les zones d’ombre de cet itinéraire singulier.
Jean Jacques Bedu
Dès les premières pages, le lecteur est happé par cette voix narrative omnisciente, empathique sans jamais verser dans l’hagiographie béate, académique, et sans jamais sacrifier la sensibilité littéraire. Cette voix nous guide avec assurance à travers le dédale de l’existence de l’Émir, nous invitant à déchiffrer, sous le vernis des événements historiques, les courants profonds qui agitent cet homme, tiraillé entre deux mondes, deux époques, deux aspirations – la lutte politique et l’élévation spirituelle.
Les années d’apprentissage : entre érudition et innocence
La progression chronologique adoptée par Karima Berger se déploie en spirale, revenant sans cesse aux moments fondateurs, aux figures tutélaires qui ont façonné l’être d’Abd el-Kader. Dès l’enfance, le texte nous immerge dans un univers où se côtoient la rigueur de l’éducation princière et la douceur maternelle, l’apprentissage du Coran et les joutes équestres. L’auteure dépeint avec minutie les premiers temps de l’Émir, soulignant l’importance capitale de Lalla Zohra, sa mère, femme de lettres et d’esprit, qui imprègne l’âme de son fils du goût de l’étude et de la « douce fruition » du Coran. L’évocation de Médéa, ville natale, berceau d’une culture ancestrale et raffinée, ancre le récit dans un espace géographique précis, un terroir nourricier où s’enracinent les valeurs qui guideront l’Émir tout au long de sa vie.
En filigrane de cette éducation profane, se dessine une autre trame, plus secrète et plus profonde : celle de l’initiation soufie, vécue dès le berceau au sein de la confrérie Qâdiriyya. Plus qu’un simple apprentissage religieux, cette initiation représente pour le jeune Abd el-Kader une véritable plongée dans le cœur battant de la mystique islamique, une école de l’âme où se cultivent l’intériorité, la contemplation silencieuse, le désir ardent de la rencontre divine. C’est dans ce « creuset familial et culturel », imprégné des rites ancestraux et des enseignements ésotériques de la Qâdiriyya, que s’éveillent ses premières intuitions mystiques, que se façonne son regard singulier sur le monde, déjà traversé par les prémices d’une « conscience humaine oublieuse de sa réalité intérieure », pour reprendre les mots mêmes de l’ouvrage. L’ordre Qâdiriyya, sous l’égide paternelle, devient pour l’enfant le laboratoire de l’âme, un espace sacré où expérimenter, dans l’innocence de l’âge, les premiers frémissements d’une quête spirituelle qui le hantera sa vie entière. Cette initiation soufie devient la matrice profonde de sa pensée, le cadre de référence essentiel à partir duquel il construira sa vision du monde, sa quête de l’Unité divine, son dialogue incessant avec l’Invisible. C’est ce terreau spirituel originel que Karima Berger explore avec une sensibilité particulière, soulignant combien il a façonné, dès l’innocence de l’enfance, l’âme complexe et ardente d’Abd el-Kader, cet homme des « Lumières » dont le rayonnement ne cessera d’illuminer son siècle et les siècles à venir.
Le guerrier face à l’altérité
La narration s’emballe lorsque le récit aborde l’entrée en scène de l’Émir sur la scène politique et militaire. L’alternance entre narration biographique et analyses approfondies atteint alors son point culminant. Le lecteur est plongé au cœur des batailles épiques, des alliances fragiles, des trahisons amères, des années de lutte acharnée contre l’envahisseur français. Mais Karima Berger – en sus de retracer les péripéties de la résistance algérienne – décrypte avec finesse la psychologie de l’Émir, cet homme d’État malgré lui, confronté à une tâche immense, presque surhumaine.
C’est dans le feu de l’action, au milieu des « chevaux écumants, de bruits de sabots bondissants, de courses effrénées… », que se révèle la complexité de la figure d’Abd el-Kader. Guerrier impitoyable, stratège hors pair, il n’en demeure pas moins un homme de foi, constamment guidé par sa conscience spirituelle et son sens aigu de la justice. Loin de la coutumière opposition manichéenne entre Orient et Occident, le récit explore les paradoxes de la rencontre coloniale, les ambivalences d’une France à la fois « héritière des Lumières » et porteuse d’une violence destructrice. L’auteur ne cherche pas à juger, mais à comprendre, à saisir les ressorts intimes qui ont animé l’action de l’Émir, ce « dialogue » incessant entre la lutte politique et la quête spirituelle.
Prisons et illuminations
Les années de prison, loin de briser l’Émir, vont au contraire le révéler à lui-même dans toute sa profondeur. « Résistances, Prisons, Illuminations, Extinctions », ces quatre étapes du parcours d’Abd el-Kader deviennent les matrices d’une introspection intense, d’une « expérience unique dans l’histoire musulmane confrontée à l’altérité ». Dans le silence des geôles françaises, l’Émir se tourne vers les sources vives de sa spiritualité, méditant les textes sacrés, composant des poèmes d’une ferveur mystique bouleversante. C’est dans cette prison d’Amboise, devenue un espace de liberté intérieure, que s’opère la métamorphose, la « conversion » profonde de l’Émir. La description des lieux de captivité – le fort Lamargue, le château d’Amboise – devient alors un véritable théâtre de l’âme, un décor à la fois austère et propice à l’éclosion de la vie intérieure.
Les longs paragraphes denses, les phrases complexes et sinueuses, épousent le rythme lent et méditatif de la prison, ce temps suspendu de l’épreuve. L’auteure explore avec une empathie vibrante les sentiments de l’Émir, ses doutes, ses interrogations, ses moments d’illumination. Elle intègre avec bonheur des extraits de l’œuvre d’Abd el-Kader, ces haltes claires et opaques, qui témoignent de la richesse et de la profondeur de sa pensée. Le vocabulaire se fait plus soutenu, plus abstrait, empruntant aux termes spécifiques de la mystique soufie pour rendre compte de cette « intime trahison » du temps qui passe, de cette « bénédiction silencieuse » qui émane de la parole de l’Émir.
Un livre essentiel, qui donne envie de plonger dans l’œuvre d’Abd el-Kader, de découvrir la richesse et la profondeur de sa pensée, de se laisser éclairer par la « lumière » qui émane de son parcours singulier et exemplaire.
La méprise maçonnique : un frère étranger au Temple
Au sein du riche et ample récit que Karima Berger déploie dans Abd el-Kader, l’Arabe des Lumières, l’épisode de la franc-maçonnerie surgit comme un îlot de paradoxe, une zone d’ombre éclairante qui révèle, par contraste, les singularités de la pensée de l’Émir, son rapport complexe à la modernité occidentale, et les méandres de sa quête spirituelle. Certains y voient la preuve d’un athéisme latent ou d’une compromission avec les valeurs occidentales, Karima Berger déconstruit patiemment les « gorges chaudes » qui ont fleuri autour de cette adhésion éphémère, pour en extraire une lecture plus fine, plus nuancée, plus fidèle à la complexité de la figure d’Abd el-Kader.
En effet, l’adhésion de l’Émir à la loge Henri IV à Alexandrie, en 1864, s’inscrit dans un contexte précis : celui de l’exil damascène, loin des combats algériens, dans un temps de méditation et de repli sur soi. Libéré des prisons françaises, accueilli en héros par la société parisienne, Abd el-Kader a eu le temps de mesurer l’étendue de la puissance occidentale, son avance technique, son rayonnement intellectuel. Pour celui qui a si longtemps combattu « l’envahisseur », la franc-maçonnerie apparaît alors comme une porte d’entrée privilégiée vers cet « Occident » à la fois fascinant et redouté. Dans cette perspective, la démarche de l’Émir se révèle moins comme une adhésion sincère aux idéaux maçonniques, que comme une exploration, une tentative de dialogue avec un monde qui lui demeure en partie étranger. L’invitation pressante des francs-maçons, flattés de compter parmi leurs rangs une figure aussi prestigieuse, aussi auréolée d’un « parfum de présence », trouve un écho dans la curiosité intellectuelle de l’Émir, son désir de comprendre les ressorts cachés de cette « civilisation » qui le fascine et l’inquiète à la fois. Le franc-maçonnerie est captatrice de mythes, nous le savons, et Mozart en est le plus flagrant exemple. Les francs-maçons voient donc en Abd el-Kader un « futur apôtre de la grande religion humanitaire en Orient », projettent sur lui leurs propres idéaux de fraternité universelle, de tolérance, de progrès. Dans les loges parisiennes, on célèbre « le coin entré dans le roc de la barbarie », on imagine l’Émir brandissant « le drapeau de la tolérance » sur les « plus hautes mosquées ». L’adhésion d’Abd el-Kader, perçue comme un triomphe idéologique, devient l’emblème d’une possible conciliation entre Orient et Occident, d’une convergence des valeurs spirituelles et humanistes.
Or, c’est là que réside la méprise. Abd el-Kader, loin de se laisser enrôler dans une vision occidentalo-centrée de la franc-maçonnerie, entend subvertir cette logique, la retourner à son avantage. Il perçoit dans la franc-maçonnerie non pas une doctrine athée ou matérialiste, mais une « voie » supplémentaire pour explorer « l’infinie réalité des croyances », une nouvelle « loge » (pour reprendre sa propre expression) où poursuivre sa quête spirituelle, son désir de comprendre « l’unité des Livres révélés ». Pour lui, la franc-maçonnerie n’est pas tant une organisation politique ou sociale qu’un espace de dialogue, de confrontation des idées, un « chantier » où éprouver la pertinence de sa propre vision du monde.
La rencontre entre Abd el-Kader et la franc-maçonnerie, dans la lecture subtile et nuancée qu’en propose Karima Berger, se révèle ainsi comme une profonde méprise, un dialogue de sourds. Les francs-maçons, fascinés par l’aura de l’Émir, par sa figure charismatique et sa réputation de sage, voient en lui un allié, un instrument au service de leurs propres ambitions, de leur projet de « régénération sociale de toute la race arabe ». Ils ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, la singularité de sa démarche, la profondeur de sa foi, la radicalité de son engagement spirituel. (Notons qu’ils sont toujours dans la même logique, en se targuant – aujourd’hui encore – d’avoir compté l’Émir en leur sein…)
Abd el-Kader, de son côté, souscrit à l’invitation, participe aux rituels, répond aux questionnaires initiatiques avec talent et intelligence, mais il le fait en conservant intacte sa propre vision du monde, sa foi musulmane, sa conviction profonde de la primauté de la quête divine sur toute autre considération. Il n’entend pas se convertir à la franc-maçonnerie, mais plutôt la convertir à sa propre vision, utiliser cette nouvelle « voie » pour éclairer, pour enrichir sa propre compréhension de « l’unité des Livres révélés ».
La « lune de miel » est de courte durée. Lorsque Abd el-Kader prend conscience du fossé qui le sépare des francs-maçons, lorsqu’il comprend que leur projet n’est pas le sien, que leur vision de la « fraternité universelle » butte sur des limites et des contradictions insurmontables, il se retire avec la même fermeté et la même dignité qu’il avait montrées lors de sa reddition face à l’armée française. L’épisode de la franc-maçonnerie se referme ainsi sur une déception réciproque, un rendez-vous manqué, une « autre occasion semble perdue », pour reprendre les mots mélancoliques de Karima Berger. Il reste de cette rencontre éphémère – et c’est là tout l’intérêt de cet épisode – le témoignage d’une tentative de dialogue interculturel et interreligieux audacieuse, mais vouée à l’échec, éclairant en creux la difficulté, voire l’impossibilité, d’une véritable compréhension mutuelle entre Orient et Occident, entre le monde de la foi et celui de la raison, entre la quête spirituelle et les ambitions politiques et sociales. Un éclairage précieux, et douloureux, sur les malentendus qui persistent, aujourd’hui encore, à la lisière des mondes.
Extinctions et héritage : le souffle d’une présence
La dernière partie de l’ouvrage, intitulée Extinctions, aborde avec pudeur et délicatesse le crépuscule de la vie de l’Émir à Damas. Le ton devient plus grave, plus mélancolique, le rythme plus lent et méditatif. L’auteure évoque les derniers combats, les dernières épreuves, mais aussi l’apaisement progressif, la sérénité conquise au fil des ans. L’analyse se fait plus réflexive, plus universelle, interrogeant la place d’Abd el-Kader dans l’histoire, son héritage spirituel et politique. « Abd el-Kader est la genèse de mon pays, il en est aussi la promesse », écrit Karima Berger, soulignant ainsi la portée contemporaine de son message, sa capacité à éclairer les défis de notre temps : « retrouver les sources vives qui ont animé la vie d’Abd el-Kader et le rétablir, dans l’intégralité de son destin, c’est la tâche que l’Histoire exige de nous ».
L’ouvrage se referme sur une méditation poignante sur la présence, sur le « parfum » de l’Émir qui continue de se diffuser, « dans ses manifestations, dans leur résonance ici, là, maintenant. Sentir sa présence. » La dernière citation de Rûmi, « Lorsqu’un homme meurt, dit Rûmi, on dit : “Il s’est tu”, on n’entendra plus le rossignol mais il restera la rose », sonne comme un écho lointain, une promesse de lumière au cœur des ténèbres. Karima Berger nous offre ainsi, avec Abd el-Kader, l’Arabe des Lumières, un véritable « livre de vie » ; un livre qui, à son tour, invite le lecteur à une traversée intérieure, à une exploration des « régions les plus lointaines de sa propre âme », pour reprendre la belle formule de l’ouvrage. Un livre, enfin, qui nous laisse entrevoir, à travers la figure fascinante d’Abd el-Kader, la possibilité d’un dialogue fécond entre les cultures capable d’éclairer notre monde en quête de repères et marqué par les conflits et les divisions. En résumé, un livre essentiel, qui donne envie de plonger dans l’œuvre d’Abd el-Kader, de découvrir la richesse et la profondeur de sa pensée, de se laisser éclairer par la « lumière » qui émane de son parcours singulier et exemplaire.