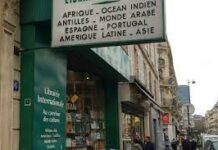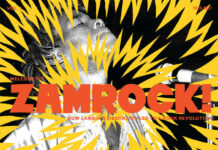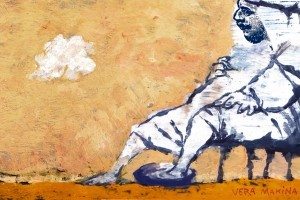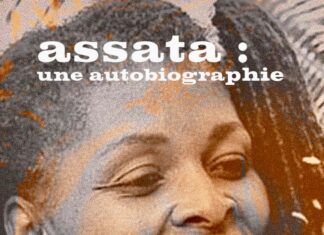Retenus par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Gsim) depuis leur disparition le 23 septembre à Sanankoraba, village sis à 40 kilomètres de la capitale, deux citoyens émiratis et leur collaborateur iranien viennent de recouvrer la liberté sains et saufs, après des négociations intenses et un accord qui suscite un torrent de réactions. Revenus à Bamako le 30 octobre 2025, au départ de Gao, leur retour marque la fin d’une épreuve assez insolite, si l’on considère les circonstances du rapt.
Les contingences suspectes du dénouement révèlent, outre le choc initial, le contexte de précarité et de non-droit où l’Afrique s’enfonce, malade de sa gouvernance. Les pays concernés – Mali, Émirats arabes unis, Iran – et la communauté internationale ont l’obligation solidaire de répondre aux questions de l’heure :
- Comment une telle prise d’otages parvint-elle à se produire, si près du cœur d’un gouvernement reconnu et se conclure selon les termes même du brigandage ?
- Pourquoi les auteurs disposaient-ils de données précises sur la cible, au point de demander, dès leur intrusion à l’intérieur de la ferme de Cheikh Ahmed bin Maktoum bin Joumoua al Maktoum, membre de la famille princière de Dubaï? 
Les interrogations justifient une prospection de qualité, qui situera les niveaux de connivence, entre les ravisseurs, les sécurocraties maliens et quelques familles du bourg de Tilemsi au nord du Mali – à la fois sous-traitants du kidnapping et marchandeurs de rançons, en somme pyromanes et extincteurs. La préoccupation s’avère d’autant moins contournable que l’économie de la proie humaine génère un gisement quasi-inépuisable d’enrichissement rapide que les Nations unies échouent à défaire. Les précédents sont légion et il aura fallu la délocalisation du rallye Paris-Dakar en 2008, pour prendre conscience d’une criminalité très rentable, à mi-chemin du trafic des personnes et de la dissuasion diplomatique.
Mafia des sables
Le rôle ambigu de certains médiateurs, propulsés en sauveurs des cas d’urgence convoque la suspicion légitime. Mohamed Mehri, dit « Rougi », et Sid’A Ahmed, alias « Zmeylou » comptent au nombre des rares intrigants de la sous-région, à disposer, en raison de leur entregent auprès services des Emirats arabes unis, du Mali et d’autres pays de l’arc-saharo-sahélien, d’un accès préférentiel à l’exercice discrétionnaire du pouvoir d’Etat. Ils détenaient la faculté de connaître la présence et les déplacements des trois victimes. Leurs attaches de parenté et connexions parallèles aux professionnels locaux du jihad, alimentent un microclimat du secret, souvent empreint de transactions poudreuses. Ici, le déroulement des faits autorise le soupçon du double jeu. Il importe de souligner que Rougi, le compère de Zmeylou, est le cousin de Houssein Ould Hamada, dirigeant du Gsim autour de Gao. S’ajoute, au trio, Abou Hamza al-Shinghitti, autre meneur de katiba. Quoique militants de camps opposés, leur loyauté de dernier ressort s’enracine dans les liens indissolubles de la Assabiyah, l’esprit de corps tribal qu’avait tôt décelé et théorisé Ibn Khaldun, le long de ses fameux prolégomènes.
Tous les quatre, de la tribu Lemhar de Tilemsi, à la lisière de la frontière algéro-nigérienne, ont été mêlés à la genèse du rapt puis à l’issue de l’arrangement. La rumeur, en l’occurrence invérifiable, leur impute un concours aux préparatifs de la rapine du 23 septembre. L’article de Mondafrique en date du 4 octobre détaille les circonstances présumées d’un tour de passe-passe digne de la prestidigitation. Aujourd’hui, il est bien établi que Iyad ag Ghaly a piloté le cours des pourparlers et pesé sur la décision, sans jamais désavouer le quatuor de Tilemsi par qui commence et se clôt l’escamotage juteux.
La tentative de la Mauritanie a tourné court. Les autorités voulaient recourir à l’expérience riche de Ahmed ag Bibi, ancien député de la région de Kidal qui n’appartient à une fraction armée et cultive des rapports cordiaux avec la majorité des acteurs de la crise au Mali. Notable Touareg des Ifoghas de l’extrême nord – d’ailleurs au même titre que Iyad ag Ghaly – il se trouvait en Algérie, pour y soigner son père, alité. A contrario des conjectures de la semaine, Mondafrique atteste, sources fiables à l’appui, que sa disponibilité aux instances de Nouakchott fit défaut. Il demeura en dehors du dossier.
Répartition inéquitable
La libération des otages a été obtenue en contrepartie de concessions de taille, dont une rançon à donner le tournis, sans doute la plus onéreuse du genre. D’aucuns évoquent, au bas mot, 50 millions d’euros, de dizaines de tonnes (de 20 à 40) de munitions acheminées, par transport terrestre, à partir du Tchad, en plus de l’échange d’environ 75 combattants du Gsim, contre 61 militaires du Mali. Les premiers ont été effectivement relâchés, à l’inverse des seconds car l’insurrection islamiste attend de récupérer 65 autres de ses éléments encore prisonniers. Or, la plupart seraient morts en détention. Il appert, des antécédents du début du siècle au Sahara-Sahel, que le montant de 50 millions comprend la rétribution des ravisseurs, la commission des facilitateurs et le défrayement des décideurs de l’Etat profond. Le partage ne tient d’une mesure déterminée à l’avance. Il arrive que les partenaires se flouent allègrement, en toute réciprocité, à l’instant de fixer la quote-part de chacun.
Hormis la spéculation sur l’argent et les armes, le troc inédit dévoile, d’emblée, le déséquilibre du partage aux dépens de la seule entité capable de réaliser une opération aussi intrépide, à proximité de Bamako. La Katiba Macina, principale composante du Gsim sera pourtant tenue à l’écart du tripatouillage, malgré l’implication manifeste de ses combattants. Le second dindon de la farce – il y en a deux – risque d’être la redoutable fédération des Emirats arabes unis, ainsi grugée à la faveur d’une tortueuse manipulation. Les mauvaises langues du Sahel supputent une rétrocommission au Général Modibo Koné, chef de l’Agence nationale de la sécurité d’Etat (Anse), service de renseignement et police politique, auquel la junte doit le prix de sa longévité. Le duo Rougi et Zmeylou, certes lié par le sang aux leaders du Gsim à l’entour de Gao, figurerait, également, parmi les informateurs attitrés de Bamako. Cependant, il est sûr que le pouvoir n’a pas contribué au rapt, n’en déplaise à l’esprit conspiratif de la barbouzerie sans frontières. Que des caciques, au sein de la junte, aient tiré profit du règlement final, relève du domaine de la probabilité. Le panier à crabes malien n’en est pas à une pince près.
Une faille dans l’ordre mondial
Les personnages au centre de l’intrigue semblent incontournables, comme le rappellent les archives du Comité des sanctions de l’Onu. Accusés de participation au trafic de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud, de complicité ponctuelle avec le terrorisme, ils fourniraient, suivant les besoins et l’offre du client, logistique, trajets sécurisés et indications de première main, brouillant alors les frontières du crime organisé, de la rébellion et du jihad.
Chaque année, ils écument les showrooms de Dubaï pour acquérir les derniers modèles de véhicules de luxe – 4×4 blindés, SUV haut de gamme – qu’ils s’empressent de redistribuer aux officiers des services et politiciens, jusque dans les pays voisins, à la périphérie immédiate des Chefs d’Etat. Les « cadeaux » traversent les frontières et scellent des alliances tacites à l’échelle de la sous-région. Les donateurs s’assurent des passages francs et étouffent, dans l’œuf, les velléités d’investigation. A l’entrée des territoires limitrophes du Mali, ils atterrissent en VIP, tapis rouge déroulé grâce aux soins d’officines parfois proches des présidents mais loin des regards indiscrets. Le parcours sulfureux de Rougi et Zmeylou témoigne d’une défaite morale du multilatéralisme.
La toile de corruption systémique mine la capacité des États sahéliens à contrer la délinquance ordinaire et le terrorisme. Elle ne se réduit à un bruit de salon ni à un filon d’anecdotes. Les chiffres du flux ininterrompu de la drogue explosent, d’une année à la suivante. De 2023 à 2025, leur taux de croissance atteint 30%. Certes, les volontaires du jihad ne recourent aux revenus du commerce ou du transit des stupéfiants mais ils ferment les yeux sur la vénalité d’acteurs susceptibles de concourir à la réalisation du Califat.
L’enquête internationale qui ne verra pas le jour
Face à l’ampleur du rançonnement et à la densité de ses zones d’ombre, la communauté des nations – ou plutôt ce qui en subsiste – ne saurait éluder les conséquences de son devoir de prévention. L’enjeu dépasse la quête de la vérité ultime à la germination de l’acte. Il concerne, davantage, la sûreté collective au-delà de l’Afrique de l’Ouest.
La démarche comporte un effet, double : Il s’agit, d’abord, de rompre le sentiment d’impunité qui entretient la tentation de la dérive, ensuite de décourager la repousse de l’entreprise, en asséchant, à la source, ses circuits d’espionnage, de financement et de logistique. Là, résident la restauration de la confiance entre États et l’avenir de la protection des ressortissants étrangers. Il presse d’envoyer, au monde, un message limpide, sous peine de banaliser, partout, la régression vers l’immémoriale loi de la jungle, vecteur de repli sur soi : Aucun enlèvement ne devrait rester à l’abri d’une pénitence exemplaire.
Mali, une rançon de 50 millions d’euros versée par les Emirats à Iyad Ag Ghali