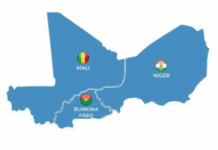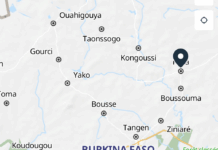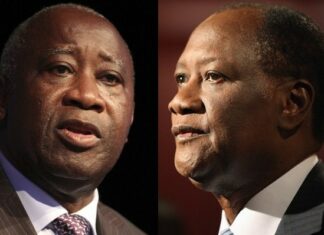L’effondrement du Liban n’est pas une fatalité. Il résulte d’un abandon progressif — celui d’un ordre constitutionnel resté inachevé et de politiques étrangères qui ont confondu improvisation et stratégie. Les États-Unis ne peuvent pas reconstruire le Liban, mais ils peuvent exiger que le Liban se reconstruise lui-même, à travers le cadre que ses propres dirigeants ont autrefois approuvé : l’Accord de Taëf et la Constitution d’après-guerre.
Depuis des années, la politique américaine envers le Liban se caractérise par la dispersion. Trop d’émissaires, trop de missions déconnectées, et aucune vision cohérente. Washington traite les symptômes — le Hezbollah, les coupures d’électricité, les réfugiés, l’anarchie — sans s’attaquer à la maladie qui les entretient : un système constitutionnel paralysé, figé dans l’inachèvement de l’Accord de Taëf.
Le Liban n’est pas une page blanche. C’est un État suspendu entre une paix inachevée et un pacte politique brisé. À moins que la diplomatie américaine ne passe d’une logique de gestion du déclin à une logique de restauration de la légalité, le pays restera un avertissement vivant : celui d’un État qui meurt faute d’ordre et de cohérence.
Le Liban compte encore

Un Liban fonctionnel sert les intérêts américains bien plus que son effondrement. Il demeure le meilleur rempart contre une nouvelle guerre Israël–Hezbollah et contre la contagion de la fragmentation régionale, qui pourrait transformer le Levant en une chaîne d’États faillis. Il prévient la résurgence de l’extrémisme et limite l’expansion de l’influence iranienne, russe et chinoise sur la Méditerranée. Il constitue enfin un test : la diplomatie américaine est-elle encore capable de construire un ordre, et non plus seulement de gérer le désordre ?
Une politique de désordre
Aujourd’hui, l’engagement américain est improvisé. Des émissaires concurrents s’expriment avec des voix discordantes, révélant une compréhension inégale de la guerre civile, du Pacte national et des réformes de Taëf qui y ont mis fin. Pendant ce temps, la classe politique libanaise — une coalition de seigneurs féodaux confessionnels — a transformé la corruption en un mécanisme de survie. Chaque faction conserve l’héritage de sa milice, garantissant la paralysie par la dissuasion mutuelle.
Les dispositions inachevées de Taëf — la décentralisation, l’indépendance de la justice et la déconfessionnalisation de la vie politique — devaient moderniser la République. Leur mise en sommeil délibérée entretient la décomposition actuelle.
Ancrer la politique par le droit
Les États-Unis doivent refonder leur politique libanaise sur les institutions et moins sur les individus. L’Accord de Taëf demeure la feuille de route inachevée vers un équilibre entre confession et citoyenneté, autorité centrale et autonomie locale. La réforme doit commencer là où la légitimité prend racine :
- L’Indépendance judiciaire. Sans justice autonome, la lutte anticorruption n’est qu’un théâtre. L’aide américaine doit privilégier des nominations transparentes et une autonomie financière totale de la magistrature.
- Le contrôle civil des forces de sécurité. L’aide militaire doit renforcer la supervision constitutionnelle. L’armée et la police doivent opérer sous direction civile, selon des règlements internes codifiés. Les ministères fonctionnent davantage par habitude que par droit. Il faut restaurer la légalité administrative. Les services publics doivent retrouver leur souveraineté. Les réseaux de générateurs et de contrebande sont des extensions du pouvoir milicien. Rendre à l’État le contrôle de l’électricité, des ports et des douanes, c’est restaurer la souveraineté.
L’économie, garantie de la sécurité
Un État en faillite ne peut ni faire respecter la loi ni monopoliser la force. La stabilisation économique n’est pas un acte de charité : c’est une exigence de sécurité. Les États-Unis devraient encourager l’Arabie saoudite et le Qatar à rouvrir leurs canaux financiers, mais sous conditions strictes, liées à des progrès mesurables. L’aide doit reconstruire les institutions de l’État directement, sans passer par des ONG qui, involontairement, les affaiblissent.
Rétablir un ordre visible — tribunaux fonctionnels, électricité régulière, police compétente — recrée à la fois la perception et la pratique de la légitimité. La souveraineté économique doit précéder la souveraineté politique : les milices s’éteignent lorsque l’État reprend les moyens de gouverner.
La maîtrise des armes sans la guerre
Certains acteurs régionaux plaident pour un désarmement coercitif du Hezbollah et des autres milices. Ce serait une erreur fatale : la guerre civile en serait la conséquence. Le désarmement doit être un processus d’intégration progressive, et non de confrontation — une absorption des groupes armés au sein d’institutions nationales légitimes, une fois que l’État aura retrouvé sa capacité et sa crédibilité.
On ne remet des armes qu’à un État qui existe vraiment. Or beaucoup de Libanais ne croient plus en son existence : il a cédé son autorité à un système féodal confessionnel. Restaurer cette autorité — par le droit, la gouvernance et la crédibilité économique — est la seule voie durable vers le monopole légitime de la force.
Ce processus doit aller de pair avec une pression américaine sur Israël pour qu’il respecte pleinement ses obligations de cessez-le-feu en vertu de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, y compris la fin des survols et le retrait des territoires libanais occupés. La souveraineté du Liban ne peut être rétablie tant que ces violations persistent.
Reconstruire la coordination avec la France et l’Europe
La France conserve une légitimité résiduelle au Liban, mais la coordination franco-américaine reste incohérente. Un cadre structuré États-Unis–France–Union européenne–pays du Golfe permettrait d’aligner l’aide, la diplomatie et la séquence des réformes. Washington et Paris devraient gérer conjointement la médiation politique, tandis que l’Union européenne financerait les programmes de gouvernance et de justice. Une approche coordonnée remplacerait la duplication par la cohér
La décadence du Liban n’est pas une fatalité. Les États-Unis ont encore la possibilité d’accompagner sa reconstruction — en privilégiant le droit plutôt que l’improvisation, les institutions plutôt que les individus, la réforme plutôt que l’assistance.
Un État libanais réformé — juridiquement indépendant, administrativement cohérent et financièrement solvable — contiendrait les milices bien plus efficacement qu’une campagne militaire. Il sécuriserait aussi les frontières d’Israël par la stabilité, non par la guerre, prouvant que la puissance américaine peut encore construire l’ordre par la légalité, et non par la force.
Le Liban reste un test de l’art du gouvernement américain. Le choix est clair : continuer à gérer la décomposition — ou permettre une réhabilitation constitutionnelle qui restaure la souveraineté et l’espérance. La fenêtre d’action est étroite, mais elle demeure ouverte.