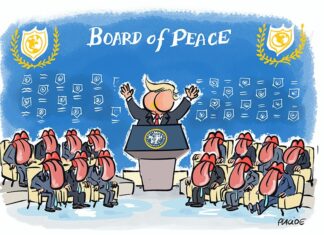Il y a, dans l’histoire des peuples, des blessures profondes qui ne cicatrisent pas facilement. Certaines sont infligées par des armes, d’autres par des mots — et parfois, on confond les deux. C’est ainsi que naît ce curieux délire : condamner une langue, non pas pour ce qu’elle est, mais pour qui l’a parlée dans un moment d’oppression.
Bachir DJAIDER, Journaliste, écrivain
L’idée paraît séduisante aux esprits en quête de revanche : « Pourquoi continuer à parler la langue de l’ennemi ? » C’est oublier que la langue n’a pas prêté serment d’allégeance à un drapeau. Une langue n’a pas de carte d’identité, pas de casier judiciaire. Elle ne choisit pas ses locuteurs ; elle traverse les siècles, indifférente aux batailles, comme un fleuve qui coule même quand ses rives s’ensanglantent.
Il est des guerres qui ne se déclarent pas avec des canons mais avec des dictionnaires. Des batailles qui se livrent non pas sur les champs de bataille, mais dans les salles de classe, sur les panneaux de signalisation ou dans les lois qui régissent la langue.
La cible ? Une langue jugée « ennemie » parce qu’elle fut parlée par l’occupant, imposée par le vainqueur ou utilisée par un régime honni. Alors, dans un élan de revanche, certains veulent l’effacer : l’interdire, la bannir de l’espace public, la reléguer au musée des langues mortes. On repeint les enseignes, on réécrit les manuels, on purifie l’air des mots importés comme on nettoie une maison infestée.
La xénophobie linguistique
Cette posture, sous couvert de patriotisme ou de « protection culturelle », porte un nom : la xénophobie linguistique. Car refuser une langue uniquement parce qu’elle appartient à l’ennemi d’hier, c’est confondre les mots avec les balles. C’est oublier qu’une langue est un outil, pas un drapeau ; qu’elle peut servir à dire la tyrannie comme à chanter la liberté.
Ironie suprême : cette haine linguistique finit par appauvrir ceux qui la pratiquent. Car chaque langue qu’on enterre, c’est une bibliothèque qu’on brûle. Et chaque mot qu’on refuse de prononcer est une idée qu’on s’interdit de penser. L’histoire regorge de peuples qui, croyant se libérer en détruisant une langue, se sont en réalité amputés d’une part de leur culture, de leur mémoire et de leur puissance d’expression
Vouloir bannir une langue au nom de l’Histoire, c’est confondre l’outil et la main qui l’a manié. Si l’on devait proscrire tout ce qu’a touché un ennemi, il faudrait brûler aussi les routes, les ponts, les livres, et pourquoi pas l’air que nous respirons, puisque l’oppresseur lui aussi l’a inspiré.
La vérité, c’est que la langue est un butin paradoxal. Ce qui fut un instrument de domination peut devenir un outil d’émancipation. Les mots du vainqueur, une fois apprivoisés, peuvent servir à le contredire, à l’interpeller, à lui opposer la force des idées. On peut s’en servir pour raconter notre version de l’Histoire, pour nommer nos douleurs, pour chanter nos victoires.
Il n’existe pas de langue coupable
Le refus d’une langue au seul motif qu’elle fut celle de l’ennemi est moins un acte de résistance qu’un aveu d’échec. C’est accepter que l’autre ait figé à jamais notre identité. C’est se priver volontairement d’une clé supplémentaire pour ouvrir les portes du monde.
On peut haïr une armée, un gouvernement, une idéologie. Mais une langue ? C’est comme haïr la pluie parce qu’un jour, elle est tombée sur un champ de bataille.
Aimer sa langue ne devrait jamais signifier haïr celle des autres. La véritable résistance culturelle, c’est la maîtrise : savoir manier plusieurs langues, comprendre l’ennemi pour mieux le désarmer, traduire son monde pour mieux le faire rayonner. Bannir une langue, c’est se condamner à l’ignorance volontaire, et l’ignorance, elle, n’a jamais libéré personne.
En vérité, les langues ne sont jamais coupables. Elles sont comme des couteaux : elles peuvent blesser ou nourrir, selon la main qui les tient. Et l’honneur, pour un peuple, n’est pas de jeter le couteau, mais de le reprendre et de s’en servir pour tailler son propre destin.
En somme, il n’existe pas de langue coupable. Seuls les hommes le sont. Les mots, eux, ne demandent qu’à être dits, compris… et partagés.