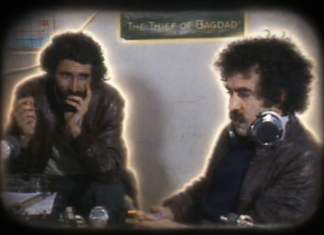Les États-Unis doivent abandonner la logique d’endiguement au profit d’un engagement stratégique avec l’Iran
Une chronique de Magali Rawan
Une guerre contre l’Iran serait un échec stratégique pour les États-Unis. Elle n’éliminerait pas les capacités nucléaires de Téhéran, ni ne renverserait le régime. Elle ne ferait que renforcer la détermination de l’Iran, déstabiliser la région et entraîner des répercussions mondiales. Une confrontation militaire irait également à l’encontre de la doctrine fondamentale de Donald Trump : mettre fin aux guerres sans fin et éviter tout engagement militaire direct — une doctrine encore influente dans les cercles républicains de la politique étrangère actuelle.
Pourtant, alors que Washington semble dériver une fois de plus vers une posture de confrontation, une ouverture diplomatique étroite mais bien réelle a discrètement émergé — une ouverture qui exige une gestion prudente, et non des postures théâtrales.
Deux pays sous pression
Cette fenêtre d’opportunité ne repose pas sur la confiance, mais sur une urgence partagée. Les deux gouvernements sont sous pression : les États-Unis, confrontés à la guerre en Ukraine, à une inflation persistante, à des tensions commerciales et à une polarisation politique croissante ; l’Iran, miné par un effondrement économique, un isolement régional et une transition du leadership déjà amorcée, sinon officiellement déclarée — aggravée par un défi démographique : une jeunesse plus laïque, aux aspirations différentes. L’incitation à dialoguer — discrètement, sans fanfare — n’a jamais été aussi forte.
Mais le simple facteur temps ne suffit pas à expliquer ce moment. Un changement structurel plus profond est à l’œuvre en Iran. Bien que non totalement inédit, des gestes significatifs et audacieux — certains émanant directement des Gardiens de la Révolution (IRGC), avec le consentement du Guide suprême — ont été transmis discrètement à l’administration Biden bien avant le 7 octobre. Ces signaux reposent sur trois constats clés :
- Le coût écrasant de près de cinq décennies d’isolement, de sanctions et de marginalisation économique mondiale ;
2. Le basculement géopolitique vers l’Est, avec la rivalité sino-américaine accélérant un réalignement global qui risque de laisser l’Iran relégué au rang de partenaire subalterne de la Chine ou de la Russie s’il ne se repositionne pas ;
3 Les revers de l’Iran sur plusieurs fronts — en Syrie, au Liban et à Gaza — après le 7 octobre, qui ont affaibli sa posture dissuasive et érodé son levier régional.
Le spectre de l’effondrement
Il existe également un calcul interne. La succession du Guide suprême étant déjà en préparation, plusieurs acteurs clés du système iranien perçoivent une réorientation diplomatique non pas comme une capitulation, mais comme une assurance contre l’effondrement. Une nouvelle génération de technocrates et d’élites militaires — incluant une jeunesse plus sécularisée et des bureaucrates réformistes — est moins motivée par l’idéologie anti-occidentale que par le pragmatisme économique. L’IRGC, de plus en plus intégré au tissu économique iranien, comprend les risques d’un statut de paria permanent. C’est une évolution, pas une révolution.
Pour les États-Unis, cette réévaluation iranienne ne doit pas être un motif de triomphalisme — c’est une opportunité. Mais toute tentative de l’exploiter par l’humiliation ou la contrainte se retournera contre ses auteurs. Une leçon tirée des précédents pourparlers est claire : le ton n’est pas un détail. Dans la psyché politique iranienne, l’humiliation publique est une ligne rouge. Une simple provocation ou une déclaration mal placée peut faire dérailler les discussions.
Les limites de l’impévisibilité
C’est pourquoi la « théorie du fou » — longtemps favorisée par Trump et ses proches, selon laquelle l’imprévisibilité projetterait la force — a atteint ses limites. Si elle a pu ramener l’Iran à la table des négociations à plusieurs reprises, elle n’est plus adaptée aujourd’hui. Le système iranien est fondé sur la résistance, la fierté nationale et la mémoire historique. Mal lire cette dynamique a déjà conduit à l’échec — et le refera.
Mais au-delà du ton, c’est le cadre stratégique lui-même qui doit évoluer. Pendant des décennies, la politique américaine a suivi une logique d’endiguement : freiner l’influence iranienne, geler son programme nucléaire, et utiliser les sanctions comme levier de pression. Ce cadre a durci la posture de Téhéran et réduit la diplomatie à un exercice défensif — une réponse à la menace, plutôt qu’un levier d’opportunité.
Vers une plus grande fléxibilité
Un accord avec l’Iran, même modeste, ne devrait plus être présenté comme une concession mais comme un investissement stratégique — un levier vers un ordre régional plus stable, un frein à l’escalade, et un moyen de protéger les intérêts américains dans un monde multipolaire. Cette logique s’aligne d’ailleurs sur la nouvelle stratégie américaine de déni, théorisée par des stratèges comme Elbridge Colby, qui vise à empêcher la Chine ou la Russie de capter des partenaires régionaux clés. Si les États-Unis peuvent neutraliser — ou mieux, réengager — l’Iran, ils priveront leurs rivaux d’un atout géopolitique essentiel.
Les avantages ne sont pas théoriques. L’Iran a déjà formulé des propositions concrètes, comme le transfert de ses stocks d’uranium enrichi sous supervision russe, sur son propre territoire ou à l’étranger. Ce ne sont pas des capitulations, mais des signes de flexibilité stratégique dans un cadre de dignité nationale. En retour, Téhéran attend des mesures tangibles : levée des sanctions sur le pétrole et les transactions financières, déblocage des avoirs gelés, reconnaissance du droit à l’enrichissement civil — autant de mesures cohérentes avec l’esprit du JCPOA.
La portée d’un accord dépasserait le seul dossier nucléaire. Une voie diplomatique parallèle pourrait discrètement aborder :
Le devenir des milices comme le Hezbollah et les Houthis ;
La stabilisation de l’Irak et de la Syrie ;
L’intégration économique progressive de l’Iran aux marchés régionaux et mondiaux.
La sécurité maritime, la lutte contre les stupéfiants et les partenariats énergétiques deviendraient également plus faisables dans un climat de désescalade. La normalisation n’a pas besoin d’être proclamée — elle doit être construite, dossier par dossier, fonction par fonction.
Ironiquement, les conditions structurelles de cette diplomatie sont plus favorables qu’il n’y paraît. L’équipe américaine de négociation est réduite — non par choix, mais à cause des blocages bureaucratiques et des retards de confirmation au Sénat. À Oman, les négociations se mènent avec discrétion et efficacité. L’Iran a adopté la même logique, en envoyant une équipe restreinte et habilitée, capable de contourner les résistances internes.
Des bruits de botte
Le principal obstacle n’est pas technique — c’est le bruit politique. À Washington, des think tanks belliqueux, des médias partisans et les dynamiques électorales chercheront à torpiller le processus. À Téhéran, les courants conservateurs religieux et les factions du Corps des Gardiens s’apprêtent à qualifier tout compromis de trahison. Cette voie ne survivra que si les deux parties renoncent à jouer pour leurs bases internes. Elle doit rester discrète, modeste, et rapide.
Car le temps n’est pas neutre. Chaque retard renforce les saboteurs. Israël et certains États du Golfe posent déjà les fondations pour discréditer ou faire échouer tout dialogue qu’ils jugent trop indulgent. Plus le processus tarde à produire des résultats, plus il devient vulnérable à des manœuvres coordonnées — par la presse, les parlements ou les canaux parallèles. Le but est clair : faire échouer la diplomatie pour forcer la confrontation.
Pour maintenir le cap diplomatique, les États-Unis devraient prendre six mesures immédiates :
Modérer la rhétorique publique. Cesser de négocier par la menace.
Limiter le cercle et protéger la confidentialité. Pas de fuites. Pas de briefings.
Construire la confiance de façon progressive. Éviter les sommets spectaculaires et les exigences maximalistes.
Anticiper les critiques internes. Préparer une défense disciplinée et cohérente de l’engagement.
Coordonner discrètement avec les alliés. Déjouer les sabotages par la transparence, non par la surprise.
Recadrer la diplomatie comme un gain stratégique. Non pas un geste d’apaisement, mais un acte de réalisme éclairé.
Ce n’est pas un moment pour les effets de manche. C’est un moment pour le réalisme sans défaitisme. L’engagement avec l’Iran ne transformera pas le Moyen-Orient du jour au lendemain. Mais il peut désamorcer la prochaine crise, retarder le prochain conflit, et ouvrir un espace pour des solutions durables.
L’alternative n’est pas le statu quo. C’est l’escalade. Et si cette opportunité est manquée, la confrontation qui s’ensuivra sera plus rapide, plus brutale — et bien plus coûteuse.
Donald Trump et l’Iran : confrontation ouverte ou accord surprise ?