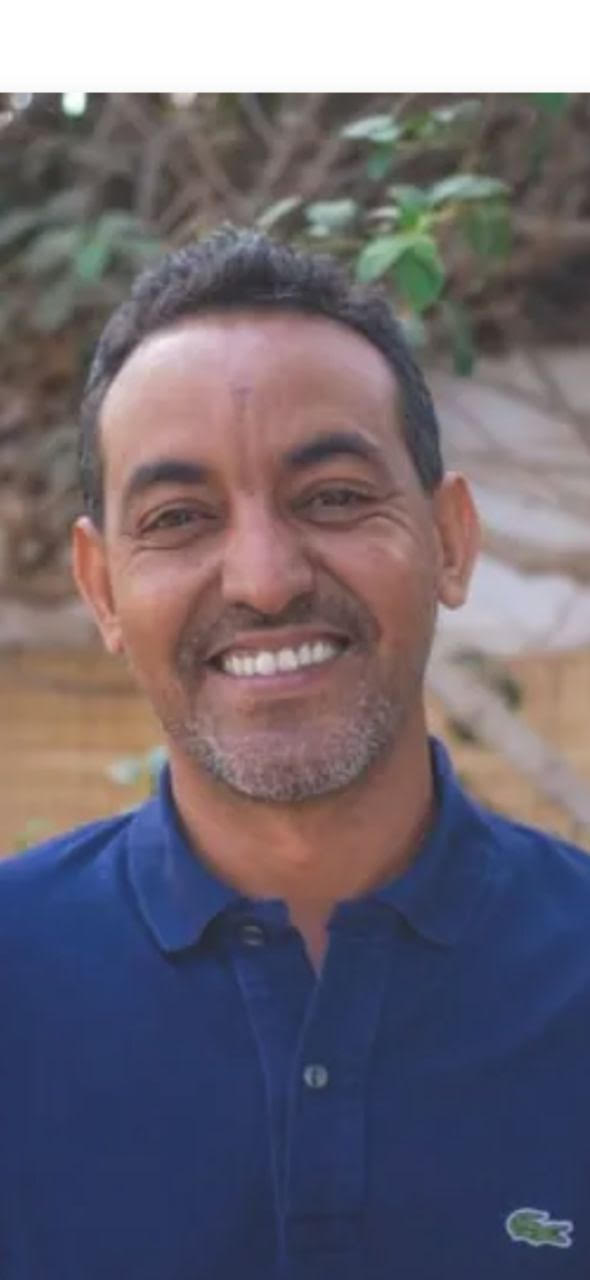Aujourd’hui, il n’y a que deux choix. Les litanies mélodieuses du soufi ou la lame sanglante de la wahhabia. Celui qui veut détruire les zawiyas doit assumer les conséquences induites. En sens inverse, malgré nos réserves sur le folklore, les gris-gris, l’intercession et la baraka, le soufisme nous rassure et protège. Nous y inclinons, guère en quête de prodiges mais par dégoût des gibets et effroi devant le spectacle des jugulaires tranchées, à vif.
Mohamed Saleck Najem, adjoint au Maire de Tevragh Zeina, commune de Nouakchott, Mauritanie
Ces dernières années, le soufisme en Mauritanie est devenu la cible de nombreuses attaques. Soudain, certains prédicateurs des jamaat aldaw’a wa altabligh, se mirent à le décrier, fustigeant une hérésie fille du polythéisme, dont les disciples ne seraient que des égarés en train de perdre leur temps à « chanter » et « danser ». Les zawiyas, écoles traditionnelles d’apprentissage du Coran, de la théologie et de l’Arabe, ne représentaient, aux yeux des adeptes de la réislamisation wahhabite, que des repaires de charlatans et de marchands d’illusions. Or, la Mauritanie n’était connue, dans le monde musulman, que grâce au rayonnement des mahadras soufies, de rite malékite. Ses écoles de spiritualité séculaire ont façonné un enseignement spécifique du droit et de la jurisprudence (fiqh), de l’éloquence et des sciences de la métaphysique. En vertu d’un tel héritage, l’espace a préservé son équilibre social pendant des siècles, sous l’aura de cheikhs, d’érudits, de poètes et de saints, sans lesquels l’extrémisme l’aurait englouti, depuis longtemps.
Soyons francs, tout de même car la lucidité n’interdit le parti-pris: Le soufisme n’est pas exempt de défauts. Il y a, dedans, de l’hermétisme à outrance, de la verticalité héréditaire et une exagération des karamate ou baraka des faiseurs de miracle. L’attirail neutralise l’autonomie de l’esprit et désarme la faculté de la critique. Malgré tout, le tassawwuf demeure, avec ses errements et travers, l’ultime ligne de défense en travers du littéralisme wahhabi. Dans le sillage de cette importation venue de la lointaine Arabie saoudite des années 1970-80, prospère et avance la terreur de la contrainte sur les corps, qui a détruit des sociétés entières, du Machrek comme au Maghreb, sans épargner aucune contrée de la vaste terre de Dieu. Pourtant, jamais dans l’histoire de la Mauritanie, un cheikh soufi n’appela à faire exploser un marché, une mosquée, ni tuer un voisin, voire un non-musulman, pour les punir d’agir ou de penser autrement. Quant aux fatwas de sang et de l’excommunication (takfir) nous savons très bien d’où elles viennent, quelles universités les produisent, et combien de capitales en ont financé la diffusion, 40 ans durant.
Le bercail des théologiens, jurisconsultes et vérificateurs d’exception enfanta les sommités du soufisme sahélien, lesquelles œuvraient, toujours, à rebours de la violence et du chaos nihiliste Cheikh Sidia al-Kabîr, Cheikh Mohamed Fâdhil, Cheikh Sidi al-Mokhtar al-Kunti, Cheikh Hamahoullah, Cheikh Mohamed El havedh, Cheikh Mohamed Val Ould Metali, leur prestige témoigne, a posteriori, que la Mauritanie n’aurait été ni unie ni musulmane sans eux. Ils n’ont levé les armes contre les musulmans, mais plutôt élevé la parole de piété, éduqué les générations et concouru à purifier les âmes, par le consentement et le respect du libre-arbitre individuel. Peut-on vraiment les comparer aux illuminés d’aujourd’hui, quand ces derniers, la bave aux lèvres, distribuent des fatwas de mort, en direct ?
Le soufisme n’est pas qu’une affaire intérieure, à la Mauritanie. Sa douceur a porté l’islam dans la profondeur de l’Afrique, du fleuve Sénégal au Fezzan, en passant par Tombouctou et les rives du lac Tchad. De la Mauritanie, il s’est projeté vers le sud du Continent, jusqu’aux confins animistes du Golfe de Guinée. Avant que ces pays ne connaissent les écoles modernes et les universités, les cheikhs soufis y enseignaient, déjà, les sciences du droit, la pratique de la piété et l’espérance de la foi. Le soufisme n’était pas seulement un ensemble de litanies ou de séances du rappel à Dieu (Dhikr), mais un pont civilisationnel qui reliait, la Mauritanie, à son environnement et lui conférait un poids supérieur à sa réalité politique.
Les gens du dhikr et de l’invocation mystique (Wird) même s’ils s’immergent dans leurs rites, s’affichent quiétistes et débonnaires. Le maximum de la transe se déroule en une séance de chants éperdus que vient clore la prière auprès de la tombe d’un saint. Ils ne goûtent le lyrisme du sang ni les fatwas du ressentiment. D’ailleurs, n’est-il pas ironique de constater que les contempteurs de la joie médium de dévotion, sont souvent les mêmes qui justifient le port des armes au nom de l’unicité de Dieu (Tawhid) et du devoir de guerroyer sur le sentir droit (Jihad) ! Alors, lequel des deux s’avère le moins dangereux à la survie d’une société du contrat consenti ? Un cheikh qui rassemble ses ouailles autour d’une festivité spirituelle ou un prédicateur sectaire qui revendique, sur TikTok, la mise à mort des dissidents ? A quelle aune se mesure leur nuisance comparée ? : Que notre jeunesse passe des heures à l’écoute contemplative (samaa), ou qu’elle perde la vie, tapie sous les grottes, aux côtés des “Signataires par le sang”, des “enturbannés” et autres “soldats du Califat” ?
Le soufisme, a contrario de la Wahhabia, ne consacre l’implantation d’un corps étranger, non il façonne le lien entre les identités locales et s’abstient de les uniformiser, reconnaissant, alors, les nuances de chacune. Les zawiyas et les mahadras ont constitué l’épine dorsale de notre savoir vivre, de nos modes de vie variés. Par-delà la moralisation des comportements, elles rendent accessibles la lecture, l’écriture et la mémorisation des versets, préservent la qualité de la langue arabe au cœur d’une africanité plurielle. Elles inculquent, sans discrimination, des valeurs d’humilité, de piété et de miséricorde, même si certaines branches du Tassawuf dévièrent de l’horizon commun. S’attaquer au soufisme, implique la volonté d’extirper, de la mémoire islamique, une part de fondement dont le vide immédiat ne peut être comblé que sous un éboulis d’intolérance, de coercition et de nivellement par le bas.
Regardons, alentour: l’Algérie a payé le tribut exorbitant d’une décennie entière de sang et de régression intellectuelle, pour avoir laissé prévaloir et s’installer le règne des vacuités abyssales. Le Mali saigne encore et s’écroule, faute d’avoir perçu, dès les prémices, le dégât du salafisme. Le Nigeria a été avalé par Boko Haram après la destruction de ses écoles traditionnelles. La Mauritanie, elle, a relativement échappé à la transplantation vénéneuse parce que les zawiyas et le soufisme y ont servi de défense immunitaire, au même titre que les festivals de chant et de musique, sans omettre la poésie populaire et le maintien de la visibilité sociale des femmes. Le pays ne doit pas sa résilience à la dissuasion militaire. Le protège, d’abord, un bouclier d’authenticité et de spiritualité qui a rendu, les populations, naturellement réfractaires aux appâts de la haine confessionnelle.
Cependant, certaines voies soufies se sont refermées sur des fiefs clos et légion de cheikhs devinrent des contrefacteurs de bénédictions et des négociants d’amulettes magiques. Mais leur tort – aussi réel soit-il – paraît plus léger et bien moins mortel que l’incitation à égorger le contradicteur ou se faire exploser au milieu de la foule indifférenciée. La superstition se discute et se corrige à l’ombre apaisante de l’éducation et de l’apprentissage de la contradiction (Jadal). En revanche, la balle, le poignard ou la voiture-bélier du justicier takfiri, eux, ne suscitent que le déferlement de la colère et le besoin de la vengeance. Tant qu’à choisir selon les critères universels de la raison, une personne saine optera pour le soufisme, fût-ce en « moindre mal ».
Oui, le soufisme reste en retard d’une réforme: Il lui appartient de se libérer de certaines rigidités, de s’ouvrir davantage aux enjeux de la modernité et, surtout, de s’extraire des anachronismes de la succession dynastique. Il est peu tenable, de nos jours, que les cheikhs transmettent le statut de guide, à leur progéniture, au titre d’un néo patrimonialisme abusif. Néanmoins, la somme des défauts – au demeurant réversibles – ne mérite démolition ou procès en sorcellerie. Une société qui renonce à son dernier bastion sans construire d’alternative se livre, d’elle-même, à l’enfer de l’auto-dissolution.