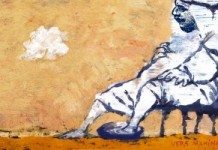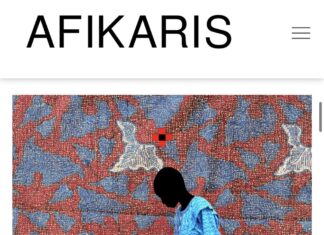Selon l’ancien journaliste du Monde Yves Mamou qui a lancé son propre site d’information sur le Moyen Orient en revendiquant un attachement indéfectible à l’existence d’Israël, les Israéliens doivent cesser de se comporter en « proxy » qu’un plus-puissant menace de lâcher à tout instant.
Yves Mamou
Le 4 mai, un missile hypersonique tiré du Yémen par les Houthis, une milice financée et armée par l’Iran, n’a pas été intercepté et a creusé un cratère à proximité de Ben Gourion, le principal aéroport de Tel Aviv. Le 5 mai, Israël a riposté et a détruit l’aéroport de Sanaa au Yémen. Le 6 mai, Donald Trump a annoncé qu’après 50 jours de bombardements, un accord de trêve avait été conclu entre les seuls États-Unis et les Houthis : ces derniers cesseront d’agresser les navires américains en mer Rouge et, en échange, les États-Unis cesseront de bombarder les Houthis. Le même jour, le Bureau politique des Houthis a mentionné que le cessez-le-feu ne s’appliquera pas à Israël et que les envois de missiles sur Tel Aviv continueront.
Pourquoi Donald Trump n’a-t-il pas inclus Israël dans la trêve ? Pour manifester son mécontentement envers son allié qui ne règle pas assez vite le problème des otages, nous explique le Jerusalem Post. Les ennemis d’Israël auront compris, eux, qu’il existe des différends entre Netanyahou et Trump et que ces différends peuvent et doivent être creusés davantage.
Michael Oren, historien et ex-diplomate israélien, affirme que les Israéliens ne peuvent et ne doivent compter que sur eux-mêmes. Chaque fois qu’ils ont remis leur sécurité entre les mains d’un tiers, « les résultats ont été désastreux », écrit Oren. Et de citer les forces de maintien de la paix de l’ONU au Sinaï et à Gaza qui « ont été chassées du jour au lendemain par l’Égypte en 1967 ». Pendant la première guerre du Golfe en 1991, Tsahal s’en est remis aux missiles Patriot américains qui ont raté les missiles SCUD tirés par l’Irak de Saddam Hussein. Michael Oren rappelle également qu’en 2006, Israël a accepté la mise en place d’une force internationale au Liban, « la FINUL – qui non seulement n’a pas préservé notre sécurité, mais a aidé l’ennemi à la compromettre ».
Les prémices sont là. L’interminable guerre de Gaza a montré que les États-Unis ne sont pas l’inébranlable allié d’Israël et qu’un jour peut-être, ils pourraient même se retourner contre lui.
· LA GUERRE DE GAZA : RETOUR SUR IMAGE.
– L’administration Biden, une ambivalence certaine
Quand le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre 2023, une administration démocrate était aux commandes à Washington (DC). Joe Biden, président des États-Unis, a dépêché deux porte-avions en Méditerranée et a adressé un « Don’t » très ferme à l’Iran et au Hezbollah. À deux reprises, le 9 octobre et le 11 octobre 2023, Joe Biden a fait savoir à l’Iran et au Hezbollah qu’il se rangerait aux côtés d’Israël s’il leur venait à l’idée de soutenir militairement le Hamas.
Mais simultanément, les États-Unis ont multiplié les tracasseries envers Israël. Ils ont multiplié les ingérences « humanitaires » dans le but d’obtenir un cessez-le-feu : Israël devait « protéger les populations civiles de Gaza », puis réduire le nombre de victimes civiles à Gaza, puis nourrir les populations civiles de Gaza, puis organiser des « pauses humanitaires » tantôt pour libérer les otages, tantôt pour alléger le fardeau des populations civiles de Gaza.
Le 8 mai 2024, quand Tsahal a voulu prendre le contrôle de Rafah, le président Biden a refusé de livrer une cargaison de 1 800 bombes de 2 000 livres (environ 907 kg) et de 1 700 bombes de 500 livres. Il s’agissait de « protéger les civils ».
En novembre 2024, l’administration du président Joe Biden a suspendu la livraison de 134 bulldozers blindés à Israël. Des engins qui servent à protéger la vie des soldats quand Tsahal entreprend de démolir des abris terroristes à Rafah.
– L’administration Trump, une certaine ambivalence
L’élection de Donald Trump n’a pas radicalement modifié la situation israélienne : une ambivalence différente s’est mise en place. Le 11 janvier 2025, Steve Witkoff, envoyé spécial du président Donald Trump pour le Moyen-Orient, a surgi dans la vie du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il lui a fait savoir de manière comminatoire que Donald Trump exigeait un cessez-le-feu à Gaza avant l’investiture présidentielle du 20 janvier 2025.
Simultanément, Donald Trump a mis fin à l’embargo prononcé par Biden sur certaines armes.
Des idées innovantes ont aussi surgi. Le 4 février, le président Trump a proposé que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza, avec l’intention de la transformer en une « Riviera du Moyen-Orient« . Ce plan impliquait le déplacement de la population palestinienne vers des pays voisins et la reconstruction complète du territoire.
Du jamais entendu.
L’ambivalence Trump n’a toutefois pas cessé. Fin avril 2025, plusieurs sources (Reuters, i24NEWS, L’Orient-le Jour, Le Figaro…) ont indiqué que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ignorait tout des négociations secrètes sur le nucléaire que les États-Unis avaient entrepris de mener avec l’Iran. Non seulement le Premier ministre israélien n’était pas informé, mais il les a découvertes à Washington alors qu’il était venu chercher un feu vert pour une attaque contre les installations nucléaires iraniennes.
Le 6 mai, autre surprise : Trump a négocié une trêve avec les Houthis… pour les États-Unis seulement.
Quelles leçons Israël doit-il tirer de ses relations avec ces deux administrations américaines ?
-
Il arrivera un jour où les intérêts des États-Unis et d’Israël seront totalement divergents. Israël doit s’y préparer. Si les universités américaines continuent de produire du cadre supérieur woke propalestinien à la pelle, les gouvernements et les partis américains suivront leurs électeurs. Et les Démocrates (c’est déjà le cas) et les Républicains deviendront les plus chauds partisans d’un État palestinien. Peu importe si le Hamas est aux commandes.
Qu’Israël doit monter une industrie d’armement qui le mette à l’abri des ruptures d’approvisionnement. La dépendance aux armements et le chantage aux armements de Joe Biden ont rallongé la guerre et ont coûté la vie à des soldats israéliens. Que se passera-t-il si les fabricants d’avions de chasse américains refusent de livrer des pièces de rechange ?
Qu’Israël doit prendre le risque de décisions stratégiques qui contrarient les États-Unis. Si Israël pense que sa sécurité dépend de la destruction du dispositif nucléaire iranien, alors il doit agir en conséquence. S’en remettre à des présidents américains qui ne comprennent pas la nature de cet islamisme qui entend rayer 10 millions d’Israéliens de la surface de la terre n’est pas acceptable. Israël doit comprendre que les démocraties, c’est structurel, sont lâches devant le totalitarisme.
Qu’Israël doit cesser de se comporter en « proxy ». Qu’est-ce qu’un « proxy » ? Pas un allié que l’on consulte, mais un pion qu’un plus-puissant arme et finance pour agir à sa place. Un peu comme le Hezbollah ou les Houthis sont les proxys de l’Iran, Israël est devenu le « proxy » des États-Unis. Les « alliés » occidentaux d’Israël doivent intégrer qu’Israël dispose d’une part d’imprévisibilité. Et que, pour y parer, mieux vaut, avant d’agir, le consulter et prendre son avis en considération.