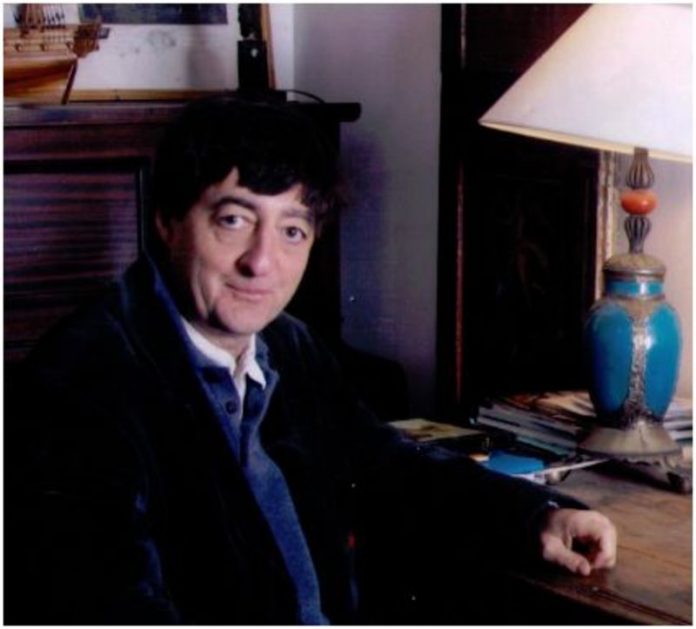Le sommet d’urgence réunissant la Ligue arabe et l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a cherché à afficher une solidarité officielle avec le Qatar après l’attaque israélienne et à coordonner une réaction collective. L’alignement sur le Qatar risque de rester largement symbolique, illustrant une fois de plus la difficulté du monde arabe à s’unir concrètement autour de la cause palestinienne, au-delà des communiqués de circonstance.
Malgré l’émotion dans les médias et parmi les populations, beaucoup d’États arabes restent prudents, mesurés dans leurs prises de position, voire silencieux sur certains sujets. Plusieurs éléments expliquent cette tiédeur :
- La normalisation avec Israël. Les États comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, etc., ont signé des accords de normalisation avec Israël (Accords d’Abraham, etc.). Ces gouvernements sont aujourd’hui dans une situation où soutenir le Hamas ouvertement pourrait compromettre leurs relations diplomatiques, économiques, sécuritaires.
- La priorité à la stabilité intérieure : beaucoup de régimes arabes sont autoritaires ou semi‑autoritaristes. L’exemple palestinien, avec ses mobilisations populaires, ses manifestations, ses appels à la résistance, est perçu comme un risque potentiel de contagion. Ils préfèrent limiter les tensions internes, maintenir l’ordre, plutôt que d’encourager l’activisme.
- Les pressions internationales. Les États arabes dépendent souvent de partenariats militaires, de l’aide étrangère, des investissements occidentaux. Critiquer fortement Israël ou accueillir des mouvements classés « terroristes » ou « militants » expose à des sanctions, à des pressions diplomatiques. Le coût politique et économique d’un engagement fort est élevé.
- Divergences internes au monde arabe : il n’existe pas « un » monde arabe homogène. Chaque pays a ses propres priorités – sécurité, économie, rivalités internes, alliances – qui influencent sa politique. Certains soutiennent verbalement la cause palestinienne, mais évitent les actes concrets qui obligeraient à prendre des risques.
Un équilibre instable
Le transfert de la direction du Hamas à Doha, la distance, les frappes ciblées et la tiédeur des États arabes ne sont pas des incidents isolés mais un modèle systémique. Mais quelles évolutions possibles ?
- Une pression internationale et diplomatique accrue. L’attaque de Doha déclenche des sommets arabes‑islamistes, des condamnations, mais jusqu’où ira l’action concrète ? Exiger l’expulsion des dirigeants, sanctionner les États qui les accueillent, ou faire respecter le droit international reste une piste, mais risquée.
- La perte possible de légitimité du Hamas : si le leadership ne parvient pas à réduire l’écart entre ses discours et la réalité des vies meurtries à Gaza, il risque de perdre du soutien populaire. Le mouvement aime symboliser la résistance, mais la résistance doit aussi produire des résultats, du réconfort, de la protection.
- Le rôle du Qatar remis en question : Doha sera sous pression pour clarifier sa position, pour équilibrer ses alliances, et pour éviter d’être perçu comme un refuge irresponsable plutôt que comme médiateur. Le coût diplomatique de l’attaque à Doha pourrait pousser Doha à reconsidérer les conditions de présence du Hamas.
- La solidarité populaire vs politique d’État. Les opinions publiques arabes restent largement solidaires de la cause palestinienne. Mais face aux contraintes diplomatiques, aux engagements internationaux, aux alliances, les gouvernements tendent à privilégier la stabilité, le commerce, la politique intérieure, au détriment d’un engagement fort. Ce fossé pourrait creuser des tensions internes.