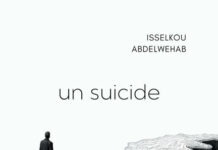Avec environ 150 000 esclaves pour 3,8 millions d’habitants, la Mauritanie présente la plus grande proportion d’esclavage moderne, loin devant le deuxième pays du classement, Haïti, qui en compte deux fois moins. Sur place, l’une des principales ONG qui lutte contre l’esclavage, l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), estime quant à elle que les esclaves représenteraient aujourd’hui jusqu’à 20% de la population Mauritanienne.
Selon le rapport de Walk Free, l’esclavage dans ce pays prend une forme essentiellement héréditaire et reste profondément ancré dans la société.
« La condition d’esclave s’est transmise à travers les générations. (…) Les esclaves peuvent être achetés, vendus, loués ou offerts comme cadeaux. (…) Ils n’ont le droit de rien posséder et sont eux-mêmes considérés comme des biens. »
La pratique concerne toutes les composantes ethniques du pays. « L’asservissement des populations noires-africaines – notamment les Haratins, « ceux qui ont été libérés » en dialecte arabe hassanya, c’est à dire les descendants d’esclaves — par les communautés arabo-berbères qui sont minoritaires est la forme la plus courante d’esclavage », explique Diko Hanoune, secrétaire général de l’Association des Haratins de Mauritanie en Europe (A.H.M.E). Elle se manifeste y compris au niveau politique. « Dans les années 1980, par exemple, le ministre noir de l’agriculuture Timera Boubou, a été destitué par le Président de l’époque Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya parce qu’il était descendant d’esclave.
Mais l’esclavage entre populations noires est également très important », note D. Hanoune. « Il s’articule autour d’un système de castes. Dans les communautés noires peuls ou soninkés, le pouvoir conféré à un chef de tribu ou à un marabou leur donne un statut de noble qui les autorise à avoir des esclaves. »
Le rapport précise que les femmes souffrent tout particulièrement de cette pratique, l’autorité et le contrôle des maîtres s’exerçant de manière plus forte dans la sphère domestique où elles mènent l’essentiel de leurs activités. Elles font souvent l’objet de violences sexuelles.
Officiellement pourtant, plusieurs lois interdisent la pratique de l’esclavage dans le pays, et ce depuis 1981. La dernière loi datant de 2007 criminalise cette pratique imposant des peines allant de 5 à 10 ans d’emprisonnement et des amendes. Mais leur application reste très difficile en pratique.
« Il est difficile pour les victimes d’avoir accès à la justice. La charge de la preuve leur incombe et aucune instruction ne peut être lancée tant qu’elles n’ont pas porté plainte. Les ONG ne peuvent par exemple porter plainte pour une victime. »
Ces conditions transforment souvent les démarches juridiques en un parcours du combattant pour les victimes, pour la plupart illettrées et ignorantes de la loi, qui doivent entreprendre les démarches administratives sans assistance.
« Les victimes n’ont souvent pas connaissance de leurs droits ou des possibles recours à la protection de la loi. Le gouvernement ne prévoit aucun programme de soutien destiné à aider les victimes à formuler leurs plaintes. »
De telles entraves expliquent en grande partie pourquoi des sanctions n’ont été appliquées qu’une seule fois depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2007.
« C’est sans fin », explique D. Hanoune. « Les chefs de tribus qui ont des esclaves votent pour les esclavagistes et le gouvernement fait pression sur les juges et les victimes contre l’application des peines. »
A la préservation politique et sociale des intérêts des plus forts s’ajoute une légitimation religieuse de ces pratiques. Biram Ould Abeid, le président de l’IRA, précise que les autorités mauritaniennes appliquent les principes des « livres de Khalil », un texte de droit musulman datant des XIIème et XIIIème siècles justifiant l’esclavage. « Ce code est élevé au niveau constitutionnel comme principale source de loi dans le pays. Les juges, les gendarmes, les imams, les administrateurs, connaissent tous ce texte et l’appliquent textuellement. Il a valeur de loi divine, supérieure à toutes les autres. »
— Lire ici l’intégralité de l’entretien avec Biram Ould Abeid
Récemment, l’approche des élections législatives et municipales — retardées depuis 2 ans et annoncées pour le 23 Novembre – a ravivé les tensions autour de l’accès aux droits et à la représentation politiques pour les esclaves.
Ceux-ci, pas plus que les descendants d’affranchis, ne peuvent en effet présenter de candidats aux élections. Comme l’IRA, le parti des Radicaux pour une Action Globale (RAG) qui a fait de la lutte contre l’esclavage son cheval de bataille, s’est vu refusé toute reconnaissance officielle. En novembre 2012, le gouvernement a également interdit les candidatures indépendantes, supprimant ainsi définitivement toute possibilité pour les représentants des « abolitionnistes » d’accéder au scrutin.
La répression contre les activistes s’est aussi accélérée. Le 6 octobre, dans la ville de Boutilimit, à 164 km au sud est de la capitale Nouakchott, un sit-in organisé par des militants abolitionnistes devant un poste de police a également été violemment réprimé par les gendarmes. Au cours de cette manifestation, les activistes ont particulièrement mis en avant le cas de Noura Mint Aheimed. Cette jeune fille de 19 ans est devenu un véritable symbole de la lutte contre l’esclavage après avoir porté plainte contre ses maitres après 14 ans d’asservissement.
Dans ce contexte, les efforts du gouvernement en matière de lutte contre l’esclavage ressemblent à une vaste stratégie de communication. Le rapport note la mise en place en mars 2013 d’un organisme national chargé de lutter contre l’esclavage : l’agence pour la lutte contre les séquelles de l’esclavage, l’insertion et la pauvreté. Si l’objectif affiché de cette structure est de s’attaquer au problème de la pauvreté qui entretient l’esclavage, peu de précisions sont apportées quant à ses moyens d’actions pour lutter contre cette pratique, faisant d’elle pour le moment une coquille vide…