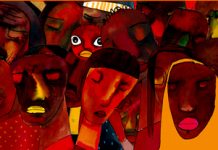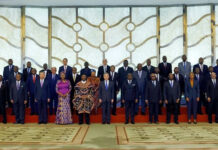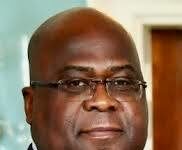Un geste de Brigitte Macron envers son mari à Hanoï a fait polémique. Était-ce une gifle ou un geste anodin? Au-delà de l’image, une lecture psychanalytique interroge ce que ce moment dit du couple, du pouvoir et de nous.
chroniqueur d' »Ici Beyrouth »
Certains gestes dépassent le cadre attendu et troublent la scène sur laquelle ils apparaissent. Celui de Brigitte Macron, filmé à la descente d’avion à Hanoï le 25 mai dernier, en est un exemple marquant. Ce moment furtif, perçu tour à tour comme une gifle ou une simple marque de complicité, a déclenché un flot d’interprétations. Car au-delà de l’anecdote, c’est bien l’irruption d’un geste ambigu à l’intersection du privé et du politique qui interroge, là où se brouillent les frontières entre identités intimes et fonctions officielles.
Pour la psychanalyse, cette scène ne se prête ni à une lecture morale ni à un simple fait divers. Elle invite à réfléchir à ce qu’elle véhicule du surmoi collectif, des tensions latentes et des représentations projetées sur la figure présidentielle. Ce qui frappe ici, c’est la dissonance: ce geste vient faire intrusion dans un agencement protocolaire, introduire un écart dans la mise en scène du pouvoir, et provoquer une jouissance étrange, diffuse, dans l’espace médiatique.
En 1957, l’historien polonais Ernst Kantorowicz publie un essai sur ce qu’il appelle Les Deux Corps du roi, dans lequel il explique que le roi, et par extension, le président, possède deux corps: un corps physique, mortel, et un corps symbolique immortel, porteur de la continuité de l’État. Dans la modernité républicaine, cette dualité persiste sous d’autres formes, celle du chef d’État d’un côté, et celle de l’homme privé de l’autre. Emmanuel Macron, en tant que président, incarne cette dualité. Or, la scène de Hanoï nous montre non pas le chef, mais l’homme privé, pris dans une relation conjugale, avec ce qu’elle peut comporter d’ambiguïtés, de tensions, de gestes échappés au flegme d’un faux self: ce n’est plus le président lisse, cadré, mais un homme dans sa relation conjugale, exposé à une manifestation spontanée, un acte subjectif.
Cette rupture entre l’image officielle et le surgissement de l’intime dérange. La caméra saisit un instant qui échappe au scénario établi. Et dans cet écart s’inscrit une faille, celle du trouble d’un pouvoir soudain déséquilibré, le flottement d’une relation à deux, prise dans le regard des spectateurs. Ce que le geste dévoile, ce n’est pas tellement une violence supposée ou une familiarité déplacée, mais la fragilité d’un rôle d’ordinaire bien réglé.
Depuis leur émergence publique, Emmanuel et Brigitte Macron nourrissent un récit médiatique et fantasmatique qui va bien au-delà de la politique. Leur histoire, peu conventionnelle, alimente projections et jugements. En psychanalyse, le couple constitue souvent un lieu d’identifications et de transferts. Ce que l’on voit du duo, ce que l’on croit y lire, nous renseigne, en réalité, sur nous-mêmes: notre rapport au pouvoir, à l’autorité, au masculin et au féminin en chacun et leur interférence dans les relations du couple.
Le geste capté à Hanoï, quelle que soit sa nature exacte, agit comme une intrusion du féminin actif dans une scène de pouvoir masculin. Il bouscule les représentations attendues de la femme du président, longtemps cantonnée à un rôle discret. Ici, les rôles se brouillent: qui tient la posture d’autorité? Qui corrige, qui joue? Et surtout, qui observe?
Lacan soulignait que l’inconscient s’exprime dans le langage de l’autre. Le geste de Brigitte Macron, perçu par des millions de regards, entre dans un tissu de discours qui dépasse sa signification immédiate. Il parle du couple, bien sûr, mais aussi du pouvoir, du genre, de ce que le public attend, ou redoute, d’une scène mêlant le privé et le public.
La puissance de cette séquence tient à l’attitude qu’adopte le spectateur, celle d’un voyeur. Comme au théâtre, un rideau s’ouvre sur une scène d’intimité. Le geste, par sa brièveté, laisse place à toutes les interprétations. Il devient une énigme collective et chacun tente de la résoudre en y injectant ses propres représentations. Ce n’est pas, en réalité, le couple Macron qu’on ausculte, mais nos propres zones d’ombre, nos tensions affectives et relationnelles autour de l’identité sexuelle, des relations et des rapports de pouvoir dans un couple.i
Le réflexe d’Emmanuel Macron, portant la main à son visage, est d’une grande richesse symbolique. C’est un moment de désorientation, un instant de rupture dans le contrôle corporel. L’homme public cède la place à un sujet privé, pris au dépourvu. Ce geste exprime, à sa manière: «Que m’arrive-t-il là, devant tous?» Une question qui touche à ce que chacun peut vivre, parfois, dans ces moments de rupture entre la façade sociale et la vérité intime.
L’ampleur de la controverse est en elle-même significative. En tentant d’effacer la scène par une communication maîtrisée, parlant de simple jeu, rejetant toute violence, l’entourage présidentiel a contribué à en accroître la portée. Ce que l’on tente de nier trop vite revient souvent avec plus de force: l’inconscient, dit Freud, ne se laisse jamais faire.
Dans une société saturée de récits, le moindre accroc à la narration officielle devient un événement. Le corps présidentiel, censé incarner la stabilité et la maîtrise, devient ici écran de projections, réceptacle de fantasmes partagés. Ce geste concentre alors les contradictions d’une époque inquiète, où le moindre écart devient symptôme.
Ce moment de télévision, devenu viral, ne relève pas d’une anecdote domestique, mais d’une scène où le réel fait irruption. Là où le langage chancelle, où le contrôle se fissure, une vérité surgit. Ce que le psychanalyste repère dans ce genre d’instant, ce n’est pas un fait à juger, mais une manifestation du sujet au-delà du discours officiel, empêtré comme tout un chacun dans les rapports complexes du couple.
Une gifle? Peut-être. Mais surtout, un acte manqué qui dit tout ce que la fonction présidentielle s’efforce d’enfouir.