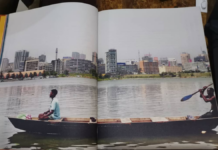Depuis son élection, le 4 novembre, et surtout depuis son investiture, le 20 janvier, Donald Trump provoque tsunami sur tremblement de terre. La tentative d’assassinat dont il a été victime le 13 juillet dernier à Meridian (Pennsylvanie), l’a habité de la conviction qu’il est investi d’une mission divine avec les pleins pouvoirs. Il aurait le droit, voire le devoir de tout dire, tout faire, d’humilier ses partenaires, de dénigrer ses alliés ! Chaque jour, il nous réserve son lot de surprises avec une brutalité digne d’Attila.
Une chronique de Dov Zerav
Tabula rasa !
Cette phrase de l’Internationale, « du passé, faisons table rase », semble être devenue la devise de l’Internationale réactionnaire en cours de constitution.
Laissons de côté les sujets internes pour n’examiner que les problématiques internationales.
Donald Trump, homme de paix ?
« Tel un cabri » pour reprendre l’expression du General de Gaulle, Donald Trump ne cesse de proclamer qu’il veut la paix, qu’il ne souhaite que la paix, qu’il n’a jamais entraîné son pays dans une guerre…
Que peut-on retenir de son 1er mandat ? Indiscutablement, son formidable succès des Accords d’Abraham ! Mais, il ne faut pas oublier que malgré toutes les concessions, il n’a rien obtenu du président Nord-Coréen. De même, avec sa volonté de quitter rapidement l’Afghanistan et de trouver un accord avec les Talibans, il leur a ouvert la voie du retour à Kaboul, même si son successeur porte une part de responsabilité.
En fait, depuis les guerres de George Bush Jr en Afghanistan, et surtout en Irak, un consensus s’est établi à Washington qu’il fallait mettre fin aux guerres impériales. Pendant que les Américains guerroyaient de par le monde, les Chinois renforçaient leur économie.
Nombreux sont aujourd’hui ses zélateurs qui réclament pour lui le « prix Nobel de la paix », ne serait-ce que pour faire mieux que son ennemi Barack Obama. Ce dernier avait obtenu cette distinction seulement huit mois après son investiture. L’Académie d’Oslo avait tenu à saluer « … ses efforts extraordinaires en faveur du renforcement de la diplomatie et de la coopération internationales entre les peuples… », ses discours qui n’ont été ni précédé ni suivi d’actes pendant huit ans.
Donald Trump a raison de vouloir mettre fin à 3 ans de guerre meurtrière en Ukraine et y instaurer la paix.
Le refus du président Volodymyr Zelensky de s’enfuir de son pays en février 2022, le courage des Ukrainiens et le retrait des troupes russes ont conduit l’Occident à se ranger derrière Kiev. Une aide qui a donné des ambitions aux Ukrainiens surtout après le retrait russe de Kherson, le 11 novembre 2022.
Alors qu’il s’agissait d’un repli stratégique derrière le Dniepr, il a été interprété à tort comme une débandade de l’armée russe. S’ensuivit le sentiment qu’il était possible de bouter les Russes hors d’Ukraine, y compris de la Crimée et le début d’une contre-offensive.
Nous avons eu droit à des débats sans fin, attisés par les chaines d’information continue, sur les livraisons de chars, de défenses anti-aérienne, d’avions… Pourtant, jamais, l’Occident n’aurait dû encourager une telle contre-offensive car, quelles qu’aient été les faiblesses de l’armée russe, le rapport humain demeurait toujours en sa faveur. Il y a un consensus pour considérer qu’une telle attaque ne peut se faire sans un rapport humain de 1 à 5, voire 7. On était loin du compte, très loin du compte. L’armée ukrainienne, malgré quelques grignotages, a buté sur les 3 lignes de défense russes ; fin décembre 2023, après 7 mois, le constat d’échec s’est imposé !
Depuis 15 mois, le conflit s’enlise malgré les succès ukrainiens en mer d’Azov et sur le sol russe dans la région de Koursk et les avancées limitées des russo-coréens. L’impasse était totale.
Il convient de saluer la démarche de Trump d’essayer de ramener les belligérants à la table des négociations. L’intention est plus que louable. Le bât blesse avec la méthode.
Sans que ce soit risible, son seul ami est aujourd’hui Vladimir Poutine !
Deux mois et demi après son investiture, Trump n’a rien obtenu, ni paix, ni cessez le feu. Il a pourtant mis M. Zelensky en situation de faiblesse en l’humiliant mais surtout en lui supprimant la livraison de renseignements, ce qui a permis à l’armée russe de récupérer les territoires perdus dans la région de Koursk, et en remettant en cause l’aide américaine.
Trump cherchait-il vraiment la paix en Ukraine ?
N’a-t-il pas plutôt cherché à troquer avec Poutine l’Ukraine contre ses propres visées territoriales sur le Canada, le Groenland ou le canal de Panama ? Au passage, il a fait main basse sur les terres rares ukrainiennes.
Le détricotage du droit international
Les 4 votes américains au Conseil de sécurité et à l’Assemble générale (AG) des Nations Unies, le 24 février et le 2 mars 2025 marquent une double rupture :
- Pour marquer le 3ème anniversaire de l’agression russe, l’Ukraine a présenté, le 24 février, à l’AG une résolution réclamant le retrait des troupes russes des territoires ukrainiens et l’arrêt des hostilités. L’administration Trump a voté contre avec la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, la Hongrie, le Nicaragua, le Mali, et 11 autres pays ; en revanche, 93 ont voté pour, et 65 se sont abstenus.
Le 24 février, une résolution américaine au Conseil de sécurité réclamant la fin immédiate du conflit sans rappeler l’exigence du respect de l’intégrité territoriale de l’Ukraine était votée par les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Algérie, le Guyana, la Pakistan, le Sierra Leone…
Deux autres résolutions à l’AG, le 2 mars, enregistraient cette nouvelle cartographie onusienne et l’explosion du camp occidental.
- Deux des principes fondamentaux du droit international, l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des frontières ont volé en éclat en quelques jours. Depuis 1944, l’intangibilité des frontières a permis d’éviter de nombreux conflits en Afrique, nonobstant leurs incohérences du fait de découpages coloniaux arbitraires.
Sous prétexte de vouloir obtenir une « paix » rapide en Ukraine, le président américain n’y concourt pas ; la reddition sans conditions qu’il préconise mettra en évidence l’injustice d’une solution imposée et alimentera les ressentiments et les désirs de revanche. Il eût mieux valu qu’il retire purement et simplement son soutien diplomatique, financier et militaire à l’Ukraine, sans chercher à imposer la victoire poutinienne, et encore moins à faire croire qu’il est un « faiseur de « paix ».
En bafouant ces principes fondamentaux du droit international, Donald Trump pourrait justifier de nombreuses revendications et guerres latentes.
La dépréciation, voire la fin de la crédibilité américaine
Donald Trump nous a renvoyés à l’état de nature où la force prévaut sur le respect de certaines règles constituant des barrières contre la violence et la barbarie. Telle la « licence pour tuer » accordée à James Bond, Donald Trump a donné un blanc-seing à tous les dictateurs qui rêvent de conquêtes militaires.
Qui serait légitime demain pour :
- Empêcher la Chine d’envahir Taïwan, contenir ses menées expansionnistes en mer de Chine contre le Japon, les Philippines, le Vietnam…, la retenir pour s’approprier avec la Corée du Nord la Corée du Sud… Les dernières manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan laissent présager le pire !
- Contenir l’expansionnisme iranien sur tout le Proche Orient
- Retenir la Turquie dans ses objectifs à Chypre, en Lybie ou en Syrie…
- Calmer certaines ardeurs de pays africains… ?
En préconisant et favorisant un retour au « tohu bohu », Donald Trump va pouvoir mener ses propres opérations de conquêtes. Au-delà de ses visées territoriales, c’est toute la crédibilité de la dissuasion américaine, y compris nucléaire, qui est sapée.
Donald Trump était censé nous donner des leçons dans l’art de la négociation. Tout lâcher dans le cadre d’un exercice de télé-réalité pendant que les collaborateurs de Poutine rappellent le maintien de tous leurs objectifs russes… Contraindre Volodymyr Zelensky à « se soumettre ou se démettre » … Exiger a posteriori que les États-Unis soient remboursés de leur soutien sur la base de chiffres exagérés… ne relèvent pas d’un négociateur exceptionnel.
Donald Trump n’inscrit pas son pays dans une continuité historique, quelles que soient ses intentions louables de mettre fin à un bain de sang en Ukraine et à épargner le contribuable américain. Il gère les affaires de l’État en joueur de poker alors qu’il a en face de lui un maître russe d’échecs et un praticien chinois de go.
La remise en cause de la gouvernance mondiale
En déclenchant une guerre commerciale mondiale, Donald Trump a ouvert la boite de Pandore d’une déstabilisation profonde du système économique mondial.
Rappelons-nous ! Lorsque l’Américain Harry Dexter White et le britannique John Maynard Keynes ont commencé en 1942 à travailler sur l’architecture économico-financière de l’après-guerre, ils avaient convenu que, dans l’entre-deux-guerres, l’augmentation des droits de douane et son corollaire avec la multiplication des dévaluations compétitives avaient été considérées comme un des facteurs de l’antagonisme entre les nations, un des ferments de la guerre.
Ce constat avait conduit à créer le Fonds monétaire international (FMI), gardien des changes et à signer les Accords généraux sur le commerce et les tarifs (General aggreement on trade and tariffs, GATT), chargés de désarmer les protections douanières.
La perte d’influence du FMI s’est effectuée en deux étapes :
- Les Accords de la Jamaïque en 1975 avec la fin des changes fixes ont été le point d’aboutissement de la période ouverte par Washington en 1971. Incapables de contrôler ses déficits, les États-Unis, pour solder le coût de la guerre du Vietnam, « ont cassé le thermomètre » avec la fin de l’étalon-or, la convertibilité du dollar en or, et, in fine, la remise en cause des changes fixes. Toute la construction de l’après-guerre avec ses disciplines a été jetée aux orties.
N’ayant plus d’objet, le FMI s’est réinventé en devenant le financeur des pays en développement. « De gardien des changes », le FMI est devenu un « faiseur de plans d’ajustement structurel ».
- Le dumping monétaire chinois Depuis plus de deux siècles et Adam Smith, le père de l’économie politique, tous s’accordent à considérer que l’échange international est profitable sous réserve que certaines règles soient respectées dont le retour à l’équilibre extérieur par la modification des prix relatifs et des taux de change.
Un pays en déficit structurel doit déprécier sa monnaie pour que la modification des prix relatifs lui permette de retrouver de la compétitivité. En sens inverse, un pays en excédent structurel doit apprécier sa monnaie pour écorner sa compétitivité et permettre le retour à l’équilibre. À défaut l’échange n’est pas équitable.
Alors que l’Empire du Milieu ne cesse d’accumuler des excédents commerciaux et que ses partenaires cultivent les déficits, les autorités de Pékin continuent de manipuler leur monnaie en la dépréciant, au lieu de la réévaluer.
Le constat peut être identique tant pour l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Elle est en panne depuis plusieurs années ne serait-ce que parce que Washington n’a pas désigné son représentant à l’instance d’arbitrage.
Alors que les Accords de Marrakech en 1994 avec le passage du GATT à l’OMC constituaient une véritable avancée de la gouvernance mondiale, les coups de boutoir des tentatives protectionnistes américaines et les différents dumpings chinois ont bloqué l’institution… Aujourd’hui, Trump a enterré l’OMC, le libre-échange, voire la mondialisation.
Mais n’oublions pas que l’échange international repose sur les prix relatifs qui sont fonction de la compétitivité, des droits de douane, mais aussi du taux de change. Aussi, la guerre commerciale déclarée par Donald Trump ouvre la perspective d’une vraisemblable guerre monétaire.
Un FMI sans intérêt, une OMC en état de « mort cérébral », une machine onusienne complétement déclassée par les deals entre les trois grands et par ses propres dérives (cf. ma chronique du 7 octobre 2024 « la faillite du machin ») … C’est toute la gouvernance mondiale créée après 1945 qui est battue en brèche.
Seule la Banque mondiale pourrait peut-être continuer à jouer son rôle malgré l’absence de « success story » en matière de développement et la contestation de banques régionales ou continentales au premier rang desquelles la banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII) ; cette dernière a été créée par Xi Jinping en 2013 pour consolider « les routes de la soie » et la mainmise de l’Empire du Milieu sur les pays asiatiques.
Mais, si Washington diminuait ses financements comme ils ont remis en cause ceux de l’USAID, l’avenir de la Banque mondiale serait problématique.
Les fausses certitudes de >Donald Trump
Donald Trump a raison de vouloir combattre les déficits jumeaux américains, le déficit du budget fédéral frère du déficit de la balance commerciale. Rappelons-nous que dès 1960, le général de Gaulle critiquait ces déficits et l’absence de discipline des Américains dans la gestion de leurs comptes.
Donald Trump a raison de vouloir combattre la désindustrialisation des États-Unis et d’éviter que l’industrie ne se limite au complexe militaro-industriel.
Mais, Donald Trump occulte :
- Le coût des guerres. Selon certaines estimations de chercheurs américains, les guerres en Afghanistan, Irak et Syrie auraient coûté au contribuable américain 6 000 Md$ sans compter les 2 000 Mds du service aux vétérans, près de 20 % des 36 000 Mds de dette publique fédérale américaine.
- La perte de compétitivité de l’économie américaine, notamment à cause du coût salarial et d’un dollar sur apprécié pour permettre les souscriptions de bons du Trésor américain.
- L’imbrication des pays dans les chaines de valeur des multinationales et les droits de douane vont perturber les productions. L’exemple de l’automobile est, à cet égard, intéressant. L’administration Trump est revenue sur les premières annonces pour le Canada et le Mexique ; les chaînes de production sont en partie installées dans ces deux pays ; les pièces et véhicules font de nombreux allers-retours au cours de leur fabrication.
- Les difficultés de l’industrie automobile américaine ou d’entreprises comme Boeing ne résultent pas des droits de douane, mais d’erreurs stratégiques.
Tout ces effets auraient pu être limités si nous avions respectés les règles du commerce international à savoir que tout déséquilibre commercial doit être corrigé par une modification des changes.
Par ailleurs, Donald Trump sous-estime que :
- L’augmentation des droits de douane entraine certes une hausse des recettes de l’État fédéral, mais qui n’est pas proportionnelle à cause de la probable baisse des importations
- L’augmentation des droits de douane se traduit mécaniquement par une hausse des prix des produits importés, et, en attendant qu’une production locale prenne le relais, cela alimentera une inflation
- La guerre commerciale ouverte par Donald Trump va automatiquement entrainer une diminution des échanges internationaux et donc des productions, ce qui est de nature à provoquer un mouvement récessif également impacté par l’incertitude créée pour les opérateurs économiques.
La conduite de l’économie mondiale va devenir de plus en plus difficile d’autant que les instances de coordination auront du mal à fonctionner.
Vers un réveil de l’Europe ?
Aujourd’hui, Trump bouscule l’Europe.
La fin de la protection américaine la met à la portée d’un prédateur. Le risque russe n’est pour autant pas immédiat tant Moscou est à la peine en Ukraine ; mais, les prétentions russes sont toujours présentes.
La mobilisation de l’Europe est compliquée par la présence dans l’Union de pays favorables à la Russie comme la Hongrie ou peu sensibles à la menace russe comme l’Espagne et l’Italie.
Les exemples de division sont nombreux. L’un d’entre eux est particulièrement éclairant ; le Danemark envisage de faire une commande « historique » de F35 alors que les visées sur le Groenland sont de plus en plus pressantes !
Avoir invité la Turquie à la conférence de Lancaster House avait probablement pour objectif d’afficher, avec la présence de Justin Trudeau, la tenue de la 1ère réunion de l’OTAN sans les Etats-Unis. Néanmoins, cela est revenu à oublier qu’Ankara a envahi et occupé la moitié de Chypre depuis l’été 1974, à fermer les yeux sur la violation de l’intégrité territoriale d’un pays européen.
L’augmentation de droits de douane va bousculer l’économie européenne. Mais l’Europe a tous les moyens juridiques, économiques et financiers pour faire face à cette agression américaine. Cela exige union et volonté. Si l’Europe veut écrire sa propre histoire, il est grand temps de ne pas se comporter comme les bourgeois de Calais !
L’heure de vérité a sonné pour l’Europe.
Dov ZERAH