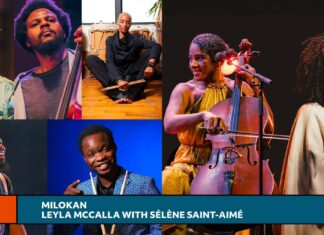Depuis 1962, la relation entre la France et l’Algérie oscille entre attirance stratégique, rancune historique et calculs politiques. Aujourd’hui encore, cette relation reste piégée. Piégée par le passé, certes, mais surtout par un pacte silencieux entre les élites au pouvoir des deux pays, qui se comprennent sans se dire. Un pacte des loups. Et dans ce huis clos diplomatique, les seuls perdants sont les sociétés civiles et les deux peuples. Une mémoire instrumentalisée
Lyazid Benhami
Soixante-deux ans après la fin de la guerre d’indépendance, la colonisation française (1830-1962) continue de hanter les discours politiques. La France a longtemps refusé de reconnaître ses responsabilités. Ce n’est qu’en 2021 que le rapport de l’historien Benjamin Stora proposait une série de gestes de réconciliation. Mais aucune reconnaissance officielle des crimes coloniaux, comme les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en mai 1945 (estimés à plus de 20 000 morts par des historiens algériens), n’a encore été actée.
Alger continue d’exploiter la mémoire de la guerre pour asseoir sa légitimité. « Le pouvoir algérien s’est construit sur un récit héroïque, figé, où la France est l’ennemi perpétuel. Cette mémoire est devenue un outil politique permanent », expliquent certains politologues .
Une coopération réelle derrière les tensions
Pourtant, derrière les crispations diplomatiques, la coopération est bien réelle. La France est le deuxième fournisseur de l’Algérie, avec 7,3 milliards d’euros d’échanges commerciaux en 2023. L’Algérie reste un partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et un fournisseur clé de gaz naturel, surtout depuis la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine.
La gestion migratoire est un autre levier. En 2021, Paris a réduit de moitié le nombre de visas pour les ressortissants algériens, provoquant une crise diplomatique. Mais la mesure a été partiellement assouplie depuis. Les deux États coopèrent, malgré les discours musclés.
La société civile, grande sacrifiée
Ce jeu d’ambiguïtés a un prix. En Algérie, le mouvement du Hirak, né en 2019, a rassemblé des millions de citoyens dans les rues pour réclamer un changement de système. Le pouvoir a réagi par la répression, les arrestations, la fermeture des espaces d’expression. Plus de 300 détenus d’opinion sont encore incarcérés selon la Ligue algérienne des droits de l’Homme.
En France, les citoyens d’origine algérienne – plus de 4 millions de personnes selon l’Insee, toutes générations confondues – restent pris en étau. Ils sont souvent les premiers visés par les débats identitaires sur l’islam, l’immigration ou l’« insécurité culturelle », amplifiés à l’approche de chaque échéance électorale.
Une sortie possible, mais bloquée
« Le lien humain entre les deux pays est plus vivant que jamais, mais le politique ne suit pas », résume Fouad Laroui, écrivain et observateur du Maghreb. En effet, des passerelles existent : initiatives culturelles, échanges universitaires, coopérations locales. Mais elles sont marginalisées, invisibles, voire méprisées par les pouvoirs en place.
En France, la montée de l’extrême droite – en passe de devenir majoritaire selon plusieurs sondages – verrouille tout débat sincère sur la mémoire coloniale. Pour une partie de la droite, reconnaître les crimes coloniaux reviendrait à « salir » la nation ; pour l’extrême droite, il s’agit même d’un tabou identitaire. À quelques exceptions près, le champ politique français se referme de plus en plus sur une lecture crispée et défensive de l’histoire.
En Algérie, une composante conservatrice continue de rejeter toute idée de réconciliation culturelle avec la France. Pour elle, le dialogue est suspect, et l’ouverture équivaut à une trahison de l’histoire. Ce courant reste puissant dans les cercles politiques, médiatiques et religieux, et contribue à figer le pays dans une posture victimaire et isolationniste.
Tant que Paris et Alger continueront à exploiter ce passé à des fins internes, rien ne changera en profondeur. Il faudrait briser ce pacte des loups. Ouvrir les archives, reconnaître les responsabilités, valoriser les sociétés civiles. Donner la parole aux jeunes générations. Repenser l’avenir non comme un prolongement de la guerre, mais comme une promesse partagée.
Car sinon, comme l’écrivait Frantz Fanon : « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l’accomplir ou la trahir. »