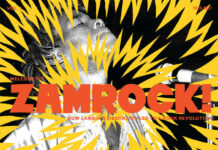Le 7 octobre dernier, un accord de coopération militaire et sécuritaire était signé entre Saïd Chengriha et Khaled Sehili, les ministres de la Défense respectifs de l’Algérie et de la Tunisie, dont le contenu n’a été que partiellement rendu public mais qui entérine la mainmise de l’Algérie sur « la 59 eme wilaya » qu’est souvent la Tunisie aux yeux d’Alger. Cet accord intervient après l’attaque d’Israël contre la flottille pour Gaza au large de Tunis. Aussi discret que décisif, ce texte n’a donné lieu à aucun communiqué officiel à Tunis de la présidence, du ministère de la Défense ou des Affaires étrangères.
Dans le deuxième volet de son enquête, Mezri Haddad, historien et diplomate, raconte l’ingratitude des dirigeants algériens qui, pour remercier Tunisiens et Marocains de leur aide dans le combat de leur pays pour son indépendance, vont estimer que « le Sahara, tout le Sahara lui appartient à l’Algérie et à elle seule ».
Soudain, le gouvernement algérien postcolonial rêve de dominer le Maghreb au nom d’un panarabisme éculé, d’un islamisme aseptisé et d’un socialisme fantasmé. Ce qu’il va tenter de faire.
Analysant les dessous de l’éphémère union tuniso-libyenne de 1974, le fondateur de Jeune Afrique confessait que « le tandem Boumediene-Bouteflika rêvait d’un Maghreb sous sa coupe, où son ami Masmoudi aurait pris le pouvoir en Tunisie et le général Oufkir au Maroc » (Béchir Ben Yahmed, J’assume, 2021, p. 191). Fini le rêve né en avril 1958 à Tanger, lorsque les chefs de l’Istiqlal, du FLN et du Néo-Destour exprimaient leur détermination de fonder un Maghreb uni. Le traité de Marrakech en 1989 pour promouvoir l’intégration économique et politique des cinq pays n’a été, a posteriori, d’une chimère. C’est que pour les Tunisiens, leur pays appartient au Maghreb. Pour les Marocains, le Maroc appartient au Maghreb. Idem pour les Mauritaniens et les Libyens. C’est aussi le cas du peuple algérien mais pas du régime selon lequel c’est le Maghreb qui appartient à l’Algérie !
Les dirigeants Algériens ont rapidement oublié que le Maroc et la Tunisie avaient hébergé des milliers de réfugiés Algériens (selon Mohsen Toumi, La Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, 1989, p. 72). Plus exactement « près d’un million de réfugiés entre 1957 et 1962 », ainsi que l’ALN et le GPRA (gouvernement provisoire de la République algérienne). Le Maroc et la Tunisie ont massivement soutenu l’action militaire de l’Algérie jusqu’à en subir les conséquences tragiques, notamment à Oujda et à Sakiet-Sidi-Youssef en 1958.
Avant même la proclamation de son indépendance imminente, acquise certes par la résistance héroïque de son peuple mais aussi grâce au soutien politique, diplomatique, logistique et même militaire des Tunisiens et des Marocains, l’Algérie faisait preuve de reconnaissance à l’égard de ses fidèles voisins de manière bien singulière : le Sahara, tout le Sahara lui appartient à elle et à elle seule.
Ainsi, tout est répulsif et abominable dans l’œuvre coloniale, sauf le tracé des frontières unilatéralement établies par le colon ! Et pour cause, ce leg précieux du colonialisme lui était bien favorable aux dépens de la Tunisie et du Maroc, qui avaient de leurs côtés l’Histoire et même certains traités juridiques remontant à l’époque ottomane et au début de l’ère coloniale, mais pas les volte-face de la France sous le général de Gaulle !
Un affrontement armé avec le Maroc
A peine une année après son indépendance, sachant qu’elle va devoir restituer ce qui ne lui appartient pas, conformément d’ailleurs aux engagements de certains de ses chefs historiques, l’Algérie mobilisait ainsi son armée pour préserver l’intangibilité de « son » territoire des nouveaux « ennemis » Marocains et Tunisiens, considérant comme fait accompli et non négociable les délimitations coloniales de ses frontières avec le Maroc d’une part et la Tunisie d’autre part.
Avec le Maroc, le différend frontalier a tourné à l’affrontement armé en octobre 1963, avec la « guerre des Sables », provoquée par l’armée algérienne avec l’appui notamment de l’Egypte nasserienne. En dépit d’une convention reconnaissant implicitement la revendication marocaine, signée à Rabat en juillet 1961 entre Hassan II, 21ème représentant de la dynastie alaouite et Ferhat Abbas, président du GPRA avant d’être renversé par Ben Bella, un détachement des Forces armées royales est attaqué à Hassi-Beïda, non loin de Béchar, affrontement qui va rapidement s’étendre à Tindouf et Figuig.
Le conflit fratricide, qui va tourner à l’avantage du Maroc pour ne pas dire à la débâcle de l’ANP -malgré le renoncement volontaire de Hassan II à la région de Tindouf-, prend fin au bout de quatre semaines à l’initiative de l’OUA et sera officiellement réglé par un traité de « fraternité et de bon voisinage » conclu le 15 janvier 1969 à Ifrane. Si pour le Maroc c’était enfin la paix de la bravoure, pour l’Algérie c’était le répit de la rancune… en attendant d’allumer, via le Polisario, son proxy installé à Tindouf, le feu de la discorde au Sahara marocain, improprement appelé « Sahara occidental », une création ex nihilo de Kadhafi avant la récupération de la créature par Boumediene.
S’ensuivit près d’un demi-siècle de guerre froide, parfois chaude, toujours par mercenaires interposés, pour finir ces jours-ci au Conseil de sécurité des Nations-Unies. Inféodation oblige, l’usurpateur de Carthage a entrainé le pays dans ce conflit algéro-marocain, rompant ainsi avec la doctrine des Affaires étrangères tunisiennes de la non-ingérence (Polisario, port de Zarzis : ce qu’Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed se sont dit, article de Jeune Afrique du 11 juin 2025), établie par Bourguiba dès 1956 et fidèlement suivie par Ben Ali. Sur cette question du Sahara marocain, il ne s’agit pas ici d’un propos de circonstance mais d’une position de principe que j’ai toujours exprimé depuis trente ans, notamment dans mon essai Carthage ne sera pas détruite (2002).
« Fraternité algérienne » avec la Tunisie!
Avec la Tunisie, que nos « frères » Algériens continuent d’appeler non sans condescendance « la sœur cadette », le litige frontalier n’a jamais tourné à l’affrontement militaire comme avec le Maroc. Non guère que la « grande sœur » ait fait preuve de plus d’aménité et de gratitude à notre endroit, mais bien parce que la sagesse gouvernait à l’époque la Tunisie. Juriste, légaliste, pacifiste, Bourguiba misait beaucoup plus sur le droit international et les négociations diplomatiques que sur un bras de fer armée, dont il n’avait d’ailleurs ni la force physique, ni les moyens financiers, ni même l’envie. Le 17 juillet 1961, dans son discours à l’Assemblée nationale, il déclarait : « Nous espérons que notre bon droit, notre franchise, et notre désir sincère de coopération pourront nous éviter d’entrer en conflit armé avec la France et à plus forte raison avec nos frères algériens ».
Le litige en question, leg du découpage colonial, concerne essentiellement la fameuse Borne 233, située à Garat el Hamel, à une quinzaine de kilomètres au Sud-Ouest de Ghadamès, considérée comme l’ultime point de la frontière tuniso-libyenne et légitimement (en termes de droit comme au regard de l’Histoire) revendiquée par la Tunisie indépendante conformément au traité du 19 mai 1910, qui délimite précisément la frontière tuniso-libyenne de la mer à la Borne 233, ainsi qu’au traité franco-libyen de 1956 fixant la frontière entre l’Algérie et le royaume libyen, et qui se réfère également à la Borne 233. L’affaire dite de la Borne 233 relate une amputation géographique des plus injuste, arbitraire et douloureuse ; elle incarne dans sa quintessence la spoliation de la Tunisie de tout son Sahara, immensément riche en hydrocarbures, par l’Algérie avec la complicité active de la France. Comme l’écrit très justement Karim Serraj, « Derrière le litige frontalier se cache donc une bataille pour le contrôle de ressources vitales, un enjeu économique qui transforme un différend historique en une question de survie économique pour la Tunisie. On peut dire que la Tunisie utile a été donnée à l’Algérie post-indépendance » (Territoires tunisiens spoliés par l’Algérie : genèse des revendications contemporaines, site Le360, 26 octobre 2025).
« J’avais déjà dit, dans mon discours du 5 février 1959, que nos frontières territoriales et notre existence géographique nous ont été spoliées au Nord et au Sud et doivent nous être rétrocédées (…) Nous croyons, de notre devoir, de revendiquer notre espace saharien aujourd’hui plutôt que d’ouvrir, demain, un conflit avec nos frères algériens ». Bourguiba, le 17 juillet 1961
Dans son livre Mon combat pour les Lumières (éd. p. 168), s’arrêtant sur le cynisme du gouvernement français sous de Gaulle, feu Mohamed Charfi, professeur de droit, président de la Ligue des droits de l’homme et ministre de l’Education nationale sous la présidence de Ben Ali, écrit : « Peut-être que des raisons objectives, coloniales (attribution du Sahara à l’Algérie) et géologiques (richesses fabuleuses du Sahara en pétrole et en gaz), ont favorisé cette attitude. Dans le tracé des frontières en Afrique du Nord, les dirigeants français ont tenu à avantager l’Algérie, considérée à l’époque comme étant un département français et qui, dans leurs esprits, devaient le rester, par rapport à la Tunisie et au Maroc, par définition provisoire. Ainsi, ils ont attribué tout le Sahara qu’ils occupaient à l’Algérie. C’est là un fait colonial et un accident de l’histoire… (la Tunisie) avait des revendications légitimes concernant sa part du Sahara ».
Dès 1962, l’Algérie ne se voyait pas comme le dernier pays à recouvrer sa pleine souveraineté moins pour réaliser l’unité du grand Maghreb arabe dont rêvaient les précurseurs de la lutte anticoloniale que pour contribuer à son propreessor social, culturel, économique et diplomatique. L’Algérie se voyait plutôt comme une nouvelle puissance hégémonique, en lieu et place de l’empire colonial français.
Un an avant la proclamation de l’indépendance algérienne et un mois après le début des négociations d’Evian (mai 1961), soit le 26 juin 1961, Mohamed Masmoudi, alors secrétaire d’Etat à l’information, s’adressait ainsi aux frères Algériens : « Est-ce le Sahara qui nous divise (…) ? Tout le monde sait que la rectification des frontières sud, c’est-à- dire le droit de la Tunisie à son espace saharien, était l’un des principaux points du contentieux franco-tunisien (…). Est-ce porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Algérie que de dire : c’est avec la France et non avec l’Algérie que nous avons un contentieux portant sur nos frontières sud ?» (cité par Tahar Belkhodja, Les trois décennies Bourguiba, 2010, p. 56).
Spoliation de la Tunisie
Certains de mes compatriotes parmi lesquels des historiens, ont beaucoup écrit sur la bataille décisive de Bizerte à l’été 1961. Mais peu d’entre eux prêtait attention au fait que la crise de Bizerte et la crise du Sahara tunisien étaient politiquement, stratégiquement et même temporellement liées. Elles éclatent simultanément, à savoir le 18 juillet 1961 dans le Sud tunisien, et le 19 juillet à Bizerte.
En cette journée mémorable et paradoxalement occultée du 18 juillet 1961, affluaient à Tataouine, où les attendait Ahmed Tlili, des centaines de jeunes volontaires venus de Médenine, Gafsa, Douz et Gabès, se portant volontaires pour la bataille ultime. Le lendemain matin, notre jeune et vaillante armée plantait à Garet El Hamel, sur la Borne 233, le drapeau tunisien. Courte victoire face aux bombardements de l’aviation française et aux troupes de l’infanterie précipitamment dépêchés d’Alger.
Dans ses Mémoires, le général de Gaulle racontera l’événement à sa manière : « le 18 du mois de juillet, dans l’extrême sud, un imposant détachement tunisien franchit la frontière saharienne, assiège notre poste de Garet El Hamel et occupe le terrain dit (la borne 233). Vraisemblablement Bourguiba estime que Paris reculera devant la décision de déclencher une action d’envergure… Il compte donc qu’une négociation s’ouvrira sur la base du fait accompli, et par conséquent lui donne satisfaction… Je n’admets pas qu’on manque à la France… » !
De Gaulle au secours d’Alger
De Gaulle a été plus loquace et néanmoins fourbe lors de sa célèbre conférence de presse du 5 septembre 1961 : « Il faut dire que dans les négociations de Rambouillet (27 février 1961), le président de la République tunisienne avait réclamé au Sahara une rectification des frontières en faveur de la Tunisie et aux dépens de l’Algérie. Cette rectification de frontières devant ménager en quelque sorte un accès futur à la Tunisie vers le Sahara. Et du reste, Monsieur Bourguiba ne cachait pas que c’était là qu’une étape et qu’il visait au plus profond du désert la région des gelées où se trouvent comme on sait d’importants gisements de pétrole…L’Etat tunisien réclamait la source du pactole…Nous avons fait connaître à l’époque à Monsieur Bourguiba que du moment où nous étions en train d’aider à naître un Etat algérien qui pouvait pas ne pas être intéressé au premier chef par le Sahara…nous n’allons pas inconsidérément découper les pierres et les sables … ».
Une année après, l’Algérie devenue indépendante, Bourguiba va user de toute son énergie et diplomatie pour convaincre les nouveaux dirigeants Algériens. Peine perdue. Devant l’hubris, la phronesis est impuissante. La dernière illusion d’une solution pacifique et équitable fut l’année 1964. En juillet, raconte Tahar Belkhodja, « je rejoins de Dakar notre délégation au Caire, à la deuxième conférence au sommet des pays africains. Bourguiba soumet, encore une fois, à Ben Bella le problème de la délimitation des frontières à partir de la borne 233. Le chef d’Etat algérien consent verbalement à un arrangement reconnaissant la souveraineté tunisienne. Mais à son retour à Alger, Boumediene, ministre de la Défense et Bouteflika, ministre des Affaires étrangères, refusent d’entériner cet accord ».
Alors qu’une délégation tunisienne composée d’officiers supérieurs se trouvait à Alger le 5 janvier 1970 pour discuter de la sempiternelle question frontalière, elle fut priée de rebrousser chemin car « les discussions sur le problème des frontières n’ont plus raison d’être. La question est résolue », lui fit-on savoir ! En effet, un « traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération », délimitant notre frontière à la Borne 220 comme le voulaient les Algériens et les Français, et non plus à la Borne 233, est signé à Tunis le lendemain, 6 janvier 1970, par les deux ministres des Affaires étrangères, Habib Bourguiba Junior et Abdellaziz Bouteflika.
Un protocole annexe comportait la cession à l’Algérie des biens domaniaux tunisiens, à savoir Fort Carquet, deux puits artésiens, et l’aérodrome. En échange, l’Algérie versera l’équivalent modique en Francs français de 10 millions de dinars algériens ! Avant la donation à l’Algérie par de Gaulle de territoires tunisiens, donation « légalisée » par le traité de la Honte, la superficie de notre pays atteignait les 185 000 Km2 ; après ce traité, sa superficie a été réduite à 164 000 Km2.
Un traité de la honte
Cet accord inique entre les deux pays sera ratifié par l’Assemblée nationale le 30 janvier 1970. Un seul député, Ali Marzouki, osa prendre la parole : « Ce n’est pas la première fois que la Tunisie se déleste d’une partie de son territoire au profit de la France, et aujourd’hui en faveur de l’Algérie… Le même événement se produisit sous le règne d’Ahmed Bey, lorsque notre pays a cédé aux autorités françaises de l’Algérie une région entière qui s’appelait Najd près de Souk el Arba. Puis, en 1901, lorsque les frontières passèrent par le Sahara, la Tunisie fût amputée malgré elle d’une partie importante du Sahara…Nous avions trouvé un tracé de Bir Romane jusqu’au Sud sans qu’il parvienne à la borne 233… Aujourd’hui, la Tunisie accepte de sacrifier au nom de l’amitié et de la fraternité une partie importante de son territoire aux frères algériens…Parallèlement, j’aurais aimé que nos frères Algériens eux-mêmes se désistent de la petite portion qui n’a aucune valeur, sinon qu’elle nous est chère historiquement : le puits artésien était le premier puits dans la région, le deuxième a été creusé en 1963. Lors de la bataille de juillet 1961, plusieurs de nos soldats et de nos citoyens sont tombés au champ d’honneur… Mais pour l’amitié et la fraternité et le bon voisinage, j’approuve cet accord et espère que le peuple algérien sera au niveau du peuple tunisien… ».
Les deux ministres signataires, Abdellaziz Bouteflika et Habib Bourguiba Junior envoient un message de « félicitation » à Bourguiba, hospitalisé à Paris : « En ce jour historique… nous avons signé, un traité et des accords qui mettent fin aux différends précédents, et ouvrent une page nouvelle de coopération entre les deux pays… ». Profondément affecté et meurtris, Bourguiba ne réagira point, et depuis, il ne fera plus jamais allusion à ce qu’il appelait « nos territoires du Sud ». Mais il conservera toute sa vie, accroché au mur derrière son bureau, la vraie carte géographique de la Tunisie avec la frontière non délimitée au-delà de la borne 233, y compris le Sahara tunisien, soit 20 000 Km2, près de deux fois la superficie du Qatar ! A ses visiteurs étrangers, y compris des Algériens, il lui arrivait avec humour noir de commenter la carte : « Tout ça c’est l’Algérie, elle a un gros ventre…plein de gaz » ! Cette carte géographique devenue tableau historique ne sera jamais décrochée par Ben Ali. Mieux encore, lors de son premier déplacement à l’étranger en tant que Président, qui a été pour l’Algérie (2-3 mars 1988), il a eu l’audace « militaire » de dire par boutade à Chadly Ben Jedid que « la question de nos territoires du Sud nous est restée là », faisant un geste du doigt pointée sur la gorge (cela m’a été raconté par mon ami, feu Dali Jazi, professeur de droit public et politologue, plusieurs fois ministre sous Ben Ali, notamment de la Défense).
Pour l’anecdote, cinq jours avant la conclusion du « traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération », soit le 1er janvier 1970, Habib Bourguiba Junior rendait hommage à l’armée française et « aux efforts prodigieux déployés par l’équipe du génie militaire français venue reconstruire les voies ferrées du sud-tunisien, qui avaient été détruites par de récentes inondations » (Le Monde du 1er janvier 1970) !
Le président Kaïs Saïed place la Tunisie sous protectorat algérien (1er volet)