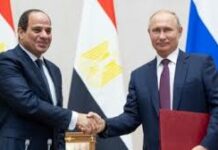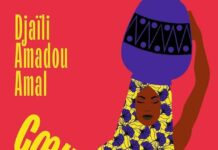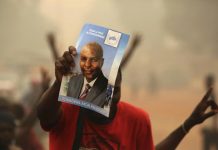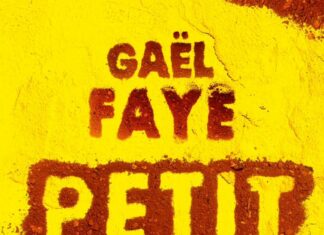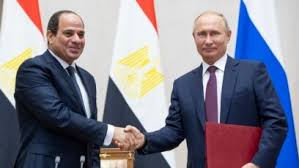Dans un Proche-Orient en perpétuelle tension, Liban et Gaza subissent la violence structurelle d’un statu quo mortifère. Entre pression internationale, divisions internes et menaces d’escalade, ces territoires oscillent entre survie, soumission et résistance, pris au piège de leur histoire.
Dans la région du Proche-Orient, le Liban et la bande de Gaza partagent, à des degrés divers, le sort tragique d’être à la fois acteurs et otages d’une violence qui ne cesse de se réinventer, d’un cycle sans fin d’escalade et de répit, d’une « paix négative » entretenue par la fatigue des sociétés et la stratégie des puissants. Au Sud-Liban, la prolongation in extremis du mandat de la FINUL jusqu’à fin 2026 apparaît comme une simple suspension de l’inévitable, un sursis accordé à un statu quo qui ne tient plus que par la crainte du pire. La communauté internationale, partagée entre lassitude et calcul géopolitique, n’offre plus que le minimum vital : la gestion du temps. Gagner du temps, retarder l’embrasement, reporter le chaos – telle est la politique qui prévaut aujourd’hui.
Dans ce paysage désolé, deux fronts se font face, deux tragédies se répondent. À Gaza, la menace d’une évacuation de masse, dénoncée comme « impossible » et inhumaine par la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, expose au grand jour le cynisme des stratégies de guerre et l’incapacité du système international à protéger les civils. Plus d’un million de personnes sont prises au piège, condamnées à choisir entre l’exode impossible et la survie improbable, sous le feu d’une armée qui poursuit son objectif « d’élimination du Hamas », sans jamais définir qui est réellement visé, ni ce qui constituerait une victoire.
Au Liban, le scénario n’est guère différent dans son essence, même si les modalités varient. La société, appauvrie, divisée, minée par la défiance, est sommée de choisir entre la soumission à la logique des armes et la perspective d’un désarmement imposé, aussi incantatoire qu’irréaliste. La FINUL, présente depuis près de cinquante ans, est désormais perçue comme un élément décoratif d’une sécurité illusoire, et le retrait programmé à l’horizon 2026-2027 inquiète autant qu’il soulage.
L’instrumentalisation américaine
Pour Israël, ce retrait est l’occasion d’accentuer la pression sur l’État libanais, sommant ce dernier d’assumer enfin sa souveraineté sur un Sud qui lui échappe. Pour les États-Unis, c’est un levier diplomatique et militaire dans un contexte de rivalité régionale accrue, où l’Iran, la Syrie, et les groupes armés palestiniens restent des acteurs majeurs de la déstabilisation.
Ce contexte délétère façonne le débat sur le Hezbollah. Depuis le 7 octobre 2023, date de la nouvelle guerre entre Israël et Gaza, la frontière libano-israélienne s’est transformée en front mouvant, théâtre d’affrontements réguliers, d’incidents mortels et de démonstrations de force. La perspective d’un conflit élargi, qui embraserait le Sud-Liban et transformerait la guerre contre le Hamas en guerre régionale, n’a jamais été aussi réelle.
Pourtant, au cœur du discours dominant, une question persiste, lancinante : pourquoi ne pas désarmer le Hezbollah ? Pourquoi laisser un parti-milice détenir un arsenal qui échappe à l’État, une capacité militaire hors du contrôle national ? Pourquoi tolérer cette « anomalie » qui fait du Liban un cas unique, ni pleinement souverain, ni totalement sous tutelle ? Posée ainsi, la question semble simple. Mais sa simplicité est trompeuse. Car derrière le slogan « désarmer le Hezbollah » se cache un abîme de contradictions, de non-dits, d’impuissance collective et de peur.
C’est à ce nœud, à ce piège des mots et des réalités, qu’il faut s’attaquer pour comprendre la tragédie libanaise.
Cet article inaugure un dossier consacré à la tragédie libanaise, à la question du Hezbollah, et aux impasses d’une région otage de ses propres contradictions. La suite explorera les enjeux du désarmement, le rôle des puissances régionales et la crise de souveraineté.